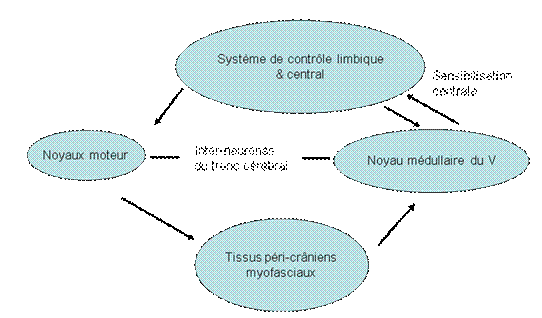Céphalées de tension chroniques et gestion de la douleur
Quels
moyens pour affronter la douleur chronique ? Quelques idées pour tenir
face à une douleur durable.
Par Benjamin LISAN[1], Texte créé
le 10/6/2009. Mise à jour le 29/7/2009. Version
2.6.
Sommaire en fin de cet article.
1. Introduction
Le contenu de ce texte s’inspire directement
de l’expérience de l’auteur, en particulier de son histoire personnelle face à
la douleur et aussi d’une réflexion de plus de 27 ans sur ce sujet.
La question qu’il s’est souvent posé est peut-il
communiquer et diffuser une expérience somme toute personnelle, intérieure, aux
autres personnes souffrantes ? Des solutions qui ont aidé momentanément
l’auteur pourraient-elles aussi aider d’autres personnes ? Sont-elles
généralisables ?
L’auteur n’a pas la prétention de penser que
son expérience et ses solutions sont généralisables à tous. Chaque expérience
et ressenti de la douleur sont totalement intérieurs et intimes. Ils sont le
plus souvent incommunicables.
Quiconque voyant des personnes autour de lui
ne peut, le plus souvent, strictement pas deviner que peut-être l’une de
celles-ci vit, en permanence, dans le bouleversement intérieur de la douleur permanente,
à moins de posséder une capacité d’intuition psychologique hors norme.
En fait, il n’y a pas de communication
télépathique qui permettrait de faire partager l’expérience de la douleur à
d’autres, même à des proches. Ce qui permettrait à ceux qui souffrent d’être
moins seuls.
Personne ne peut dire que la personne qui
geint ou celle qui ne dit rien, ne vivent pas avec le même niveau de douleur. Il
n’y a actuellement aucun moyen scientifique d’évaluer et caractériser la
douleur (nous y reviendrons).
Dans ce texte nous aborderons les moyens pour
affronter la douleur, surtout quand les traitements _ médicaments et les
traitements non médicamenteux _ sont insuffisants, tels que :
a) les différentes approches philosophiques
ou religieuses, pour faire face à la douleur,
b) les trucs et astuces pour tenter de
résister à la douleur, au jour le jour, ce que nous appellerons les
« techniques de survie ».
c) le soutien de proches ou de praticiens
compréhensifs.
Car pour les membres de l’association, la
question principale suivante se pose le plus souvent:
Quelles armes a-t-on
à notre disposition pour affronter la douleur durable ?
Intuitivement, on
sent que « les armes de l’espoir » _ le fait de pouvoir garder
l’espoir et tous les supports intellectuels et physiques qui permettent
d’entretenir l’espoir en soi _ sont très importantes, voire les plus importantes,
pour tenir. L'optimisme et la foi en l’avenir (dont celle de la résolution de
ses maux de tête, à terme) permet d’accepter plus facilement les difficultés à
venir. Dès qu’on perd l’espoir, tous les ressorts, qui nous fournissent notre
énergie pour tenir, peuvent alors s’écrouler totalement.
Sinon, le soutien de
la part des proches peut être aussi important pour tenir.
Une première question
importante est comment conserver l’espoir surtout quand les médicaments
prescrits actuellement sont actuellement insuffisamment efficaces.
Une seconde question
très importante est de savoir comment conserver l’espoir et tenir, alors que,
depuis plus de 40 ans, les médecins ont tendance à minimiser totalement ou
systématiquement votre douleur, à quelques rares exceptions[2] (et là
encore, en l’absence de soutien de médecins compréhensifs, le soutien des
proches reste important).
Quel
Espoir avoir face à une douleur chronique particulièrement longue ? :
1.
Espoir
d’une sortie de la douleur, seulement à la fin de sa vie, dans une vision
purement eschatologique _ c’est à dire relative à notre destinée après notre
mort, i.e. quand notre « âme » « débouchera » dans « l’autre
monde » ?
2.
Espoir
qu’en parvenant à une certaine philosophie de vie, une certaine hygiène de vie
ou à un certain entrainement, on pourra mieux affronter ou résister à la
douleur, chaque jour ?
3.
Espoir
que notre mal puisse être résolu par des solutions techniques dans notre vie
présente ? Par exemple, par une nouvelle technique, thérapie, ou surtout grâce à une nouvelle avancée
scientifique ?
Concernant le dernier point, si la cause des
céphalées de tension chroniques était enfin déterminée d’une façon rigoureuse,
scientifique et très précise, de façon à éviter toute piste causale erronée et
toute ambiguïté sur les causes, cela éviterait aux patients un véritable et
douloureux chemin de croix _ pouvant
durer souvent toute une vie _ induisant des dépenses financières faramineuses,
pour tenter de résoudre, sans fin et en vain, leur problème.
Le monde scientifique aussi ne
« pataugerait » plus sans fin entre de multiples hypothèses _
avancées d’ailleurs souvent de façon péremptoires et sans aucune preuve
scientifique _ et ne s’engagerait plus dans de multiples impasses
thérapeutiques ou intellectuelles. Voire ne se défausserait pas de ses
responsabilités face à la maladie.
On
pourrait enfin savoir si :
1.
Les
céphalées de tension chroniques sont définitivement solvables ?
2.
Si
oui, quel serait alors le traitement cible ou quelle thérapie résolvant
définitivement le mal ?
3.
Sinon,
si le mal n’est pas solvable, mais si l’on peut quand même soigner ou soulager
la douleur,
a)
soit
quel aménagement du travail et des conditions de vie permettraient d’éviter
leur déclenchement ou de mieux supporter la douleur.
b)
soit
quels médicaments cibleraient, au mieux, soit le système d’activation de la
céphalée, soit la douleur causée par la céphalée.
4.
Enfin
si les céphalées de tension chroniques et la douleur n’étaient ensemble pas
solvables, comment aménager la vie du malade (autour de sa douleur …) et gérer
le handicap, au jour le jour, y compris au niveau des moyens d’existence, grâce
par exemple à l’attribution d’une allocation COTOREP ?
L’idéal bien sûr serait de pouvoir résoudre
définitivement les céphalées de tension, en particulier, celles très fortes ou
très anciennes et présentes d’une façon permanentes depuis plusieurs dizaines
d’années.
Sinon, comme la phénoménologie de la maladie
est complexe, nous essayerons d’éviter toute déduction et conclusion hâtive et
prématurée (à l’emporte pièce), sur un tel sujet difficile. Nous souhaitons
effectuer si possible une analyse fine, circonstanciée, évitant tout discours
rhétorique ou/et juste issu de son « intime conviction ». Nous
essayerons d’être très honnête en tout, sans faire aucune politique de
l’autruche, sans rien dissimuler.
Nous espérons que ce texte, faisant appel à
un certain nombre de notions intellectuelles et abstraites, sera, malgré tout,
compréhensible du plus grand nombre.
Enfin, certaines données ou images exposées
ici sur la douleur peuvent ne pas être comprises par ceux qui n’ont jamais
connue ce que sont les douleurs chroniques.
Note : dans le texte, pour des besoins
d’illustration de notre propos, seront inclus de courts extraits de témoignages
de personnes souffrant de céphalées de tension chroniques, recueillis lors de
l’Assemblée général de l’association « Papillons en cage », qui s’est
déroulée à Toulouse, les 30 et 31 mai 2009.
1 Différentes formes de douleurs
Les différentes
formes cliniques de douleurs sont extrêmement difficiles à décrire, d’autant qu’il
existe énormément de formes et de niveau d’intensité de
Par exemple, dans l’association
« Papillons en cage »[3], on a
l’habitude de mesurer le niveau de la douleur sur une échelle de 1 à 10. Or
cette échelle, plus que suggestive, n’a rien de rigoureuse ou de scientifique.
On sait bien sûr
qu’il y a des douleurs insupportables. Si par exemple, vous mettez votre main
sur une plaque électrique chauffée au rouge, vous ne pouvez strictement pas
tenir votre main, sur cette plaque, plus de quelques secondes (ne serait-ce
même une minute). La douleur des céphalées de tension n’atteint pas à ce niveau
là. L’impression de brûlure qu’on ressent le plus souvent n’est certainement
qu’une impression erronée.
En plus, par la force
des choses, parce qu’on n’a pas le choix, sur 10 ans ou plus, on peut
devenir entraîné à bien plus supporter sa douleur chronique qu’au début de son
apparition, tout comme les sportifs peuvent aussi résister, à la longue, à la
douleur liée aux efforts physiques[4]. Et
donc, alors le ressenti de la douleur diffère ou peut différer aussi au cours
du temps.
De ce fait, il est souvent difficile d’évaluer
le ressenti de
Par ailleurs, quand
les céphalées de tension sont fortes, de multiples phénomènes connexes,
mystérieux et souvent rares, peuvent aussi apparaître, tels que (voir ci-après) :
a) vertiges,
b) impression
d’écœurement, de nausée ou d’amertume intense[5],
c) fatigue anormale
très forte et systématique,
d) voire désir
irrésistible de dormir (induction d’une sorte d’hypersomnie anormale) ou de se
coucher.
Dans le cas de
certains malades, la douleur liée à la céphalée peut les réveiller systématiquement
dans la nuit (par exemple, toujours vers 2 à 4 h du matin), quand elle est
forte, voire trop fortes, tant que dure
Et tous ces
phénomènes connexes précédents peuvent encore renforcer ou entretenir aussi
l’impression douloureuse[6].
En recueillant le témoignage de personnes
souffrant de céphalées de tension chroniques, au sein de notre association, on
peut définir grosso modo, 4 niveaux schématiques de douleur (voir
ci-après) :
|
Niveau(x) |
Description, caractéristiques |
Fréquence
/ prévalence |
|
1-2 |
Légère à modérée. simple gêne, mais pas vraiment
la cause d’une réelle gêne intellectuelle. On peut vivre avec sans problème. Parfois,
on ne s’en aperçoit même pas. Souvent, en fait, on ne s’en aperçoit, que
lorsqu’on se repose. |
Rare
parmi les membres |
|
2-4 |
Douleur modérée, mais vraie gêne intellectuelle.
Début de la réduction des capacités intellectuelles. On oublie régulièrement.
On doit commencer à tout noter. Elle perturbe déjà d’une façon importante
l’activité professionnelle. Dès que la douleur atteint ce niveau, elle
a un effet préjudiciable sur l'humeur et elle provoque une désocialisation. |
fréquente |
|
5-8 |
Douleur forte à intense. On commence à ne
plus rien vouloir faire. Fatigue intense. Pertes de mémoire fréquentes.
Souvent, on n’arrive pas à suivre ce que les gens vous disent. Perturbation
grave de l’activité professionnelle ou d’activité courante comme s’occuper de ses enfants. Passages
successifs par les phases de découragement, d’abattement de colère ou de
dépression … On ne peut pratiquement plus se battre. La douleur ne vous
laisse pas de répit et est la plus forte. Finalement, on sent que cela ne
sert à rien de se battre. On est dans l’attente, on vit seulement au jour le
jour, dans l’instant présent. Le mal de tête est comme un cheval emballé
qui ne s’arrête jamais ou comme une mécanique infernale. Parfois
impression, d’être dans cet état désagréable, comme celui qu’on ressent
plusieurs heures après avoir reçu un coup violent sur la tête[7]. |
Fréquente |
|
8-10 |
douleur intense à sévère. On est totalement
accablé en permanence. On ne bouge plus. On ne vit pratiquement plus. On se
lève seulement, juste, pour se nourrir. On est au lit en permanence. On ne
pense plus, on ne peut plus penser,
on ne pense même plus à vouloir se suicider. On est incapable d’avoir la
moindre idée. On est un bloc de douleur à vif. On est totalement incapable de
se défendre. On tombe le plus souvent dans une sorte de « fatalisme »
total. La douleur est du même niveau que celle d’une crampe musculaire qui
serait permanente et violente. Le mal de tête est comme un cheval emballé qui
ne s’arrête jamais. On ne peut plus du tout travailler. Parfois,
impression d’une « fulgurance »
de la douleur, mais d’une « fulgurance » qui durerait éternellement
ou bien d’une douleur insoutenable.
Impression d’être plaqué [scratché] au sol,
par les maux de tête. |
Rare |
|
8-10 |
Un cas très rare de céphalées de tension
est associé à des douleurs oculaires
intenses, perçues comme insoutenables par le malade. Ce dernier a
l’impression, que sous l’effet de la pression des muscles oculaires (des six
muscles extra oculaires entourant chaque œil), les globes oculaires ont
tendance en permanence de sortir de
leurs orbites. La personne ne peut plus du tout lire ou même avoir une
quelconque activité professionnelle[8]. |
Très
rare |
Mais ces niveaux de
douleur peuvent être, malgré tout, comparés. Par exemple, on peut constater
qu’elle peut être plus douloureuse que la douleur œsophagique[9] liée à
un reflux œsophagique chronique _ quoique cette dernière est d’intensité
variable _, lors d’une crise.
Sinon une céphalée de
tension, peut être pratiquement aussi
douloureuse qu’une crise de migraine[10], même
si ces derniers cas de crises de céphalées de tension violentes sont rares.
Mais elle peut être suffisamment forte, insistante,
durable, pour altérer durablement votre vie. Par sa présence insidieuse,
constante, elle diminue continuellement
et énormément votre qualité de vie.
Le plus souvent, elle
n’est souvent pas suffisamment forte, pour vous empêcher définitivement de
travailler, mais suffisamment forte pour vous mettre dans un état de révolte
constant, de déprime ou pour vous gêner durablement dans toutes vos actions en
particulier vos activités intellectuelles.
C’est un peu comme le
clou dans la chaussure qu’on n’arrive jamais à retirer ou la guêpe qui n’arrête
jamais à voler autour de vous et dont vous n’arrivez jamais à vous débarrasser,
qui à la longue peuvent vous « rendre fou(s) », malade(s), perturbé(s),
amer(s), désespéré(s) etc.
Il n’y a pas de règle
absolue, concernant le profil d’évolution dans le temps ou les caractéristiques
des douleurs.
Car il y a des
douleurs constantes _ certaines à un niveau très élevé _, alors que d’autres
sont totalement variables, voire extrêmement variables chaque jour[11]. On
peut avoir un fond de douleur gênante, mais peu handicapante, et puis
régulièrement, toutes les semaines ou les quinzaines, passer par une phase de
crise (voire des sortes de « crises paroxysmiques »), qui vous
handicape alors totalement et vous maintient au lit, tout le temps de la durée
de la crise[12]
(par exemple, du type de celles atteignant le stade ou niveau 8-10 du tableau
précédent). Chez certains, la « susceptibilité » aux maux de tête est
très élevée et les céphalées se déclenchant sans cesse, à tout bout de champ,
parfois même sans raison claire ou évidente. Chez certains, la survenue des
céphalées est aléatoire et est comme une épée de Damoclès, sans cesse brandie
au-dessous de la tête du malade, épée qui peut, à tout moment, remettre en
cause l’avenir professionnel du malade (avec cette maladie, « rien n’est
jamais gagné »)[13].
Au sein de
l’association « Papillons en cage », il y a une énorme diversité de
forme de douleurs : constantes, variables, périodiques, totalement
aléatoires, celles qui donnent, sans cesse, l’impression qu’on va enfin les résoudre, mais
dont la solution semble reculer sans cesse, comme dans un mythe de Sisyphe sans
fin, ou un mauvais polar ou un cauchemar, ou encore localisées en permanence en
avant du crâne, chez certains alors que d’autres localisées systématiquement à
l’arrière du crâne. Il n’y a pas de règles claires hormis le fait qu’elles
sont en général bilatérales, très rarement dissymétriques[14]. …
En ce qui concerne
les douleurs évaluées 8 à 10 sur notre échelle de la douleur (c’est à dire très
fortes), elles ne sont pas localisées nécessairement en casque intégrale sur
tout le pourtour du crâne, mais peuvent être localisées en des endroits
discrets, précis _ souvent les mêmes chez certains malades _, soit a) en barres
frontales, b) en des points localisés au niveau de l’occiput et symétriques
autour de l’occiput, c) dans la nuque et autour d’elle, d) le long des tempes[15] et de
chaque côté _ côté gauche et côté droit _ du crâne.
Sinon, à la douleur
physique liée aux maux de tête, il peut se superposer une douleur morale
_ lié au fait d’avoir l’impression de ne jamais arriver à s’en sortir dans la
vie, du fait de ses céphalées permanentes _, toutes les deux vrillant et
taraudant, sans fin, votre cerveau. Il
peut y avoir des douleurs morales énormes, peut-être
même pires que des douleurs physiques.
Donc, en plus de la douleur physique, il y aura donc
lieu aussi de traiter la douleur morale[16].
2 Réactions et humeurs des malades face à la douleur
L’organisation
anatomique et physiologique des récepteurs, des voies et des centres cérébraux,
impliqués dans la douleur, serait normalement identique chez tous[17].
Pourtant, chacun se comporte de façon très différente, lorsque le malade est en
prise avec
Le « seuil de la sensation
douloureuse » peut être par exemple élevée ou abaissée, selon que le
malade se concentre sur sa douleur ou bien en est distrait par une activité
physique ou mentale. La richesse ou la pauvreté émotionnelle du malade pourraient
aussi jouer dans son ressenti[18]. Des
facteurs personnels, ethniques[19] [20] [21],
éducationnels, philosophiques, religieux interviennent aussi dans la
variabilité de la sensibilité à
La douleur inspire ou
provoque les comportements les plus variés, comme par exemple :
- Soit la
résignation devant la douleur,
- Soit la révolte
ou colère contre le scandale ou l’injustice qu’elle constitue, le fait
qu’elle dure sans fin ou bien qu’elle est forte,
- Soit « l’exaltation »
de la valeur de l’épreuve que constitue l’affrontement individuel et
solitaire de sa propre douleur. La douleur est alors positivée et perçue
comme un moyen de s’améliorer intérieurement[22].
Certains malade semblent
bien résister à la douleur … du moins en apparence ( !). Certains ne font pas état de leur souffrance[23].
D’autres se plaignent[24],
rarement ou souvent, et/ou n’hésitent pas à en parler.
L’humeur du malade
peut être très variable selon le niveau de douleur et peut suivre presque pas à
pas l’évolution de la douleur, selon ses variations. Par exemple quand la
douleur diminue ou disparaît, il a l’impression de revivre. La vie semble
belle. Il est joyeux. Il est l’être le plus heureux du monde[25]. Au
contraire, quand la douleur revient, il voit tout en noir. Il peut avoir
l’impression d’être au plus bas, « dans l’ornière », et que l’épreuve
qu’il subit est très dure, surtout quand la douleur, qu’il craint ou cherche à
éviter, revient régulièrement.
Quand elle n’est pas
assez intense, mais qu’elle dure, certaines personnes se ferment, deviennent
agressives ou sont « assaillies » constamment par des pensées
suicidaires.
Mais quand elle est trop intense, la douleur, en général
et malgré tout, casse moralement, la majorité des personnes souffrantes. Après la crise,
elle laisse la personne brisée ou pantelante. Durant ou après la crise, certaines
ont l’impression de n’être alors plus qu’une chose, un jouet de forces, ou de
mécaniques infernales ou diaboliques qui les dépassent. Elles ne revivent
vraiment que quand la crise est passée.
Sinon en général, le malade, « bousculé » en permanence par sa douleur, dépense
involontairement une énergie physique et mentale considérable pour la combattre,
du moins tant qu’il ne s’est pas résigné à l’accepter.
Sinon, devient-on, à
chaque fois, résigné et passif ou passif, quand la douleur est trop forte, lorsqu’elle
semble « éternelle » et que les médicaments sont impuissants ?
Examinons alors l’expérience ci-après :
L’expérience
du chien résigné :
Le
principe de cette expérience est de prendre trois groupes de chiens :
1)
Les
premiers subissent de légers chocs électriques qu’ils ont la possibilité
d’arrêter en appuyant avec leur museau sur une plaque.
2)
Les
deuxièmes n’ont aucun moyen de faire cesser les chocs.
3)
Les
troisièmes ne subissent rien.
Le lendemain, on met les chiens dans une cage
divisée en deux parties : dans
Les
chiens du deuxième groupe restent dans
Le scientifique, Martin Seligman, qui a mené
cette expérience, en conclut que l’optimisme s’apprend, ainsi que le pessimisme
et la dépression[26].
Donc on pourrait conclure de cette expérience, que quand il n’y aucun moyen
d’échapper à sa douleur chronique, l’homme aurait tendance naturellement à se
résigner et à déprimer.
Mais
heureusement, nous ne sommes pas des chiens, les hommes pouvant eux faire preuve
de capacités exceptionnelles insoupçonnées ou surprenantes. Ils peuvent faire
preuve de sursauts ou de réactions énormes et stupéfiantes, face aux pires
épreuves (telle lors de l’expérience de la vie dans un camp de concentration …),
et faire en sorte de ne jamais se résigner et de toujours conserver son espoir,
jusqu’au bout.
Même quand le malade est confronté à la phase
4 du tableau précédent, le malade peut encore continuer à se battre mentalement
au plus profond de la douleur et de son lit (au plus profond de son « lit
de douleur »), même si en apparence il semble passif et ne bouge pas.
Certaines personnes exceptionnelles, ayant
souffert toute leur vie _ comme Sainte Thérèse d’Avila et Marthe Robin dont nous
reparlerons plus loin _ ont pourtant réussi à continuer à agir toute leur vie,
malgré leur douleur.
3 Difficile gestion de la douleur causée par les céphalées de tension
D’une manière générale, on constate que la
gestion de la douleur est beaucoup plus difficile à mener que la gestion du
stress.
Si pour certains malades, il suffisait de ne
pas y penser, si le mal n’était qu’un mauvais rêve, si un jour on pouvait en
rire, cela serait si simple et « super », mais la réalité du vécu des
malades n’est pas ainsi.
Toute douleur chronique forte, surtout si
elle dure, et le fait de tenir aussi sans fin, surtout sans espoir de s’en
sortir à court terme, sont toujours épuisants et usants moralement à
Tout
dépend si le malade a à sa disposition :
a)
Soit
une panoplie médicamenteuse efficace.
b)
Soit
une panoplie « d’armes intellectuelles » (philosophiques, religieuses
etc.), permettant de mieux tenir face à la douleur[28].
c)
Soit
un entrainement préalable à la douleur (qui peut dépendre de son éducation et
de son expérience).
d)
Soit
un soutien moral sincère, voire une consolation, venant de proches ou de
praticiens compatissants.
Il est certain que si
l’on a à sa disposition des médicaments efficaces, la lutte contre sa propre
douleur en est nettement facilitée !
3.1 L’inexistence de traitement efficace pour les céphalées de tension chroniques
Il existe des médicaments antidouleur très
efficaces, du moins au début de leur administration, en particulier les dérivés
morphiniques.
Malheureusement, à la longue, ils perdent leur propriété et efficacité
antidouleur et entraîne des effets de dépendances[29] et
d’accoutumance[30].
Car à la longue, il faut ingérer des doses de plus en plus élevées pour obtenir
les mêmes effets qu’au début du traitement. Par ailleurs, lors de leur sevrage[31], ils
provoquent des problèmes de « manque »[32], en
particulier surtout, si le sevrage a été brutal. Ce dernier cause alors le
phénomène désagréable de « céphalées de rebond », assez douloureuses,
voire d’autres douleurs indésirables (dont parfois des douleurs dorsales, des
douleurs dans les membres etc.).
Sinon, pour certaines d’entre nous, les
céphalées de tension chroniques peuvent se manifester par des contractions
musculaires intenses (contractures pouvant être très douloureuses), totalement
automatiques et autonomes, et surtout totalement rebelles à toute thérapie
_ en particulier aux techniques de
relaxation et d’hypnose _ ou aux traitements médicaux. Il semble
qu’il n’existe pas de médicaments qui arriveraient à desserrer suffisamment
l’étau de la contracture musculaire[33]. C'est
à-dire que certaines céphalées de tension chroniques et anciennes sont
particulièrement pharmaco-résistantes. Or ces derniers cas sont
insuffisamment décrits dans la littérature (nous en reparlerons).
Au sein de l’association « Papillons en
cage », plusieurs membres ont effectués successivement et régulièrement :
a)
Des
exercices de relaxations prolongés _ tels que training autogène, biofeedback,
hypnose, autohypnose, exercices de relaxation avec étirement des muscles du cou
etc.,
b)
Des
thérapies analytiques et comportementales (effectuées sur plusieurs années).
=> Sans aucun réel résultat qui pourrait contribuer
réellement à la diminution durable et notable de leur céphalée.
3.2
Inefficacité des psychothérapies et des méthodes
de relaxation
Note : Bien sûr, certaines thérapies
analytiques apportent certains soulagements moraux _ dont celles de certaines
douleurs morales _ ou des solutions à certains problèmes psychologiques
(névroses, addictions etc.), mais dans l’immense majorité des cas, elles ne réduisent,
pas d’un iota, l’intensité de la céphalée ( !).
Quand la douleur et la céphalée de tension
est trop forte toute relaxation est impossible. Certains membres peuvent
réussir, par exemple, à obtenir une grande relaxation de tout le corps _ avec
relâchement de tous les muscles du corps (et induction de bâillements) _, sans
jamais toutefois pouvoir parvenir, un seul instant, à diminuer la tétanisation
des muscles crâniens (cause de leur douleur).
3.3 Inefficacité des psychotropes & problèmes posés par leur usage
Le plus souvent, pour le traitement des
céphalées de tension, les médecins utilisent des médicaments psychotropes[34], en
général à base de substances psycho-actives, proches des alcaloïdes, appelés
benzodiazépines, sauf à quelques exceptions
_ tels qu’antidépresseurs (comme le Laroxyl …), antiépileptiques (Rivotril
…), neuroleptiques (Solian …), anxiolytiques …. Ils ne doivent toujours être
délivrés que sur prescription médicale. Le malade devrait être en étant informé
sur les effets à en attendre et sur les
effets secondaires (ce qui est souvent loin d'être le cas)[35].
Le médecin devrait faire en sorte que le
malade se sente impliqué et actif dans une démarche de soin pour aller mieux :
se prendre en charge, changements d'hygiène de vie, ouverture aux autres,
psychothérapie, etc. (ce qui est aussi loin d'être le cas).
Sinon, les psychotropes à haute dose, peuvent procurer, au patient,
un relatif voire un réel effet antidouleur.
Mais leur effets secondaires, surtout à haute doses, sont
loin d’être anodins ou agréables[36]
[37]. Le plus souvent, malheureusement, ces effets
secondaires peuvent nettement contrebalancer les effets antidouleur de ces
derniers (voir ci-après) :
a) la plupart des psychotropes réduisent nettement les capacités
intellectuelles, détériore la mémoire _ on parle de troubles mnésiques _, la
capacité d’apprentissage, voire abrutissent réellement _ on parle de baisse de
la vigilance et des performances attentionnelles. Avec eux, l’élocution du
patient devient plus difficile, l’expression orale est laborieuse, le malade
cherche continuellement ses mots. Il oublie fréquemment. Par exemple, il oublie
régulièrement le nom de l’interlocuteur avec qui il parle. Il est comme dans
une sorte de brouillard intellectuel permanent[38].
Ces médicaments induisent souvent le désintérêt, incapacité à l’action.
b) ils induisent presque toujours, à haute dose, une forte somnolence,
c) voire, ils peuvent
induire des hypersomnies « irrésistibles » (comme avec le Solian …).
d) Ils agissent sur l’humeur, certains peuvent rendre boulimique (le fait
d’avoir toujours faim, comme avec le Solian) ou au contraire anorexiques (le
fait d’avoir perdu l’appétit, anorexie, comme avec Epitomax …),
e) ils peuvent induire
le fait d’avoir la bouche pâteuse et yeux constamment secs (comme avec le
Laroxyl),
f) voire, ils peuvent
induire des phases psychotiques (comme des crises de paranoïa, comme
l’anticonvulsivant Epitomax, surtout en cas de sevrage brutal de ce dernier …).
g) Les neuroleptiques peuvent induire des tremblements involontaires
permanents (surtout avec les neuroleptiques).
h) A hautes doses, ils
peuvent aussi causer des céphalées de rebond ou des dépendances, voire des
nausées.
i) Les psychotropes
à hautes doses (en cas de surdosage) sont toxiques, pouvant causer des embolies
cérébrales.
j) Même à long terme, les antidépresseurs peuvent même faciliter le passage
à l’acte. Ils peuvent même être utilisés comme auxiliaire au suicide.
Il est d’ailleurs
souvent facile de détecter, à son élocution, quand une personne prend ou non
des psychotropes.
Ajoutons encore que les
psychotropes « shootent » mais ne font ni « planer »
ni atteindre
Au sein de l’association « Papillons en
cage », la plupart des personnes sous psychotropes reconnaissent que
les capacités antidouleur de ces derniers _ même avec les psychotropes
antidépresseurs ou antiépileptiques préconisés pour le traitement des douleurs
neuropathiques (c'est-à-dire d’origine inconnues), tels que le Neurotin ou le
Lyrica _ restent toujours insuffisantes, quelque soit le médicament
psychotrope considéré.
Les psychologues spécialistes de la douleur
savent que les douleurs intenses bloquent, chez la personne souffrante,
toute capacité de concentration, de mémorisation et de réflexion. Et donc, par
conséquence, une douleur intense est très handicapante intellectuellement et
professionnellement.
Les psychotropes _ surtout à haute dose _, en
brouillant les capacités intellectuelles du malade, augmentent encore le
handicap intellectuel du malade[41] [42].
Les céphalées de tension chroniques peuvent
être permanentes ou voire réapparaître de façon intense, sur des durées dépassant
nettement plusieurs dizaines d’années.
Par exemple, au sein de l’association
« Papillons en cage », plusieurs personnes ont des céphalées
présentes depuis plus de 20 ans, et même une personne dont la céphalée de
tension est apparue à l’âge de 16 ans et qui est présente depuis plus de 50
ans.
Or sur ces très longues durées, on
peut « facilement » épuiser l’efficacité de toute une vaste panoplie
de médicaments.
Par exemple à cause des effets d’accoutumance, des médicaments pris le matin
qui avaient un effet jusqu’à 18h, n’ont plus par exemple, au bout de 6 mois,
qu’un effet que jusqu’à 14h.
C’est pourquoi, à cause des aspects décevant
de tous psychotropes et des effets d’accoutumance, beaucoup de ceux qui
souffrent de céphalées de tension très anciennes, en général, renoncent à la
longue, finalement, à prendre tout médicament.
Les psychotropes ne sont donc pas la panacée
universelle, attendue par les malades, pour le traitement des céphalées de
tension.
Ajoutons que le recours systématique aux
psychotropes, pour traiter les affections psychiatriques ou psychologiques, ont
régulièrement été dénoncés, à de nombreuses reprises, par exemple, par le
Professeur, psychiatre et chef de service à l’hôpital de Caen, Edouard Zarifian[43], le
docteur Philippe Foucras de l’association Formindep[44], le
docteur Philippe Even _ pneumologue, Professeur émérite à l'Université Paris
Descartes, président de l’Institut Necker, ayant participé à des commissions
scientifiques de l’INSERM et du ministère de la Santé[45] _,
certains rapports de commissions sénatoriales[46], la
revue Prescrire[47]
[48] etc.
Certaines personnes peuvent mal supporter
certains traitements. Elles peuvent manifester des sortes
« d’intolérances » médicamenteuses, comme, par exemple, avec les
dérivés morphiniques _ avec la codéine etc… _ pouvant, par exemple, provoquer
des nausées, des vertiges, des malaises, des effets psychiques … chez elles.
Notons que les céphalées de tension de
certains malades peuvent être aggravées par les psychotropes et par tout médicament touchant au système nerveux central (tels que
les benzodiazépines). C’est en particulier le cas des traitements à base de
Laroxyl (qu’il soit en goutte ou injectable), un psychotrope antidépresseur, sensé avoir un effet antidouleurs,
très souvent prescrits pour les céphalées de tension.
En
résumé :
a) En général, les médicaments prescrits (c'est-à-dire
les psychotropes) sont insuffisamment efficaces face aux céphalées de tension
fortes et/ou anciennes.
b) Les psychothérapies et les méthodes de
relaxation se révèlent inefficaces pour la plupart des céphalées de tension
chroniques, surtout si elles sont anciennes, sauf quelques cas très rares (voir
cas de Christine plus loin).
b) Donc, quand les médicaments n’ont plus
d’effet et pas d’effet suffisamment efficace, face à la douleur, il faut alors
tenter de trouver ou de se reposer sur d’autres armes (nous en reparlerons plus
loin).
3.4 Optimisme excessifs concernant la possibilité de soigner les céphalées de tension chroniques
Pourtant, face à ce constat peu rassurant,
nous sommes fort surpris par l’optimisme déclaré d’un certain nombre de
praticiens.
Les malades sont souvent confrontés à des déclarations très (trop)
optimistes de la part des médecins et des centres antidouleur, sur leur
capacité à soigner la douleur du malade. Si l’on croit les déclarations
optimistes des médecins, on arriverait à soigner les céphalées de tension,
grâce à la mise au point du bon cocktail mélangeant adroitement usages de
psychotropes, de psychothérapies, la psychanalyse et la participation active du
malade.
Le
Père Jean-Yves THERY[49], relate
bien ce problème, dans son texte "un double regard sur la douleur
chronique", paru en mai 2009 : « […] Quant à la prise en charge médicamenteuse potentielle, l’expérience montre que certaines douleurs
chroniques sont très rebelles aux médicaments, voire même « pharmaco-résistantes ». Médecins et
patients sont alors fort démunis. […
il faut signaler] caractère [ . . . ]
trompeur d’un certain
discours médical trop répandu qui laisse penser que de nos jours la médecine est en mesure
d’apaiser toutes les douleurs. ».
« J’observe tout d’abord que le corps médical, dans le souci louable de sensibiliser
les patients
à la lutte contre la douleur, tient
souvent un discours trop optimiste et pas assez réaliste sur
Dans un premier
temps, un tel discours met plutôt en confiance : on se dit qu’une solution va
pouvoir être apportée à notre problème de douleur. Mais assez vite il faut
déchanter. Certes, ces dernières années, on a progressé dans la prise en charge
de
Dans la préface de son livre « Céphalées de tension, rumeur et réalité »,
page 2, le Docteur Lantéri-Minet partage malheureusement le même optimisme
« scientiste » en affirmant « [la] prise [de la céphalée de
tension] en charge est efficace si elle est conduite selon une stratégie
adaptée individuellement ».
Dans la littérature,
on trouve encore bien d’autres déclarations étonnantes comme celle-ci : « Les
psychotropes, les psychothérapies
et la psychanalyse ont l'objectif commun
de restituer ce cerveau magicien, cette
fonction hédonistique [i.e. de recherche du plaisir] de la pensée. »[53].
Or si les psychothérapies et la psychanalyse pourraient peut-être rétablir le « cerveau
magicien » ( ?), cela
n’est certainement pas le cas avec les psychotropes (voir nos nombreux constats
à ce sujet, dans ce document).
3.5 Les raisons de cet optimisme excessif : le schéma explicatif classique
Dans le schéma explicatif classique, tel
qu’exposé par le site canadien « Santé Ontario » « les céphalées de tension sont provoquées par
divers facteurs comme une tension dans le cou, le stress et l'anxiété »[54]. Si
l’on croit ce schéma explicatif « le
traitement exige, dans la mesure du possible, l'élimination de la situation stressante. La prise d'analgésiques
vendus sans ordonnance comme de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène, une période de détente, du repos, un
ajustement de la posture et un régime d'exercice peut contribuer à soulager
et à prévenir les maux de tête ».
Selon Jacques Touchon[55] [56] « L'état
de tension responsable de la céphalée est la conséquence de modalités
particulières de réaction au stress associée en règle à un état d'anxiété de
fond. Le terme "tension" s'applique autant à la sphère
psycho-émotionnelle qu'au système musculaire. [ . . . ]
Il existerait au sein de chaque muscle une
zone "gâchette" dont la mise en tension provoquerait une douleur au
niveau du muscle et même à distance de celui-ci[57].
Ces zones pourraient se constituer à la suite de traumatismes même minimes, secondaires
par exemple au maintien d'attitudes inadéquates. La douleur est cause de
contracture, elle-même à son tour douloureuse, instaurant ainsi une
relation causale réciproque "douleur = contracture" se pérénisant. La
réaction au danger, ou au simple stress implique des modifications de
postures manifestées entre autres par une hypertonie des muscles péri-céphaliques.
La répétition des stress, l'état d'hyper-vigilance inquiète le sujet anxieux
vont entretenir cette tension musculaire péri-céphalique, mobilisant
éventuellement ces zones sensibles qualifiées de "gâchettes", et
ainsi faire naître et perdurer une symptomatologie douloureuse. »[58].
Donc selon J. Touchon [selon ce schéma
explicatif] « la symptomatologie algique [douloureuse] est surestimée[59] ».
Cela serait, par exemple le même schéma
explicatif que la douleur de dos : suite à une mauvaise posture, on aurait
une douleur de dos. Puis par crainte de cette douleur, on se contracterait
encore plus, par réaction, ce qui provoquerait une posture encore plus
inadéquate, qui renforcerait encore plus la douleur de dos, dans une sorte de
cercle vicieux sans fin.
Selon J. Touchon, les « les moyens
thérapeutiques efficaces dans ce type de céphalées sont essentiellement
représentés par les psychotropes (anxiolytiques et surtout antidépresseurs)
et les techniques de relaxation. ».
Voici encore, par exemple, ce qu’écrit sur
les malades et leurs céphalées de tension, le Collège des Enseignants de
Neurologie en 2002 :
« Céphalées de tension dites « psychogènes[60]
» :
- absence de retentissement sur la vie
quotidienne et sommeil normal, contrastant avec une gêne décrite comme
intense, [ … ]
- des troubles psychologiques (anxiété
chronique le plus souvent), plus rarement trouble psychiatrique authentique
(état dépressif, personnalité hypochondriaque) sous-tendent en
général ce type de céphalées »[61].
L’affirmation de « absence de retentissement sur
la vie quotidienne » est une absolue contre vérité quand la
céphalée est chronique [62].
Or ce genre d’affirmations formate l’esprit
des étudiants en médecines.
Dans un livre traitant surtout
de la migraine, mais donnant une petite place est consacrée aux céphalées ayant
une origine névrotique et psychosomatique, paru en 1981, intitulé "Vaincre sa migraine", les Dr Claude Loisy et Sydney Pelage tous les deux co-fondateurs du
Centre International de la Migraine à Vichy[63],
indiquent :
« Pour Lance[64], le migrainologue
australien que nous avons déjà cité, la diminution du flux sanguin dans le
cerveau au début de la crise, serait la première mesure de protection avant le
signal impératif de
Le traitement qu’avait alors
proposé à l’époque le Docteur Loisy, à l’un des membres de notre association
était évidemment à base d’antidépressifs et de décontracturants, remèdes que ce
membre, journaliste, n’a absolument pas pu supporter. Si ce type d’explications
peuvent apparaître satisfaisantes, les résultats sont toujours absents et c’est
bien ce qui ressort des différents témoignages des membres de notre association.
Ce n’est que récemment que la qualification
de « psychogènes » pour les Céphalées
de tension est en train d’être remis en cause. Dans son livre « Céphalées de tension, rumeur et
réalité », page 60, le Docteur Lantéri-Minet, indique « logiquement, la tendance actuelle est donc
d’évaluer la gravité d’une maladie en fonction de l’importance de la qualité de
vie qu’elle induit. A ce titre, la céphalée de tension peut être une maladie
grave, notamment chez les sujet souffrant d’une forme épisodique et, à
fortiori, chronique ». Pages
32 et 33, il indique encore « L’ensemble
des travaux expérimentaux réalisées sur la céphalée de tension conduit à
écarter un facteur causal unique et tend à faire envisager ce que l’on appelle
médicalement un « modèle multifactoriel », traduisant le fait que la céphalée de tension
résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. […] La céphalée de
tension épisodique serait essentiellement due à des facteurs musculaires […] La
céphalée de tension chronique impliquerait davantage un dysfonctionnement du
système nerveux central »[66] [67].
Ces affirmations ci-avant sont une réelle
avancée sur la compréhension de la maladie.
Pourtant, malgré tout, page 11, il continue
de s’aligner aussi sur les affirmations de la « Headache Classification Subcommittee of International Headache society »,
prétendant que les céphalées de tension sont, au niveau de leur intensité,
« mineure à modérée ».
Or tous les malades et l’auteur contestent
très cette dernière affirmation ne correspondant pas à leur vécu quotidien. De
toute façon, la permanence de la douleur annule
le ressenti de « modéré ». Et le plus souvent, la pratique fait
que corps médical accepte le qualificatif « modéré » pour la céphalée
de tension par rapport à la migraine, car cette dernière, elle, ne dure pas.
Donc selon le schéma explicatif classique,
encore répandu chez la majorité des médecins, la cause serait essentiellement
due à l’anxiété (ou la dépression) et la crainte anxieuse du symptôme
douloureux renforcée par cette crainte. Il suffirait donc de faire en sorte que
le malade pour le malade se focalise moins sur sa douleur (grâce par exemple,
par la prise de psychotropes) pour que la sensation douloureuse disparaisse
d’elle-même.
Pourtant, pour certains malades chroniques,
la prise d’antidépresseurs et de relaxants ne marche pas.
3.6 L’idée qu’une douleur chronique ne peut être très douloureuse
Une autre idée qui s’est maintenue dans
l’inconscient collectif y compris chez les médecins, depuis des millénaires,
est qu’une douleur chronique durable ne peut être tout le temps très
douloureuse … sinon, la personne se serait suicidé depuis longtemps[68]. Et
s’il ne suicide pas, c’est qu’elle ne doit pas être très douloureuse.
Selon
le père Jean-Yves Théry, cité plus haut : « [Il y a] durcissement de cette distinction
[entre les douleurs aigües
et les douleurs
chroniques] ; comme si les seules douleurs
méritant l’attention du corps médical étaient les douleurs aigües, tandis que les douleurs chroniques
devraient être systématiquement relativisées et minimisées. A entendre certains médecins, on
a vraiment le sentiment que ces douleurs, dont le caractère lancinant et même torturant est pourtant un fait d’expérience, ne sont pas vraiment prises en compte[69]. ».
L’origine de cette minimisation des
souffrances durables est liée à des conceptions philosophiques très anciennes,
restant encore prégnante dans l’idéologie médicale actuelle (comme nous le
montrerons dans l’annexe : « 9.1. Origine philosophique de la
minimisation des douleurs chroniques »).
En fait, si le malade ne se suicide pas,
c’est parce qu’il a progressivement développé, au cours du temps, des
stratégies de survie de plus en plus élaborées, que nous décrirons plus loin.
3.7 Les conséquences thérapeutiques de ce schéma explicatif
Conséquences de ce schéma explicatif, le
médecin n’accordera, le plus souvent, que peu d’attention à la plainte du
malade, afin de ne pas accorder crédit à la plainte et de ne pas
« enfermer » le malade dans son « cercle vicieux anxieux »
et pour ne pas « entrer dans son jeux » (dans son hypocondrie).
Certains médecins n’hésitent pas
éventuellement à prescrire des placebos aux malades souffrant de céphalées de
tension chroniques[70].
Les céphalées de tension ont tellement
mauvaises presse que par exemple, que peu de médecins leur porte une vraie attention. Voici quelques exemples
de conséquences du peu de considération des médecins pour cette maladie :
1)
Un
malade souffrait depuis 25 ans de céphalées terribles, se présentant comme des
céphalées de tension. Elle avait mis sur le compte d’une céphalée de tension et
d’une hypocondrie, pendant 25 ans, par des spécialistes de
2)
L’Arnold-Chiari[72] d’une
patiente, Valérie, habitant le sud de la France et qui avait contacté
l’association « Papillons en cage », il y a deux ans, avait été
constamment diagnostiquée et mise sur le compte d’une céphalée de tension, liée
à une dépression, voire à une hypocondrie, durant 9 ans. Elle a pu être enfin
diagnostiquée, selon le bon diagnostic correct, suite à un IRM et suite aussi à la forte persévérance de cette
personne, qui n’avait pas cessé de relancer les médecins sur son problème,
d’autant qu’il s’était aggravé au bout de 9 ans.
Sinon, quand on indique qu’on souffre de
céphalées de tension chroniques, les médecins ou psychothérapeutes ne cessent
pas _ sans fin _ de chercher en vous systématiquement :
a)
la
dépression cachée,
b)
l’anxiété
cachée,
c)
la
culpabilisation inconsciente.
Au début, ces pistes pourraient être
intéressantes pour le malade et éventuellement l’aider. Mais à la longue, ce
genre d’investigation répétitive (ou ce genre de doute systématique sur votre
santé mentale) devient souvent pénible, pour le malade, surtout par le fait
d’avoir sans cesse à se répéter devant tous les praticiens consultés et d’être
souvent soumis sans cesse aux mêmes épreuves ou tests, pratiqués par les
médecins. Et à la fin, le malade peut avoir envie de « péter les
plombs »[73].
Le père Jean-Yves Théry, cité plus haut,
s’interrogeait, dans le même texte : « Et, dans le cas précis des
céphalées chroniques de tension,
pour quelles raisons s’acharne-t-on à « psychiatriser » le patient, c’est-à-dire
à le traiter par des psychotropes (antidépresseurs ou neuroleptiques) ou à le
renvoyer à des techniques de relaxation et d’hypnose qui sont loin d’avoir fait la preuve de leur
efficacité ? ».
A aucun moment, les praticiens ne peuvent
imaginer ou même envisager que :
a)
l’on
peut énormément souffrir d’un mal de tête et pourtant rester intérieurement
parfaitement calme et ne manifester aucune anxiété consciente apparente.
b)
Que malgré une forte douleur éternelle, on peut arriver
quand même tenir,
justement par des techniques de survie, telles que décrites plus loin dans de
document (et qu’au cours du temps, l’on a cessé de développer des stratégies de
survie de plus en plus élaborée).
Quand la personne ne peut pas se défendre
parce que accablé par des céphalées particulièrement lancinante, le médecin, se
basant juste sur des apparences, ne verra dans le malade que quelqu’un manquant
de confiance (ou d’affirmation) en soi (sans imaginer que le malade puisse ronger
son frein attendant que sa crise puisse enfin s’arrêter ou s’atténuer).
Bien des neurologues ferment toute ouverture
à tous autres traitements non classiques[74]. Ils ne
laissent le choix au malade qu’entre la prescription des psychotropes ou les techniques
de relaxation (c'est-à-dire qu’il lui ferme, en fait, toutes les portes et
toute possibilité de s’en sortir). Ils arrivent même qu’ils vous forcent la
main concernant la prise de psychotropes, vous menaçant de ne rien faire (de
vous laisser tomber), si vous ne les prenez pas.
Ils éliminent d’un revers de la main, le
traitement par le Botox, pour les raisons suivantes (voir ci-après) :
a) parce qu’ils pourraient contribuer à ce que
la tête dodeline, tombe, du fait que la tête du malade ne serait que plus tenue
par les muscles péri-crâniens[75],
b) parce qu’il n’aurait pas fait ses preuves
au niveau efficacité (bien qu’il ait été prescrit partout dans le monde, il est
vrai, avec des résultats inégaux)[76].
Ils refusent de mettre en place une
possibilité de mesure de la douleur par électromyographie[77] [78]. Cette
possibilité permettrait pourtant de prouver enfin scientifiquement (et aux yeux
du monde) que les céphalées de tension chroniques sont loin d’être « légères
à modérées » ou imaginaires (ce que croient pourtant encore beaucoup
de médecins malheureusement)[79].
Ils ne tentent pas, non plus, de nouvelles
voies de traitements, qui pourtant pourraient se révéler sérieuses _ comme, par
exemple, des micro-injections « mésothérapiques »[80],
péri-crâniennes (dans les muscles péri-crâniens), de myorelaxants injectables
(tel que le Myolastan, Décontractyl sous forme injectable …) ou de produits
injectables permettant de lutter contre crampes musculaires (tel que la Quinidine
sous forme injectable …) etc. …
Sinon, il n’y a pratiquement aucune
recherches de fond ou fondamentales sur les céphalées de tension, dans le monde,
hormis au « Danish Headache Center »[81], et
aucun recherche sur le sujet en France _ même par le biais de thèse de 3ème
cycle, conduites par des étudiants chercheurs ayant terminé leur études de
médecines.
Il n’y a eu aucune avancée scientifique
majeure sur le sujet, dans le monde, depuis plus de 40 ans.
Alors qu’on a déjà trouvé des médicaments
ciblant la douleur des migraines et diminuant celles-ci avec efficacité, il n’a été découvert, jusqu’à maintenant,
aucun médicament équivalent aussi efficace ciblant la douleur ou diminuant
efficacement les contractions musculaires, dans le cas des céphalées de
tension chroniques.
Les médecins n’envisagent pas, non plus, une
seule fois, qu’entre la cause déclenchante originelle, survenue souvent il y
plus d’une dizaine ou plusieurs dizaines d’années et maintenant, le malade a pu
énormément évoluer au niveau de sa personnalité et ne plus être la personne
anxieuse ou dépressive, manquant de confiance en elle, comme souvent décrite
dans
La plupart des médecins ne rassurent pas
les malades sur leur maladie. Par exemple, ils ne convainquent pas le patient,
surtout s’il est d’une nature anxieuse, que même si sa maladie est douloureuse,
elle n’est pas mortelle ou grave (par exemple, ils pourraient leur dire qu’aucune
tumeur maligne ou sclérose en plaque est impliquée. Que surement, que chez certains
malades, c'est leur façon d'évacuer un stress, comme certains ont des réactions
cutanées _ psoriasis, etc. ... _. Que cela est ou peut être aussi chez vous
votre « point fragile »). La douleur, par son caractère primaire, par
son intensité réelle, est impressionnante, mais elle ne tue pas (en tout cas
pas directement).
Le plus souvent, la consultation est expédiée
en moins de 10 mn, sans
fournir, au malade, aucune explication sur l’origine de son mal. Elle
s’achève d’ailleurs toujours par la prescription de psychotropes, voire par la
recommandation de séances de relaxations… et c’est tout[82].
« Conforté par le point de vue » du
corps médical, qui prend peu au sérieux le mal, l’ANPE (actuellement « Le
Pôle emploi »), se désintéresse totalement des malades souffrant de
céphalées de tension (y compris celles particulièrement anciennes, pouvant être
constantes et présentes chez le malade, durant 10 ans ou plus). Aucun
aménagement professionnel (tel qu’emploi aménagé ou emploi à mi-temps, télétravail
etc.), n’est proposé.
En général, les rendez-vous ont toujours la
forme suivante : le conseiller ANPE et le demandeur se regardent souvent
en chien de faïence. Le conseiller ne propose rien. Jamais aucune suite n’est
donnée à la demande du demandeur. Le rendez-vous étant le plus souvent vite
expédié en moins de 10 mn[83]. Le
conseiller note, à chaque fois dans sa base de données, que « le
demandeur, à cause de ses céphalées, réclame un emploi aménagé »[84] [85].
Ou encore (parfois ?) certains
conseillers ANPE, lui conseilleront de se faire régulièrement « porter
pâle » avec l’aide d’un médecin complaisant[86].
Le malade, quant à lui, ne comprend pas qu’au
lieu de soigner sa douleur, ce qui est la priorité pour lui, on cherche, au
contraire, sans cesse (systématiquement), la « petite bête » chez lui,
le médecin délaissant alors la priorité du traitement de la douleur _ qui
devrait pourtant être la priorité pour le malade _, au profit de la
recherche et du traitement d’une possible affection psychiatrique (telle qu’anxiété
chronique, état dépressif, personnalité hypochondriaque …) chez le malade.
3.8 Confrontation de ce schéma explicatif avec les faits
Si le mal de tête ne résulte que d’une mauvaise
posture provoquant des contractures musculaires, comment se fait-il que,
du fait de ces maux de tête, le malade :
1)
puisse
perdre la mémoire à répétition ?
2)
puisse
perdre son emploi, à de nombreuses reprises (par exemple, plus de 10 fois au
cours d’une vie) ?
3)
soit
obligé d’interrompre ses études, car il ne peut plus passer un seul examen ou
suivre des cours ?
Comment se fait-il qu’étant en vacances et
étant dans une occupation qui puisse le distraire de son mal, alors qu’il
n’aucune cause d’anxiété immédiate (ni menace sur son emploi, ni problèmes
familiaux), le malade ressente toujours sa douleur aussi forte et inchangée (y
compris lors d’efforts physiques intenses) ?
Au sein de l’association, nous avons, par
exemple, le cas d’un prêtre souffrant de terribles céphalées de tension, depuis
plus de 19 ans, céphalées de tension
graves qui l’ont absolument empêché de poursuivre son ministère dans un petit
village.
Comment se fait-il que des douleurs soi-disant
modérées peuvent causer de vrais handicaps intellectuels, comme dans le cas
de ce prêtre _ qui pour l’instant est hébergé depuis des années dans une maison
de repos dépendante de son institution religieuse ?
C’est bien la preuve que la douleur des
céphalées de tension chronique peut être forte. Ce n’est pas juste une douleur,
pour laquelle si on n’y pensait pas, alors on pourrait s’en débarrasser à la
longue, par exemple par ses efforts sincères. Si cette solution marchait
pour tous les « céphaleux » de tension, cela se saurait dans le
milieu des « céphaleux » et
tous les « céphaleux » l’auraient déjà appliquée ou auraient suivi le
traitement adéquat.
En fait, l’expérience montre que toutes les
techniques comme
Sinon, enfin, comment se fait-il que malgré
des milliers de soins qu’ont tentés ceux qui souffrent depuis plusieurs
dizaines d’années[87], ces
derniers malades n’arrivent jamais, à aucun moment, à résoudre leur mal, malgré
leur effort et leur bonne volonté ? Tous ces malades seraient tous de
mauvaise foi ou/et psychotiques ?
Il faut donc « casser » ces schémas
explicatifs classiques qui n’expliquent pas les faits précis ci-avant.
Car ici les critères du rasoir d’Occam[88] ne
semblent pas du tout s’appliquer pas ici dans ces cas précis ci-avant.
Si la
cause est psychologique, alors que les médecins fournissent aux malades la clé
psychologique de leur maladie, c’est à dire la clé qui leur permette de
résoudre le mal définitivement. C’est tout ce que les malades demandent. Il
est vrai qu’ils ne la connaissent pas. Que les médecins se donnent alors une obligation
de moyens, prévus par la loi, tels que, par exemple, a) la prescription de médicaments
les plus efficaces et invalidants ou perturbant le moins possible les
éventuelles vies sociales et professionnelles du malade, b) et si les
médicaments ne marchent pas, un vrai soutien psychologique réel et sincère et
une vraie écoute, c) un soutien social, y compris une aide COTOREP, si la maladie
est très invalidante.
En annexe, est exposé l’exploration de possibles
autres pistes explicatives concernant les causes des céphalées de tension
chroniques.
3.9 Différentes formes d’handicaps causés par les céphalées de tension chroniques
Nous
avons vu que les céphalées de tension chroniques particulièrement fortes :
- Peuvent provoquer des pertes
d’emplois à répétition, des incapacités à en retrouver,
- Peuvent contribuer à faire
capoter des études ou faire louper des examens.
ð
bien
que la personne malade s’accroche et fait preuve de courageuse (durant ses
études, sur son lieu de travail etc.). En général, le malade ne peut rien faire
et ne peut pas du tout se défendre contre ses céphalées ou contre les formes
paroxysmiques de leurs céphalées de tension.
Au sein de notre association, il y a au moins
5 personnes, étant au chômage depuis plusieurs années, totalement incapables de
travailler du fait de la force de leur céphalée, étant toute dans un état de
précarité financière extrême et aussi souvent de grand désespoir sur leur
avenir[89] [90] [91]. Alors
pour s’en sortir financièrement, ils multiplient les CDD, les petits boulots
précaires (Intérim, baby-sitter, marketing téléphonique à mi temps …). L.,
journaliste dans un petit journal vendéen, malgré son « brouillard
intellectuel », a toujours réussi à livrer ses articles, à son journal, à
temps, aidé en cela, par son expérience et son professionnalisme, compensant
alors son « rideau intellectuel ».
H., mère au foyer, divorcée, vit du RMI,
depuis 3 à 4 ans, d’allocations pour ses 4 enfants et d’une petite aide
financière de son frère footballeur au club de Sochaux.
Elles causent d’autres formes d’handicaps.
Elles peuvent contribuer à donner
l’impression que le malade est lunatique ou qu’il ne s’intéresse à rien.
E. encore indique, par exemple, « Mon but est de fonder famille et
rencontrer quelqu’un. Or à cause des céphalées, je suis souvent excédé, je pète souvent un câble. J’explose souvent. Mes céphalées me
font capoter mes relations amoureuses. Je ne suis jamais à 100% avec les
gens. Avec mes céphalées, ma libido est
ralentie et plus faible. ». J. confirme « cela me gâche réellement toute relation
sexuelle ».
Les céphalées de tension d’un des conjoints
peuvent être à l’origine de divorces ou de séparations ou de menaces réelles et
sérieuses sur la pérennité du couple, à terme[92]. C’est
un handicap vraiment lourd.
Avoir à lutter sans cesse contre ses
céphalées, avoir un mauvais sommeil de leur fait, fatigue à la longue
physiquement, et on devient plus sensible aux bronchites en tout genre.
3.10 La difficulté d’en parler
A cause des préjugés médicaux et sociaux, le
malade a du mal à parler de son mal de tête qui l’assaille sans cesse.
Une des difficultés pour le malade, est que sa
maladie n’est pas reconnue (au moins à sa juste mesure), par le corps médical
ou le corps social. Pour la société,
un mal de tête, comme les migraines, ne peut dure que quelques jours au
grand maximum. Ils ne peuvent imaginer qu’un mal de tête pourrait être
éternel, voire être en permanence très fort, alors qu’on ne trouve aucune cause
précise.
Estelle confirme que « les gens oublient souvent mon problème, ils
ne comprennent pas ».
Le père Jean-Yves Thery souligne[93] « […] certaines paroles peuvent blesser
la personne souffrant de douleur chronique qui, il est vrai, est plus sensible
que d’autres. Ainsi, par exemple, dans les contacts de la vie quotidienne, il
est des questions auxquelles j’ai pris l’habitude de ne plus répondre que par
un sourire silencieux. Ce sont les questions du genre : ça va ? Ou ça va bien ?
[…] j’ai pris l’habitude de poser une autre question qui me semble plus
respectueuse de la personne : comment allez-vous ? Ou, plus familièrement :
comment ça va ? Et si l’on me pose cette même question, je réponds volontiers :
Ce n’est pas terrible, mais je tiens bon ; et toi, comment vas-tu ?
Un peu
dans la même ligne, il y a des personnes qui disent : Ah, je trouve que vous
avez meilleure mine, c’est certainement que vous allez mieux ! Ce genre de
propos, très fréquent, finit par être lassant. J’ai souvent envie de répliquer
: Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? Comment savez-vous ce qui se cache
derrière les traits de mon visage ? C’est
déjà dur de devoir constamment faire comme si l’on avait pas mal. On n’a
vraiment pas besoin d’entendre en plus des remarques certes bien intentionnées mais complètement décalées
par rapport à ce qu’on vit réellement. Le mieux est sans doute, là encore, de
ne répondre que par un sourire. Mère Terésa ne disait-elle pas : Si l’on savait
! Mon sourire est un manteau qui cache bien des misères. ».
Sinon, les « bonnes âmes » ont fréquemment leur avis « bien
intentionné » sur la question : « tu stresses trop. Tu
devrais moins stresser. N’y pense pas. C’est parce que tu y penses trop, que tu
te focalises trop sur elle, que tu ressens encore plus
Et tout cela ne marche pas, alors les bonnes
âmes penseront que le malade n’est vraiment pas de bonne volonté et n’a pas
fait tous les efforts nécessaires (pour sa guérison). Peut-être, se
convainquent-ils alors que le malade trouve-t-il un avantage à se maintenir
dans son mal et prend prétexte à ce mal, pour se faire plaindre ou bien pour
justifier les insuccès de sa vie !
Sinon, lié à des préjugés prégnant au niveau
social, les maladies (ou douleurs) invisibles _ celles qu’on n’arrive
pas à prouver scientifiquement _ ne sont, en général, pas prises en sérieux.
Les maladies non prouvables, par la science, sont souvent prises pour des illusions
de l’esprit par les médecins _ et donc considérées comme des maladies
psychiatriques ou au minimum comme des névroses (par exemple, l’explication
médicale courante est que la personne se focalisation excessivement
obsessionnellement sur un « petit mal » ou « petit bobo »)
_ et donc sont traités en conséquence, c’est à dire par le biais des
psychotropes.
Et le malade se retrouve donc, en général,
très seul face à sa douleur, sauf s’il est heureusement soutenu par ses proches.
Il
y a donc souvent honte ou pudeur à en parler et surtout il y a la peur d’affronter
le regard social et les préjugés.
Estelle
indique « Avant d’en avoir moi-même
[des céphalées], je les voyais comme une faiblesse pour toute personne qui en
avait. ».
Il y aussi la peur réelle de se faire sans
cesse « renvoyer dans les cordes » ou simplement ignoré, voire
méprisé, par les médecins. Souvent d’ailleurs certains médecins culpabilisent,
ceux qui souffrent, de se plaindre[94].
Si l’on se plaint, on rentre alors dans le
« schéma hypocondriaque »[95]. Au
contraire, si on a pris l’habitude de ne pas se plaindre, alors les gens
pensent que ce n’est pas grave. Le malade se sent « piégé », par cette
double injonction contradictoire (ce qu’on dénomme en anglais « double bind »).
Et du fait que la personne n’en parle pas et
ne peut pas en parler autour de lui ou après du corps médical, cette
impossibilité d’exprimer son mal l’enferme encore sur elle-même et dans sa souffrance.
Le fait de ne pouvoir en parler empêche
la rencontre thérapeutique entre le malade et le médecin.
3.11 Les conséquences de l’échec du corps médical
Il
y a sans conteste un échec manifeste et réel du corps médical à résoudre ou
soigner ce mal, cela actuellement en 2009, à quelques rares exceptions près
(dont le cas de Christine que nous exposerons plus loin).
Beaucoup
de malades, ont cru au départ, tout comme le grand public, à la toute puissance
de
Plusieurs personnes,
ayant contacté l’association, déprimés par ces échecs, relatent avoir fait état de tentatives de suicides. Certaines ne se
battent plus, se laissent couler, ne travaille plus, n’envisagent plus leur avenir.
D’autres réagissent mal à toutes choses[96],
deviennent agressives[97],
susceptibles ou hypersensibles. Elles s’enferment dans l’idée fausse que
personne ne peut comprendre ce qu’elles vivent[98]. La douleur chronique, surtout elle n’est pas
suffisamment pris au sérieux, peut rendre littéralement « malade » ou
profondément amer.
Au sein de
l’association, il y a plusieurs
personnes gravement dépressives [par le fait de vivre sans cesse avec des
céphalées chroniques depuis des années]. D’autres, des femmes, pleurant tout le
temps et ayant besoin de soutien et d’être consolée.
Jean-Christophe
indique « Il ne faut pas gâcher sa vie, mais ma vie est gâchée [par les céphalées]. Je ne me vois pas [dans mon état actuel]
faire de vieux os. Je ne veux pas vieillir [ainsi]. ».
Elle empêche souvent une
quelconque distanciation par rapport à elle.
Certaines personnes
même multiplient les comportements à risques ou suicidaires, en abusant des
antidouleurs, se « shootant à mort », abusant de l’alcool, des
drogues _ cocaïne, héroïne … _, essayant
sans fin de dangereux cocktails de médicaments psychotropes ou antidouleurs de
plus en plus surpuissants (comprenant antiépileptiques, neuroleptiques, dérivés
morphiniques …). Sinon, suite à des changements fréquents des médications ou
suite à des sevrages brutaux[99], ils tombent
parfois même dans des phases psychotiques (par exemple, des délires paranoïaques
ou d’interprétation …)[100], dans des
décompensations aux causes variables.
Toutes ces personnes
ont parfaitement conscience qu’elles vont détruire leur corps et leur vie, que
leurs abus médicamenteux vont encore renforcer encore leur douleur. Mais elles
pensent qu’elles n’ont pas le choix[101]. Elles
veulent mourir, à petit feu, peut-être pour attirer l’attention sur elle et sur
leur souffrance[102].
En fait, si l’on
cherche bien, on constate que souvent elles ont quand même un désir de vivre,
qui serait bien sûr renforcé si on _ c’est à dire les si médecins _ leur
donnait seulement une once d’espoir, surtout au niveau médical.
Souvent les malades
vivent aussi dans une sorte de course contre la montre, tentant d’éviter que leur
vie ne soit gâchée par la douleur, durant une vie entière, et tentant de
trouver désespérément une issue à leur maux de tête [103]. Pour
cela ils multiplient alors, sans fin, de démarches thérapeutiques en tout genre[104] [105].
3.12 Peut-on aider ceux qui vivent l’échec du corps médical dans leur chair ?
Les malades ont plus
ou moins conscience de l’échec du corps médical, à traiter efficacement
leur maladie. Mais bon nombre de médecins ne veulent pas leur avouer (peut-être
ne veulent-ils pas qu’on puisse remettre en cause leur pratique médical à
laquelle ils croient envers et contre tous).
Les membres de l’association « Papillons en cage » ayant de
nombreuses années de douleur et une longue expérience de gestion de celle-ci et
de rencontre avec des médecins et avec d’autres personnes souffrantes, derrière
eux, savent eux qu’il existe des douleurs résistantes à tout traitement
médicamenteux, à tout traitement psychologique ou à toute techniques de
relaxation et de décontraction.
Ces membres peuvent-ils,
alors, leur dire la vérité, alors que les malades ont tous l’espoir de trouver
le bon traitement et de s’en sortir un jour ? Est-il responsable, pour
notre association, de donner l’impression de fermer toutes les portes à
quelqu’un qui souffre ?
Le malade est-il prêt
ou suffisamment fort pour entendre des vérités difficiles ? Bref toute
vérité est-elle bonne à dire ? N’y a-t-il pas des vérités contreproductives
et négatives, si elles sont délivrées, brutalement, sans aucune préparation et
d’une façon totalement prématurée ? Certaines vérités difficiles ou
complexes, ne nécessitent-elles pas une longue préparation, réalisée avec
beaucoup d’humanité, pour qu’elles puissent être plus facilement admises à la
longue par le patient ?
Par exemple, un
médecin d’un centre de la douleur d’un hôpital parisien à déclaré, il y a
quelques années, à un membre de l’association « on ne peut rien pour
vous »[106],
sans rien proposer en lieu et place de cette déclaration, ou en retour (telles
que la proposition de nouveaux traitements, même sans effets garantis).
Or ce genre de
déclaration abrupte est-elle celle qui peut vraiment convenir aux patients souffrant
au plus profond de sa chair, depuis des dizaines d’années[107],
qui ne font que survivre depuis tant d’années et qui perdent progressivement
tout espoir ?
Aux journaux
télévisés, on parle de plus en plus de « cellules de soutien
psychologique » _ par exemple, pour permettre aux victimes de catastrophes
de mieux surmonter leur traumatisme. Or n’est-ce pas le rôle de ce genre de
cellules de réaliser ce genre de travail de soutien et de préparation à
certaines vérités auprès de tous malades souffrants ?
Pourquoi ce genre de
« cellules de soutien psychologique », réunissant psychologues,
n’existent pas dans la plupart des centres antidouleurs en France, centre qui
pourraient soutenir aussi les personnes souffrant de céphalées de tension
chroniques ? Est-ce donc trop une solution luxueuse pour des malades
souffrants ou une solution coûtant trop cher à la Sécurité sociale, du fait que
c’est déjà un organisme déficitaire ?
Sinon, pour revenir surtout
à la réalité de la situation souvent grave des malades, suite à l’échec des
médecins à le soulager durablement de ses céphalées de tension chronique, que
peut-on faire ?
Déjà, pour essayer
d’agir, nous avons créé l’association loi 1901 « Papillons en cage » :
a)
pour
aider et apporter un vrai soutien moral et psychologique auprès des malades
souffrants,
b)
pour
faire changer les choses auprès des médecins et différents organismes et faire
changer le regard social sur cette maladie _ faire qu’elle soit plus respectée
et mieux acceptée.
Déjà, notre
association, au travers de ses anciens membres, a déjà un rôle de soutien bénévole,
auprès de ses nouveaux membres ou des malades qui la contacte mais ne veulent
pas devenir membres, ne serait que par la
force des choses, car nous n’avons eu d’autre choix que de nous réunir
ensemble, pour pouvoir nous soutenir mutuellement (à cause justement de l’échec
actuel du corps médical).
Sinon, nous
reconnaissons sincèrement et honnêtement que sans des données (ou vérités)
scientifiques sûres et claires, il est difficile, à l’association et aux
membres, de proposer des solutions sûres aux personnes souffrantes. Les membres
de l’association sont tous comme les médecins dans le brouillard sur les causes
réelles des céphalées de tension chroniques. Et d’ailleurs, les membres de l’association,
eux-mêmes, ne prétendent surtout pas détenir la vérité, tant ce sujet est
difficile, complexe et multifactoriel. Les membres, en discutant, s’en rendent
compte chaque jour. D’autant qu’on ne dispose, sur ce sujet, toujours d’aucune
« vérité » scientifique évidente et sûre, du moins pour
l’instant.
La déontologie de
l’association n’est pas de raconter des belles histoires édifiantes, des
légendes dorées, voire des gentils contes ou de pieux mensonges, surtout à des malades
qui, pour la plupart d’entre eux, sont loin d’être idiots … même si c’était
pour tenter de les aider à tenir, pour leur apporter un réconfort, surtout durablement[108].
Nous ne préconisons
pas non plus (du moins si cela est possible), les solutions irrationnelles.
Nous préférons dire
la vérité ou ce qui nous semble être la vérité ( ?), éventuellement en
l’aménageant, c’est à dire en préparant progressivement le malade à celle-ci,
pour lui éviter éventuellement tout choc _, surtout en disant qu’il n’y a pas
de certitudes scientifiques avec les données connues actuelles, et donc il
n’existe pas, pour l’instant, de traitement miracle, ou de guérison à court
terme certaines (même s’il peut y avoir des guérisons réelles, comme dans
le cas de Christine, voire plus loin _ cas constituant un vrai message d’espoir
_, voire des périodes de rémissions sur des durées plus ou moins longues, voire
une augmentation de ces périodes avec l’âge). Que la guérison ou la rémission
ou le contrôle du mal, s’il y a lieu, dépendra de chaque personne, prise
individuellement, de sa personnalité, de son histoire, d’un grand nombre de
paramètres que nous ignorons, pour l’instant du moins.
Nous essayons malgré
tout de donner espoir, même s’il n’y a pas de certitude (dans ce domaine), en
faisant appel et en contribuant à la lucidité et maturité du malade, en lui
faisant appréhender la complexité de sa maladie.
Personne ne peut se
réjouir de cet état de fait actuel. Mais nous indiquons qu’on peut malgré tout
trouver des moments de bonheur, grâce aux relations affectives avec les amis et
proches, puis par la réalisation de ses passions (comme avec la passion de
l’aviation, du jardinage, des animaux etc. …), puissants dérivatifs à la
souffrance etc. On peut arriver malgré tout à passer d’un état prosaïque à un
état poétique (qui se rapproche du bonheur). Tout le monde mérite de sortir de
la souffrance et l’association et ses membres agissent dans ce sens.
Sinon, une question
délicate à laquelle l’association est souvent confrontée : peut-on
décourager des personnes, s’acharnant dans une voie thérapeutique donnée,
surtout si elle est irrationnelle, pseudo-scientifique, même si on pense que
cette personne va perdre son temps, voire même beaucoup d’argent pour
rien ? Peut-on prendre le risque de lui faire perdre un / ce nouvel espoir
qui, pour l’instant, la fait tenir ?
Pour l’instant, nous
n’avons pas résolu cette question éthique. Actuellement, nous ne dissuadons pas
les personnes de suivre tel ou tel traitement, même si nous ne sommes pas convaincus
de son efficacité[109]. Nous
pouvons par contre les prévenir, surtout si le traitement risque de vous faire
perdre beaucoup d’argent pour rien ou s’il risque de vous mettre sous la coupe
d’une secte. En effet, quand certaines personnes sont désespérés ou/et
affaiblies par leur céphalées, elles se tournent souvent vers les sectes et les
marchands de faux espoirs[110].
Notons, que nous
indiquons que nous ne sommes pas une secte, nous n’en voulons pas à l’argent
des membres (notre cotisation est de 30 Euros par an. Notre association est
d’ailleurs plutôt désargentée) et qu’aucune emprise de l’association sur les
malades est à craindre, pour de ces derniers.
Le but de
l’association n’est pas de préconiser des démarches irrationnelles (si
possible). Au contraire, nous pensons que nos céphalées seront solutionnées
dans le cadre d’une démarche scientifique.
En tout, l’auteur, en même temps, président de l’association, souhaite que
l’approche scientifique soit privilégiée et promue, au sein de l’association.
En étant très honnête
avec lui-même, l’auteur reconnaît, se sentir, par moment extrêmement, démuni face
aux personnes souffrant le plus et vivant
un véritable enfer[111].
D’autant, que jusqu’à maintenant, il aucun moyen honnête de pouvoir leur dire
avec certitude qu’il y aura un bout du tunnel immédiat _ au fait de vivre sans
cesse dans des maux de tête chroniques _, et que le monde médical va bien trouver enfin ( ?) une
solution performante et satisfaisante… alors que l’auteur sait pertinemment
que la science n’a toujours pas, pour l’instant, de réponses satisfaisantes aux
douleurs chroniques rebelles (et encore moins de réponses morales
réconfortantes), en particulier celles
liées aux céphalées de tension chroniques pharmaco-résistantes.
La question est
d’autant plus difficile que les malades déçus par le corps médical, n’ayant pas
reçu le traitement miracle auquel s’attendaient recevoir, se tournent souvent
alors vers l’association « Papillons en cage », espérant ou croyant peut-être que celle-ci leur « dégottera »
un traitement médical miracle, de derrière les fagots.
Mais voyant que notre
association n’a pas, nous-mêmes, plus de solution miracles à proposer que les
médecins, ils pensent ou se convainquent, un peu trop rapidement, alors que notre
association ne sert à rien. De ce fait, ils ne la recontactent plus.
A destination de ces
derniers, nous leur indiquons, pour dissiper leurs préventions, que notre
association n’est pas une secte ou un diffuseur/distributeur de produits ou de
traitement miracles, mais que notre rôle est ailleurs, en poursuivant
essentiellement deux buts[112] :
a) soutenir et
informer les malades,
b) faire bouger les
choses _ au niveau médical et social _ pour qu’ils soient mieux traités[113].
Donc nous essayons de
les convaincre que l’utilité de l’association n’est pas de fournir un
traitement miracle mais de tenter
de changer notre situation morale et matérielle actuelle.
Nous indiquons aussi
que nous cherchons, surtout pour l’instant, à ce que notre association
contribue déjà :
a)
à
tenter de faire changer le regard de la société et du corps médical à notre
égard _ à faire en sorte qu’on ne nous voit plus comme des petits êtres faibles
geignards, souffreteux, sans cesse plaintifs, i.e. hypocondriaques ou névrotiques
obsédés par leur douleur, ou encore des sujets seulement essentiellement anxieux
et dépressifs …_,
b)
à
ne plus nous psychiatriser surtout avec les psychotropes[114] (et ne
plus être déconsidéré concernant notre plainte et la réalité de notre souffrance),
c)
à
que certains d’entre nous qui souffrent le plus puissent aussi bénéficier d’un
soutien psychologique et d’une vraie prise en charge psychologique (par, par
exemple, une thérapie analytique et comportementale etc…) _ nous
insistons bien sur le fait qu’une thérapie analytique pourrait être aussi utile
pour certains malades et que ce n’est pas une vue de l’esprit _[115],
d)
à
faire accepter par le corps médical que notre douleur n’est pas « légère à
modérée », qu’elle peut être aussi réellement « intense et sévère ».
Ce changement de classification du niveau de la douleur nous permettrait alors
enfin d’obtenir une réelle prise en charge COTOREP de notre handicap. C’est un
de nos buts[116].
Il est vrai que pour
faire changer les choses, il faudrait qu’il y aussi de nouvelles avancées
scientifiques sur
Sinon, en final, notre
combat au sein de notre association est qu’on n’ait plus à se battre, sans
cesse, pendant des dizaines d’années, sans résultat, face à ce mal et, face à
un corps médical « fermé », pour le faire reconnaître ce mal comme une
vraie maladie, vraiment très douloureuse et pouvant être très invalidante
(et non comme un simple mal imaginaire). Ce que nous voulons est qu’on ne
rencontre plus sans cesse que porte fermées et attitudes fermées de psychiatres,
face à ce mal. Qu’on n’ait plus, en particulier, à envoyer des copies de
centaines de lettres à tous les médecins possibles et imaginables, durant des
dizaines d’années, pour tenter de faire changer les choses et le regard des
médecins sur ce mal, en général, d’ailleurs sans aucun résultat[118] [119].
Pour revenir à notre
association, nous tentons de compiler et faire partager entre tous les membres
tous les trucs et astuces (de « survie »), qui nous ont permis de
tenir jusqu’à maintenant face à douleur, voire de nouvelles pistes explicatives
ou thérapeutiques (si elles existent).
Et comme l’auteur n’a pas, pour le moment, de
réponses vraiment satisfaisantes à apporter aux malades qui le contacte et/ou
contacte l’association, l’auteur a tenté, par ce texte ci-après, de présenter
tous les solutions que chacun des membres et lui-même ont trouvées, et qui les
ont aidés, au moins un temps, voire durant des dizaines d’années, pour tenir,
face à la douleur, jusqu’à maintenant, et surtout éviter les idées noires ou
pire le suicide, ou encore le « petit vélo » dans la tête, c'est-à-dire
le fait de penser obsessionnellement, sans fin, à sa douleur.
Car quand on cherche ou réfléchi (ou l’on se
décarcasse) un peu et surtout en faisant preuve d’imagination, on peut toujours
trouver des raisons et des arguments pour tenir face à la douleur, même si ce
n’est pas facile.
Les idées seront
exposées ici en vrac (sans plan), selon son intuition et ses notes prises
régulièrement, en essayant de porter le moins possibles de jugement de valeur
sur la douleur du malade.
Nous aborderons même,
dans ce texte, des sujets pouvant controversés, au niveau scientifique, et pour
la raison[120].
Car quand on n’a d’espoir médical ou scientifique, l’inclinaison de l’esprit
est alors de se tourner vers les voies irrationnelles pour tenter de s’en
sortir. Nous apporterons donc alors aussi un regard critique sur toutes ces
conceptions ou approches et voies irrationnelles.
En espérant que ces idées et suggestions
aideront, à leur tour, tous ceux qui souffrent. …[121].
1. Les « armes »
philosophiques et religieuses :
Souvent, le 1er
recours face à la souffrance, est
Mais d’autres plus
sceptiques, au contraire, considèreront les réponses religieuses comme
passéistes et ne pouvant plus satisfaire aux questionnements actuels d’une
population bien plus éduquée (telle la population européenne).
La souffrance joue un
rôle important dans la plupart des religions, qui la met en perspective avec
(voir ci-après) :
a)
les
attitudes et conduites morales de l’homme, telles la consolation ou le
réconfort, le fait de ne faire de mal à quiconque, d’aider les affligés et ceux
qui souffrent
b)
le
progrès spirituel (par l’intermédiaire d’exercices spirituels tels que pénitence, ascétisme …).
Voyons maintenant quelques
réponses religieuses à la souffrance.
Nous ne présupposons
pas à priori de leur validité (scientifique), mais nous les abordons comme
outils pouvant être plus ou moins efficaces pour tenir face à la douleur.
3.13 Dans le christianisme
3.13.1 Le texte de Job dans la Bible
Un texte important de
la Bible concernant la souffrance est celui de Job.
Job est le héros du Livre de Job, de la Bible hébraïque[122]. Job
représente le modèle du Juste dont la foi est mise à l'épreuve par Satan,
avec la permission de Dieu[1].
Durant 7 ans, Job supporte avec résignation la perte de ses biens, de ses
enfants, ainsi que les souffrances de
La morale de ce texte
est que si l’on reste juste et que l’on garde
Ce texte repose sur
la foi que Dieu, verra enfin notre détresse et souffrance, qu’il n’y a pas de
doute sur le fait que Dieu la voit depuis toujours et qu’il y a déjà mis fin,
mais que d’autres forces sont à l’œuvre qui prolongent
Lors de l’AG de début
juin 2009 à Toulouse, de l’association, plusieurs personnes témoignaient avoir eu souvent
recours à cet important texte du Christianisme et du Judaïsme, … Ce texte leur
permettait de se maintenir dans l’Espérance _ espérance d’une fin possible à
leurs malheurs … c’est à dire à une issue définitive et heureuse à leurs maux
de tête chroniques[124].
3.13.2 L’exemple de certains saints ou saintes
Certains s’inspirent
des exemples édifiants de personnes qui ont beaucoup souffert comme Marthe
Robin, Thérèse Neumann[125], Anne
Catherine Emmerich, Saint-François d’Assise, Sainte Thérèse d’Avila (cette
dernière ayant souffert de terribles maux de tête)[126],
toutes ces personnes ayant su résister et surmonter leur douleur.
Marthe Robin
disait : « […] vous êtes cloué
à la pensée comme moi je suis clouée à
Mais quelle heure est-il ? Pour moi, c'est toujours la
nuit, et c'est toujours la douleur… ».
Marthe Robin fait
preuve d’une abnégation devant la souffrance remarquable (et son exemple a
touché tous ceux qui l’ont connu).
Bernadette Soubirous,
durant les 4 dernières années de sa vie, clouée au lit par une tuberculose et
un asthme, voyait sa maladie comme un emploi[127], sa
seule activité étant alors « la prière et l’offrande ».
Elle a « tenue
son rôle de malade » (raisonnement qui était certainement une façon de
tenir _ une aide _ face à la maladie et au possible désir de mourir et de
baisser les bras)[128].
L’auteur, au bout de
plus de 20 ans de céphalées, considère lui-même de sa maladie comme un
« métier »[129]. Sa
maladie occupe son temps, l’oblige régulièrement à s’aliter. Dans le passé,
pour s’occuper, l’auteur, ancien chrétien, priait. Maintenant, il essaye
d’avoir une certaines distanciation par rapport à sa maladie, en la considérant
par exemple, comme un sujet d’observation scientifique, à étudier avec
détachement (en évitant, bien sûr, que sa maladie devienne une autre façon de
« s’obséder » sur son mal). Couché dans son lit, il prend des note
sur sa maladie, il profite de ces « temps libres ou de repos forcé »
pour, par exemple, imaginer des inventions, élaborer des textes, des livres
(quand, bien sûr, la douleur lui laisse la possibilité de réfléchir) etc. …
La maladie l’oblige,
par exemple, a) à se questionner sur lui-même (voire à faire son examen de
conscience), b) voire à entreprendre des recherches scientifiques (sur ce mal),
pour faire évoluer sa compréhension auprès du milieu médical. Sinon, si telle
personne l’a agressé, il peut se demander quelle faute a-t-il commis à son
égard (quels sont éléments du contentieux qu’elle a contre lui ?).
Le combat intérieur :
L’auteur a le
souvenir qu’en avril, mai et juin 2005, il avait tellement mal _ du fait de
céphalées extrêmement sévères_ qu’il a
été cloué dans son lit, durant plusieurs mois. Il ne pouvait plus rien faire,
c’est à dire que réellement plus aucune activité ne lui était possible. Et même
dans son lit, sans rien faire, l’auteur
se battait intérieurement, sans fin, contre la douleur et surtout contre
l’accablement et le désir d’en finir (i.e. de mourir). Il méditait,
visualisait, comme dans les exercices de yoga ou zen. Il se battait aussi
contre le ressentiment, voire la haine contre tous ces médecins qui, depuis
plus de 20 ans, ne voulait pas croire dans la réalité de l’intensité de ses
maux de tête (et qui ne le prenaient pas au sérieux). C’était donc un travail
intérieur. Et donc, malgré son apparente immobilité (ou « paresse »
apparente), l’auteur ne restait pas à rien faire, « il travaillait »
intérieurement, en fait (d’où le concept de métier-maladie).
Mais toutes les
personnes souffrantes ont-elles les mêmes capacités de tenir avec autant de
courage et d’abnégation que ces personnes saintes ou « édifiantes » ?
Peut-on avoir à la longue leur force de caractère ? Chez elles, cette
force de caractère n’est-elle pas innée ou liée à leur éducation ? [130] [131] …
Sinon, tout le monde
a-t-il la capacité de devenir un saint ?
Vaste et profonde
question, que nous ne pensons pas pouvoir résoudre ici !
Sinon, n’y a t-il pas
quelque chose d’inhumain [surtout de la part du corps médical] à de demander à
des personnes souffrantes de ne jamais se plaindre, de cacher leur souffrance
et de se conduire comme des saints ?
Se faire aider par « l’intercession
divine » et par celle de Jésus
En s’inspirant des 2
versets des Évangiles suivants
« 29. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous
instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos.
30. Car mon joug est bon, et ma charge légère » (Matthieu 11
:29-30),
=> Donc certains
prêtres ou hommes d’églises recommandent de se reposer totalement et de faire
totalement confiance à Dieu et Jésus (et de trouver la consolation à leur
douleur physique auprès d’eux).
Mais cet espoir d’une
« consolation surnaturelle » (venant de Dieu ou de Jésus) ne
fonctionne pas toujours, avec toutes les personnes[132] [133] [134].
3.13.3 Justifications métaphysiques
La souffrance aide à nous élever (moralement)
On peut, par exemple,
se convaincre que la douleur peut être utile pour notre évolution intérieure et
notre édification.
Souvent les
chrétiens, on justifié métaphysiquement la souffrance, par le fait qu’elle nous
poussait à nous dépasser ou surpasser, chaque jour, voire qu’elle poussait à
accomplir des miracles. Voire qu’elle nous sanctifie.
Par exemple, dans la
lettre apostolique "Salvifici Doloris", Jean-Paul II parle d'une souffrance qui
sauve l'homme en le rapprochant de la passion du Christ.
Ceci est à rapprocher à ce que disait Simone Weil :"L"extrême
grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un remède surnaturel
contre la souffrance, mais un usage
surnaturel de la souffrance".
Mais ce point de vue
de la sanctification de l’âme par la souffrance est loin d’être partagée par
ceux qui souffrent quotidiennement. Car la souffrance peut détruire (comme
l’auteur le constate aussi dans l’association), surtout quand elle n’est pas prise
en sérieux, par le corps médical et les proches.
Justification métaphysiques négative
Il existe encore d’autres approches
métaphysiques _ que l’auteur considère lui-même comme plutôt négatives, car
n’apportant souvent aucun réconfort _, affirmant que si l’on souffert, c’est
parce que :
Nos céphalées seraient liées au poids de nos
mauvaises actions passées
C’est, du moins, la
théorie défendue par ceux qui croient aux châtiments divins ou à la thèse du
karma et/ou de la réincarnation.
Par exemple, un
dirigeant de l’Ordre Rosicrucien avait affirmé à l’auteur, en 86, devant une
assemblée, que ses maux de tête étaient liés à son « mauvais karma ».
Sous-entendu,
l’auteur doit racheter son karma pour espérer se débarrasser de ses maux de
tête.
Ce genre de
raisonnement reste assez irrationnel, car étant avancé sans aucune preuve
scientifique concrète[135].
Faire du « bien » autour de soi _ du moins avec prudence, afin de ne pas se faire abuser ou escroquer,
par des personnes profitant de votre naïveté _, peut ne pas faire de mal. Par contre, notre changement d’attitude
face aux autres, par une attitude plus « positive », conduira-il à la
disparition de nos céphalées de tension ? En fait, rien ne dit, au niveau
scientifique, qu’il y aurait une relation entre le changement de notre attitude
morale et la fin de nos céphalées (aux yeux de l’auteur, du moins, ce type de
relations causales semble un peu trop simple).
La lutte contre les
céphalées de tension mobilise souvent chez les personnes qui souffrent une énergie
considérable et les « bonnes actions » restent souvent un luxe
quasiment inaccessible, quand les personnes souffrantes sont accablées par leurs
céphalées.
« Dieu
éprouve ceux qu’il aime »
Dans une autre
variante de cette idée, nous sommes, ici-bas, dans le « monde de
l’épreuve » (c’est, par exemple, ici la thèse cathare ou rosicrucienne,
voire de certains chrétiens actuels).
Dans cette
conception, ce n’est pas l’enfant ou la découverte scientifique ou l’œuvre
finale qui compte, mais le douloureux processus d’enfantement, que cela soit a)
dans la création scientifique ou artistique, b) dans son métier, dans la
création professionnelle, c) dans les activités et relations sociales
Bref, si l’on
affronte les épreuves de ce monde avec vaillance, courage, ténacité, on sera
récompensé dans l’autre monde (ou dans une autre vie).
Certains théologiens
utilisent donc, cette approche métaphysique pour expliquer les grandes
souffrances. Si Dieu a semblé indifférent au malheur de millions d’hommes,
durant la shoah ou les génocides …c’est parce qu’il les éprouvait. Mais toutes
ces personnes martyres se retrouveront et seront récompensées dans
« l’autre monde », un monde où la souffrance n’existerait pas[136].
Le croyant pensera par exemple « Dieu infiniment bon, tu ne peux pas nous
laisser ainsi, dans tant de souffrance, indéfiniment (sans que personne n’en
sache rien et ne s’en aperçoive pas). Il est impossible que tu ne vas pas
intervenir un jour, que tu ne va pas faire preuve de compassion, car on a tant
souffert, depuis si longtemps ! ». Arguments qui bien sûr,
laisseront sceptiques les athées ou les agnostiques.
Un médecin avait dit
à Jean-C., alors qu'il avait 20 ans : « Vous êtes né pour souffrir ». Ce à
quoi Jean-Christophe a tiré comme enseignement « Les gens peuvent être terriblement maladroits ». Relatif à cet
épisode, il ajoute encore « Je me
suis rebellé face à cette déclaration du docteur. ».
A noter, que l’auteur
à qui l’on avait déclaré qu’il avait un « mauvais karma », s’était,
lui aussi, rebellé contre cette affirmation intempestive voire péremptoire.
La souffrance nous ouvre aux autres ( ?)
a) On peut se dire
que quand
on a souffert énormément, on sera ensuite capable ensuite de mieux comprendre
la douleur d’autrui et d’être
moins royalement stupide ou monstrueusement indifférent à la douleur d’autrui.
Mais dans l’association,
on voit aussi que la souffrance peut aussi contribuer à fermer certaines
personnes aux autres.
La souffrance nous rend plus sensible, plus
intelligent, plus créatif ( ?)
b) Sinon, autre
argument, la souffrance peut-être
augmenterait-elle en nous certaines intelligences et sensibilités pour autrui
ensuite ( ?) … du moins, si l’on arrive à ne pas être « ravagé »
par la douleur ou souffrance. Darwin a
été malade toute sa vie. Vincent Van Gogh a souffert toute sa vie. Beethoven
semble avoir souvent composé dans
C’est aussi cette
conception aussi qu’on retrouve dans la citation du philosophe Khalil Gibran "Les souffrances ont donnés vis aux plus
grandes âmes. Les personnages les plus éminents, portent en eux des cicatrices".
En fait, il y a des
personnes qui créent aussi dans le plaisir et le bonheur (par exemple, l’écrivain
Jean d’Ormesson). La souffrance n’est donc pas toujours nécessaire à
Mais il semble à
l’auteur, que ce dernier « truc » peut marcher, que si l’on a
surmonté la douleur ou si elle a diminué ou qu’elle ne vous submerge pas ou ne
dure pas trop longtemps.
Car une douleur trop
forte diminue fortement vos capacités intellectuelles et vous pousse alors à
tout oublier sans cesse.
Avec la souffrance chronique, on devient plus
résistant à la douleur
b) Avec la douleur
chronique, on peut se convaincre que peut-être
devient-on plus résistant à la douleur, à la longue ou qu’il y a
involontairement un effet d’entraînement à la douleur ( !?). Ou
bien, on serait plus fort parce qu’on
aura développé, à la longue, des tactiques de diversions, de
« contournements » permettant de mieux surmonter sa douleur[137].
Mais l’auteur
constate aussi que la souffrance chronique peut détruire. Ce constat se vérifie
aussi au sein de notre association (tout dépend de la force de la douleur, de
la capacité de résistance et de la philosophie du malade).
3.14 Dans le bouddhisme
Le bouddhisme est par
essence la philosophie de
Suivre l’enseignement
du bouddhisme conduit à une ascèse morale, où l’on se doit d’être juste en tout,
qui peut être très dure, alternant souvent enseignement spirituels et exercices
spirituels et pratiques, que bien peu peuvent arriver à mener jusqu’au bout.
Si l’on menait
jusqu’à au bout cette ascèse, l’on pourrait peut-être maîtriser jusqu’aux
douleurs céphaliques ( ?).
Mais en fait, le
bouddhisme parle-t-il d’un mal-être, d’une souffrance métaphysique en tout
homme ou bien aussi de la souffrance physique ? Car le bouddhisme affirme
que la souffrance a pour racine une insatisfaction fondamentale (ontologique)
de l’être, qu’elle provient de nos tendances, de notre habitude à nous
accrocher aux souvenirs des nos expériences, à imaginer des choses qui ne sont
pas encore, et de notre incapacité à
percevoir correctement la réalité, dans l'instant.
Il est possible que
les exercices de méditation zen ou bouddhistes, tous comme la relaxation,
pourraient momentanément aider à mieux supporter la douleur, du moins quand la
douleur n’est pas trop forte ( ?) (Affirmation à vérifier tout de même _
voir notre observation, ci-avant, sur l’inefficacité de la relaxation en cas de
douleur trop forte). Sinon, d’une manière générale, la méditation zen, même si
elle n’apporte pas le soulagement à la douleur physique, elle pourrait être
bénéfique à la santé (si l’on croit certains articles[138]).
Sinon, la souffrance
morale, l’insatisfaction ontologique, que le bouddhiste prétend
« soigner », n’est peut-être pas la même souffrance, que celle liée à
une véritable douleur physique.
3.15 Attitude d’acception ou de résignation ?
Selon Jean-Christophe
lors de l’AG de 2009 : « ma
philosophie est bouddhiste, je vie au temps présent. J’essaye de retirer un peu
de plaisir de ma vie actuelle : je vais au ciné, je regarde la TV, j’ai
quelques aventures d’un soir,
Mais peut-on vraiment
accepter ou se résigner de vivre avec des maux de tête jusque, par exemple, à
la fin de sa vie ?
C’est toute la grave
question à laquelle sont confrontés ceux qui vivent avec des céphalées de
tension chroniques depuis des dizaines d’années.
Nous rajouterons que
les personnes acceptant le plus leur souffrance, sont celles touchant une
allocation COTOREP ou sociales, cela sur le long terme, ce qui leur permet
d’avoir moins l’angoisse du lendemain (elles n’ont plus l’angoisse de leur
futur et la question de savoir comment vais-je gagner mon argent, du fait de la
présence constante et handicapante de mes céphalées, telles une épée de
Damoclès sans cesse brandie sur ma vie), ou l’inquiétude de savoir quels
nouveaux mauvais tours nos céphalées vont nous jouer le lendemain et le
surlendemain ?
3.16 Dans le Judaïsme
Voir le texte de Job cité ci-avant.
3.17 Dans l’Islam
L'équivalent arabe
de Job dans le récit coranique est Ayoub[2], la
variante turque est Eyüp.
Le Coran
mentionne Ayoub comme étant un
prophète noble et généreux. Dieu l'aimait beaucoup car
c'était un de Ses plus humbles et francs serviteurs. Il aidait les orphelins,
et nourrissait les pauvres. En voyant la dévotion d'Ayyoub pour Dieu, Satan a
décidé de l'égarer mais il ne réussit pas. Il partit égarer son épouse Rahma et
réussit. Job fut comblé de misère et dut souffrir patiemment. Le Coran dit:
« Frappe (la terre) de ton pied: voici une eau
fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Et Nous lui rendîmes sa famille
et la fîmes deux fois plus nombreuse, comme une miséricorde de Notre part et
comme un rappel pour les gens doué d'intelligence. "Et prends dans ta main
un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment
», Le Coran, 38:41-44.
La réponse islamique
à la souffrance est une soumission totale
et une profonde confiance en Dieu.
Mais dans le monde
moderne imprégné par la pensée scientifique et le doute rationnel, peut-on
continuer de se contenter d’une « profonde
confiance en Dieu », en un « Dieu » qui serait lui seul à
même de résoudre tous les maux (ici nos maux physiques) ?
Selon le même type
d’inspiration que le verset Matthieu 11:29-30, le philosophe musulman soudanais
Mahmùd Muhammad Taha écrivait « la prière est le moyen d’accepter la
servitude envers Dieu qui elle-même est la liberté absolue. C’est une servitude
qui libère l’homme de la peur, et c’est là que la liberté atteint son apogée »[139] [140].
3.18 Autres approches philosophiques
3.18.1 Epicurisme
Pour Epicure le plus
grand bonheur consiste en un état de
tranquillité (ataraxie), exempt de
douleur et à l'abri des ennuis qu'entraîne la poursuite ou les conséquences du
plaisir.
Alors que le
bien-portant ne prête pas attention au bonheur de la santé, Epicure[141] a vécu avec acuité l'euphorie du convalescent
qui se détend après chaque douleur. Pour lui, à cause de son expérience, toute
souffrance physique est négligeable !
Cette approche de la
souffrance a été reprise récemment par le philosophe Michel Onfray, excepté le
fait qu’Onfray n’affirme plus que toute souffrance physique est négligeable.
Pour lui, on peut lutter contre la douleur, par la volonté, la décision et le
travail sur soi[142].
Personnellement, en
état de douleur, l’auteur n’a jamais réussi à parvenir à un état de
tranquillité ou de détachement suffisant (face à sa propre douleur).
Cicéron (106 av. J.-C., 43 av. J.-C.), homme d’État
romain et un auteur, a reproché aux épicuriens, de nier la souffrance physique
et d'en faire même un élément de plaisir
(voluptatem, voluptarius), en prenant pour exemple les tortures infligées par Phalaris,
tyran d'Agrigente (670 564), à ses victimes qu'il faisait brûler vivantes dans
un taureau d'airain.
3.18.2 Stoïcisme
Pour le stoïcisme, le plus grand bien réside dans
la raison et la vertu, mais un tel idéal s'atteint pour l'âme à travers une
sorte d'indifférence au plaisir et à
la souffrance (apathie): c'est pourquoi cette doctrine est devenue
synonyme de maîtrise de soi devant même
les pires douleurs.
Pour Zénon (vers 335,
vers 234), fondateur du stoïcisme et Ariston, disciple de Zénon (né vers 270), le
seul bien est la vertu ; elle ne peut
pas être vaincue par la douleur, qui n'est donc pas un mal en soi.
Il semble pour
l’auteur, qu’avoir un parfaite maîtrise de soi, face aux pires douleurs,
surtout si elles sont longues, c’est beaucoup demander aux malades. C’est de
leur demander d’être constamment surhumain. Lui-même n’a jamais réussi à avoir
une parfaitement maitrise de soi, face à une forte douleur[143].
Par ailleurs, il y a des exemples où la vertu
des hommes a pu être vaincue par la douleur.
4 Les exercices mentaux pour tenir
4.1.1 L’entraînement à la douleur
L’auteur a remarqué
qu’avec le temps, au bout de 10 ou 20 ans, il est devenu plus résistant à la
douleur[144].
Sinon, il a constaté
lui-même que les phrases douloureuses les plus graves[145] ne
sont pas pour l’instant pas réapparues[146]. Avec
l’âge, les phrases de céphalées modérées sont plus longues.
Dans le livre du
docteur Michel Lantéri-Minet, cité précédemment, page 41, il est dit « Du fait de ce début précoce, la prévalence[147]
de la céphalée de tension[148] est plus importante dans la tranche d’âge
comprise entre 20 et 39 ans et il
est souvent avancé que cette prévalence décline avec l’âge ».
En fait, l’auteur ne
pense pas que le fait que notre céphalée puisse diminuer après 40 ans
(affirmation que nous avons soulignée), puisse être vraiment une donnée totalement
rassurante ou satisfaisante, pour les malades[149] [150].
Par contre, ce que
semble observer le Dr Michel Lantéri-Minet et bien d’autres personnes et
médecins, est qu’avec le temps, le malade arrive mieux à résister à la douleur
_ il ne se précipite plus chez le médecin, à chaque fois que le mal apparaît ou
qu’il a trop mal[151].
Surtout, il a développé un grand nombre de stratégie pour tenir face à la
douleur (voir ces stratégies, plus loin).
4.1.2 Profiter de l’instant présent
« CARPE DIEM QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO »,
« Mets à profit le jour présent sans
croire au lendemain » (HORACE, liv. I, ode XI, v. 8).
Quand on a mal ou
qu’on est gêné, il faut trouver des astuces, en particulier par l’obtention de
petits plaisirs, permettant de compenser le « mal » (la douleur). En fait,
tout dépend bien sûr de l’intensité de sa douleur (mal).
Cela peut être, pour
s’amuser, se distraire, se faire plaisir :
a) par de bons petits
plats qu’on s’offre,
b) par le sexe ou des
aventures sans lendemain ..., pour certains (qu’il soit à deux ou solitaire),
c) par des achats ou
des cadeaux qu’on se fait à soi-même,
d) par de fêtes
auxquelles on participe,
e) des repas au
restaurant ou chez des amis,
f) des sorties en
tout genre (promenades …),
g) des sorties cinés
ou des visualisations de films (en particulier des films distrayants ou
comiques), g) des vacances, des voyages …
J.Y. Théry a l’habitude de « sucer lentement une pastille vichy ou un bonbon aux fruits. Pendant
quelques minutes, la douleur à la tête est un peu moins oppressante, plus
supportable ».
Les diversions de
l’auteur, quant à elles, sont surtout les voyages et des petits cadeaux, qu’il
se fait à lui même. Cela peut être aussi le fait de regarder de nombreux
documentaires à la TV qui le font rêver ou augmentent son niveau culturel,
surtout quand il est cloué au lit (d’autant que sur le câble, il existe
beaucoup de chaînes documentaires et culturelles fort intéressantes). La
télévision et certaines séries télé peuvent servir aussi de bruit de fond,
pouvant induire une certaine somnolence, pouvant éventuellement induire à la
longue un sommeil plus ou moins réparateur (en tout cas qui n’est pas néfaste),
calmant et permettant d’oublier, un instant, sa douleur.
4.1.3 Relativiser son mal car il y a toujours pire à côté de nous
On peut se convaincre
que « l’herbe peut-être encore moins verte ailleurs ».
Par exemple, la
situations des personnes qui ont vécu des choses terribles est certainement
pire que la notre.
Quand on souffre sans
cesse et que cette souffrance vous handicape intellectuellement (vous empêche
de vous concentrer) et qu’on est alité, il a souvent le « jeu »
intellectuel de comparer sa souffrance ou son handicap avec celles des autres.
Par exemple, remplacerais-je ma situation actuelle, avec celle d’autres
personnes souffrantes ?
On peut quand même
finalement se convaincre qu’il y a encore plus malheureux ailleurs que soi.
Sinon, on n’est
jamais mort du fait de notre maladie (à part les cas de suicide).
Donc on pourrait
alors conclure « pourquoi donc se plaindre » !? Notre problème
n’est peut-être pas si important.
Un problème récurrent
est qu’on est obsédé, sans fin, par le raisonnement suivant, du type « petit
vélo dans la tête », par exemple, en se posant régulièrement la question de
savoir « comment aurait été ma vie autrement, si je n’avais souffert
autant d’années de maux de tête ? ». Ou bien de savoir « pourquoi toutes mes démarches auprès
des médecins ont été une immense perte de temps et un grand gâchis (comment
alors expliquer l’échec de mes démarches ?) ». Ou bien « les douleurs cancéreuses sont-elles pires
que mes céphalées ? ».
Les techniques de
diversions exposées plus loin dans le document permettent justement d’éviter ce
genre de raisonnements du type « petit vélo dans la tête »[152].
Sinon, on discutant
avec ses collègues de bureau ou proches et en cherchant bien, on découvre que
tout le monde sur terre a connu des malheurs et souffrances (comme tel
collègue, par exemple, souffrant de maux de dos chroniques et obligé
régulièrement de prendre des dérivés morphiniques etc.) …
Malgré tout ces
raisonnements comparatifs précédents ont leurs dangers. Car on peut passer,
sans cesse, son temps, ensuite, à comparer son malheur avec tous les autres
grands malheurs du monde ou son handicap avec d’autres handicaps. Et il a le
risque du « petit vélo dans la tête », à force d’établir, sans cesse,
une évaluation comparative de sa douleur avec celle des autres.
5 Des armes de lutte par des moyens essentiellement pratiques
Ces
« armes » ici sont essentiellement constituées « d’armes de
diversions », d’évitement et/ou de dérivatifs à la douleur, permettant de
faire systématiquement diversion ou « barrage » à la douleur.
5.1 Le combat mental et physique
Souvent pour garder l’espoir, il faut se
maintenir dans une attitude combative, avec comme leitmotiv dans l’esprit, le
combat toujours et encore _ par exemple, le combat perpétuel contre les
injustices, contre les maux de tête, pour tenter faire déboucher, enfin, les
choses, dans le domaine de la recherche scientifique sur les céphalées de
tension chroniques … _, pour tenter de tenir sa tête hors de l’eau, de ne plus
sentir sa douleur, ne plus cogiter (de ne plus avoir le petit vélo dans la
tête), ne plus se morfondre, ne plus penser sans cesse à la douleur, pour
garder l’espoir.
Le combat peut-être
aussi le combat intérieur, quand on a trop mal (voir plus haut).
L’auteur confirme que
son combat lui a souvent rendu l’optimisme ou un certain espoir (surtout s’il
débouche sur une réussite ou quelque chose d’utile). Par exemple, en octobre
81, suite à un choc et surmenage graves, son cerveau semblait totalement
déréglé (soit a) peut-être parce qu’il avait accumulé une fatigue anormale
extrême et peut-être un taux d’acide
lactique ou de toxines graves, b) ou bien soit qu’il avait été lésés _ avec une
lésion invisible), conjuguant céphalées
de tension permanentes, invariables et intenses et insomnies totales. Après de multiples tentatives de repos total
pour rattraper la fatigue anormale, qui semblait perdurer dans mon cerveau (et
pour réduire le « dérèglement » cérébral) _ dont 3 retraites
spirituelles dans des monastères et une
dernière tentative, un repos total de 3 semaines, comportant des recherches
de sommeils de plus de 23 h par jours, dans une maison située au milieu d’une
forêt, qui elle a été couronnée de
succès (après ce repos total, je n’ai plus jamais eu d’insomnies) _ j’ai
réussi à vaincre définitivement l’insomnies (alors que les médecins la mettait
sur le compte d’une insomnie imaginaire). Les insomnies totales (très dures)
ont duré 2 ans. Les céphalées, elles sont devenues variables et plutôt modérés,
si l’on se base sur une moyenne pondérée, mais, elles durent, quand même depuis
27 ans (et le fond résiduel des céphalées n’arrive jamais à disparaître).
Par contre, tous les
autres tentatives, tout azimut, pour résoudre le 2nd problème n’ont
jamais réussi.
Mais cela n’empêche
pas que l’auteur continue à se battre _ y compris par ce texte. Il n’a jamais
perdu espoir.
5.2 Le travail ou l’activisme sans fin
Parfois, on peut aller jusqu’à devenir « accro »
au travail pour oublier
Mais ce moyen de diversion a tout de même ses
limites quand les maux de tête sont trop intenses.
Quand le mal de tête est intense, l’auteur
alterne alors :
a)
repos
de 5 à 10 mn, toutes les ½ heures _ dans son lit quand il est chez lui ou, sur
son lieu de travail, quand il peut
trouver un local où il peut se reposer discrètement, sans être vu[154],
b)
travail
durant 30 mn à 1 h.
Le « travail de musaraigne »,
choisi pour faire diversion aux maux de tête, peut être, par exemple,
l’écriture de textes, d’études, de nouvelles, de livres, de romains, cela sans
fin.
Souvent d’ailleurs, certains dans
l’association n’ont pas d’autres choix que travailler ou l’hyperactivité, car
quand la douleur est forte, ils ne peuvent pas se reposer longtemps (un repos
trop long ravivant alors la sensation douloureux)[155]. Ils
ne peuvent plus dormir et doivent se lèver alors la nuit pour s’occuper.
Ils peuvent aussi aller manger.
L’auteur a découvert la solution de
l’activité, sans fin, comme dérivatif à ces céphalées, en s’inspirant, entre
autre, de l’exemple de Sainte Thérèse d’Avila, qui souffrant le martyr avec des
céphalées[156],
a accompli toute sa vie une activité incessante de « musaraigne »,
pour faire diversion à ses maux de tête.
Les inconvénients de cette solution sont que :
1)
Une
trop grande activité, sans garde-fou, peut conduire à l’épuisement physique et
cérébral (Sainte Thérèse d’Avila est morte jeune à 67 ans, probablement d’excès
d’activité, probablement alternant activité effrénée[157] avec
des repos régulier dans son lit).
2)
Dans
l’esprit de beaucoup, dont celui des médecins, il peut y avoir inversion de la
cause et effet, dans leur esprit, l’activité incessante devenant, à leurs yeux,
la cause des céphalées, le cerveau se « rebellant » alors en émettant
ce signal d’alarme que sont les céphalées de tension[158].
5.3 Faire la fête sans fin
Certains, pour tenter
d’oublier leurs maux de tête lancinant et s’ils le peuvent, essayeront de se
faire prendre dans le « tourbillon » des fêtes sans fin, brûlant la
chandelle par les deux bouts, à la manière de Boris Vian. Souvent, il recherche
aussi l’effet antalgique momentané de l’alcool, et le fait qu’il permet de
s’oublier et d’oublier un peu les maux de tête[159] [160], si du
moins la douleur n’est pas trop forte. Cette vie de patachon pourrait aussi de
permettre de lutter, en soi, contre une peur ontologique, sans objet ou raison,
voire une peur de se retrouver face à soi-même.
Cette solution évitant
les pensées tristes, peut être une fuite en avant au coût élevé à la longue
(coût financier et pour
5.4 Œuvrer dans des actions humanitaires
Sinon, accomplir des actions
humanitaires _ quand les gens sont
heureux, à cause de vous _ peut être gratifiant et peut vous faire oublier
momentanément vos maux de tête.
Ce qu’à fait beaucoup de « saints ».
On pourrait alors s’inventer un rôle, une
mission, celle de s’occuper d’aider les autres qui souffrent comme vous,
puisqu’on connaît soi-même intimement le problème de la souffrance physique
chronique.
5.5 Rechercher les causes de ses céphalées
Un bon exercice est
de tenter de rechercher les causes possibles de ses céphalées (du moins si l’on
soupçonne une cause psychologique à ses céphalées chroniques). L’auteur s’est
essayé régulièrement à cet exercice intellectuel.
Par exemple, au bout
de 20 ans, l’auteur a cru discerner deux possibles causes déclenchantes
régulières à ses céphalées :
1)
A
chaque fois, qu’une personne cherche à le culpabiliser (avec méchanceté), à
l’invectiver d’une façon injuste (cause déclencheuse de terribles céphalées
pouvant durer des journées entières après),
2)
A
chaque fois qu’il est confronté à une difficulté professionnelle quelconque (là
aussi des céphalées _ très handicapantes professionnellement _ dureront tant
que la difficulté professionnelle durera).
Ces deux causes
sembleraient, elles-mêmes, liées à des traumatismes passés, voire anciens :
a)
Pour
les premières, à des épisodes survenues durant toute son enfance jusqu’à l’âge
de 25 ans (et au-delà).
b)
A
de nombreux licenciements professionnels, souvent accompagnés de reproches de
la part de l’employeur sur ses pertes de performances (justement liés à ses
crises de céphalées).
Pourtant, même en
ayant cette « connaissance », l’auteur n’arrive pourtant pas avoir
une meilleure maîtrise actuelle du déclenchement de ses céphalées (même en en
faisant en sorte de tenter constamment d’être irréprochable, par exemple, par
rapport à son employeur actuel … ce qui n’est pas toujours évident d’ailleurs
( !)).
Entre 88 et
maintenant, soit sur plus de 20 ans, il a eu régulièrement des difficultés
professionnelles à affronter (problèmes logiciels difficiles, incidents
informatiques), et malgré tous ses efforts, il n’a jamais vu une quelconque
évolution positive de ces céphalées face à tout affrontement de nouvelles
conditions professionnelles difficiles (incident informatique difficile à
résoudre …).
Cela serait peut-être
comme si le trauma originel avait été « enregistré » de façon
définitive dans son cerveau et qu’aucune
thérapie (ne serait que pour « apprivoiser » son inconscient)
n’arrivait à lever / ôter ce « conditionnement catastrophique » (ou
détruire « l’imprégnation » du cerveau avec ce « schéma
stressant »). Pourtant, bizarrement, il n’a jamais eu peur d’affronter
toutes les difficultés de la vie[161].
C’est pourquoi il
doute encore de la véracité (« scientifique ») des hypothèses
actuelles et même de ses propres hypothèses (car il n’a toujours aucune
certitude sur l’origine de ce mal particulièrement complexe).
Dans le passé, il a pu, par exemple,
« s’amuser » à émettre beaucoup d’hypothèses sur l’origine de son mal :
a) c’est peut-être une « crise de
panique » somatisée (qui serait profondément enfouie dans l’inconscient et
dont l’auteur n’aurait strictement pas conscience ?) ?
b) au-delà d’un seuil, il y aurait un système
d’alarme (situé dans le système nerveux central) qui s’armerait et se
verrouillerait provoquant alors le déclenchement des céphalées de tension, tant
qu’une certaine condition et un certain environnement déclenchant sont présents
et n’ont pas disparus (ou n’ont pas été atténués ( ?)) ? …
c) Cela serait un « état de stress
dépassé » (c’est à dire un état anormal de « dépassement cérébral »,
induisant un dérèglement physiologique, que notre esprit devrait parvenir à
gérer et à ramener à la normale à la longue, par une succession de repos,
ensuite en évitant les surmenages, le stress, enfin par une bonne hygiène de
vie ( ?)).
d) un phénomène de « culpabilisation
inconsciente », qui résulterait d’un conditionnement éducationnel puissant
_ créant une sorte d’emprunte mentale indélébile d’un « comportement de
culpabilisation » liée une « réaction de stress » dans la
mémoire, provoquant un mal de tête à chaque fois que le malade est confronté
dans sa vie de tous les jours à ce schéma culpabilisateur,
… Etc.
Mais réfléchir sur
les causes permet peut-être une distanciation par rapport au mal (raison
probable aussi de l’écriture de ce texte), si
bien sûr cette réflexion n’augmente pas parallèlement le « petit vélo dans
la tête » sur sa douleur. Donc ce genre d’exercice est à pratiquer
avec prudence. Il sera surtout utile que s’il pouvait déboucher sur quelque
chose de pratique allant dans le sens de la résolution du problème.
L’idéal
serait que ces réflexions puissent déboucher pratiquement sur des
solutions pour diminuer les céphalées.
5.6 La piste des « causes culpabilisantes originelles »
Dans l’éducation d’un
enfant, il peut y avoir des causes à l’origine de la fragilisation
psychologique de l’enfant. Il se peut que l’enfant soit fragilisé suite à des moqueries
systématiques, par le fait d’être une tête de turc, à une dévalorisation
familiale systématique et/ou des maltraitances réitérées.
Pour certains, la céphalée
est « une réaction de défense »
ou une peur (phobie) inconsciente d’une situation donnée, non désirée et
angoissante, qui se répèterait encore l ‘âge adulte, cette réaction étant malheureusement
contreproductive pour celui qui la subit.
Le malade,
conditionné à se dévaloriser, du fait de son éducation depuis la prime enfance,
continue à se dévaloriser, sans même s’en rendre compte, à l’âge adulte, ce qui
contribue à ce que le malade continue à ne pas être respecté ou moqué, par son
entourage. Le fait qu’il ne soit pas respecté dans le milieu professionnel et
plus l’atmosphère plus délétère l’entourant, peuvent contribuer à entretenir
ses maux de tête (du moins, tant qu’il n’obtient pas le respect minimum qu’il
lui est du).
Le plus dur pour le
malade est 1) qu’il en prenne conscience (voire qu’il ait le courage de se voir
telle qu’on le voit, dans la société, et non tel qu’il se voit), 2) de changer
le puissant conditionnement qui le pousse à se dévaloriser sans cesse (car
chasser le naturel, il revient vite au galop).
Apprendre à se faire
respecter n’est pas facile, et nécessite d’éviter bien des écueils, tels que a)
de tomber dans la méchanceté, en croyant, par là, se faire respecter (ou devenir
le héro négatif d’un fait divers dramatique), b) d’être trop gentil et, de ce
fait, passer pour la « bonne poire »…
C’est un travail sur
du long terme et difficile.
5.7 La pratique sportive intensive
Un membre de
l’association pratique régulièrement du marathon ou du semi marathon à haut
niveau, a observé que durant son activité sportive, ses céphalées
diminuaient.
L’auteur, lui-même,
ayant effectué, en 2006, une traversée en vélo sud-nord de la Norvège, de
Était-ce l’effet endomorphine
du sport à haut niveau ? L’auteur aurait tendance à le croire[163].
Mais restons quand
même prudent face à cette dernière affirmation et il faut encore pouvoir le
prouver.
Par contre, l’inconvénient
du sport intensif _ et/ou du sport d’endurance (et du sport aérobie) _ est
qu’il nécessite beaucoup de temps pour le pratiquer. Et à moins d’en faire son
métier, il ne peut être adaptable à tout le monde (d’autant aussi qu’il
nécessite beaucoup de courage et d’effort).
5.8 Compenser la réduction de nos facultés intellectuelles
Réduction de nos
facultés causée par la douleur.
Pour conserver son
intelligence (sa capacité de concentration) et lutter en permanence contre les
pertes de mémoires à répétition (voir ci-après) :
|
1) on peut prendre
du café et des excitants, à haute dose. Mais avec eux, il y a risque de
tachycardie et augmentation de la fatigue généralisées, à la longue (ceux qui
prennent trop de cafés en permanence, peuvent ne pas faire de vieux os comme
Balzac). Il semblerait aussi que chez certains, le café augmente l’anxiété. 2) On peut tout
noter sans cesse _ ses idées, ses rendez-vous, ses discours, interventions
etc. _, sur des carnets, des petits papiers, des Post-It, sur son PDA, dans
des mails pense-bête, sur son dictaphone, pour ne rien oublier. Cela afin, de
donner l’illusion aux proches et collègues de bureau qu’on n’est pas
handicapé intellectuellement. |
Les propres carnets
de l’auteur |
3) Attendre la
prochaine accalmie de ses céphalées :
Quand on souffre de
CTC caractérisées par une grande variabilité _ faisant se succéder, sans cesse,
sans fin, périodes de crises et de rémission, accalmi, répit _, et qu’on sait
que la période de répit va toujours revenir dans un éternel, on va alors attendre
celle-ci et tenir jusqu’à celle-ci. Fenêtre d’accalmie, qu’on espère de tout
son cœur et qu’on « appelle » de tous ses vœux.
On va espérer qu’on
va pouvoir rattraper le temps perdu, profitant en cela de chaque nouvelle
période de répit.
Bien que cette
solution ne peut marcher au niveau professionnel, que si les périodes de répits
sont suffisamment rapprochés. Ce qui n’est pas toujours le cas. Or dans
beaucoup de cas, on ne peut pas rattraper le temps perdu, c’est ce qui
caractérise d’ailleurs, justement, le fait d’avoir affaire à un vrai handicap[164].
Les céphalées quand
elles sont forte empêchent de dormir ou d’avoir un sommeil de bonne qualité. Il
faut donc essayer d’aménager des temps de repos plus long et aménagés sur toute
la journée, si cela est possible.
5.9 Arguments, un peu trop hyper-narcissiques, pour tenir
Des raisons pour
tenir malgré la douleur
permanente, peuvent être des arguments
et des justifications « orgueilleuses » (i.e. « narcissiques »),
comme ceux-ci, par exemple (voir ci-après) :
- Se dire, par ex., « J’ai
de la « valeur » (« je vaux quelque chose »). « Sans mes maux de tête très invalidants,
je pourrais écrire de nombreux livres » et « je pourrais laisser un legs (ou un apport) appréciable (ou
non négligeable) à l’humanité » ( !). « Je peux
apporter beaucoup aux autres » (quand je vais bien et quand j’ai peu
de maux de tête). « Je suis
intelligent » (quand je n’ai pas de maux de tête), « cultivé », « dynamique », « ouvert ».
- Et ainsi on liste toutes nos
supposées qualités morales et intellectuelles etc.[165].
- « Je suis très intelligent, je trouverais la solution à mes
céphalées », ou bien « grâce
à mon intelligence, je m’en suis toujours sorti, il n’y a pas raison que
je ne m’en sorte pas, de nouveau, une nouvelle fois ».
Il est certain que les arguments pour tenir
face à une douleur intense qui ne vous quitte jamais, ne sont pas toujours
rationnels (loin de là), comme ceux présentés ici. Bien sûr, il y aussi les
arguments « orgueilleux » (ou « narcissiques ») inverses,
tels que, par exemple, celui-ci qu’il faut combattre :
J’ai
envie de mourir (le choix de mourir)
« Je
suis tellement handicapé, tellement dans la confusion mentale, tellement avec
des problèmes de mémorisation incessants, que je deviens à la longue un assisté
perpétuel, devant sans cesse demander de l’aide à vos collègue pour réaliser
telle ou telle action dans votre travail. Je suis un bras cassé éternel. Je
n’arrête pas de commettre des erreurs professionnelles, pouvant aller jusqu’à
la catastrophe, du fait de ma confusion mentale. Et je n’ai plus envie que cela
continue » ou encore « Je n’ai pas envie de devenir une charge pour
En fait, je suis dans une situation
impossible, peut-être, parce que je refuse l’aide de mes collègues
bienveillants _ car il doit en exister _ et que je leur cache mes problèmes de
céphalées.
Peut-être, faut-il accepter de se faire,
aider et de faire preuve de plus d’humilité.
A quoi
cela sert de « jouer » au héro durant tant d’années, alors que je ne
vois toujours pas d’espoir au bout du tunnel (au bout de 10, 15, 20, 50 ans,
par exemple) et que mon mal n’est jamais reconnu ».
Pour répondre à cet argument, voir le
chapitre « espoir médical ».
6
Prévenir l’irrémédiable
Le
sujet est délicat, mais nous allons quand même l’aborder. Il n’y a pas
d’exemple de personne déprimée, fatigué, dormant mal du fait d’une douleur
chronique rebelle, qui n’ait pas « caressé », un jour, la pensée de
commettre l’irrémédiable. Pourtant, heureusement, l’homme a une capacité de
survie souvent stupéfiante (même face aux pires douleurs ou malheurs).
Face
aux pensées noires envahissantes, voici quelques pensées qui ont pu aider
(voire sauver) ou rappeler à la réalité les personnes tentés par mettre fin à
leur jour.
a)
« Il a des êtres qui m’aiment autour de
moi. Je peux faire souffrir mes proches (en voulant disparaître). Et je sais
que je ferais pleurer ceux qui m’aiment. Ais-je donc le droit de faire cela ?
Puis-je porter une telle responsabilité ? ».
b)
« Si je disparaître je gâche l’avenir de mes
enfants. Ils subiront le pire traumatisme de leur vie. Je dois donc, au moins,
tenir pour eux ».
c)
« Je refuse la vie, tout l’espoir ou encore je
manque de courage face à la vie et à ses difficultés, que tout un chacun
affronte. Or tout le monde a souffert dans la vie, tout comme moi (et certains
plus que moi et pourtant, ils ont tenus) ».
d)
« Si je me suicide, plein de bonnes choses (ou
de bonnes actions) que j’aurais pu accomplir, ne seront pas accomplies. Tous
les projets dont j’avais rêvé ne verront pas le jour ».
e)
« Je croie en Dieu et pourtant je veux
commettre un acte contraire de ses préceptes ».
Ce genre de raisonnement marche si la
personne malade n’est pas tombée dans une dépression trop grave.
Parfois, en parlant avec cette personne
déprimée, en lui apportant une vraie écoute, son désir d’en finir peut vraiment
disparaître comme par enchantement.
Il y a certainement
encore d’autres arguments pour tenir (comme il y en a aussi,
malheureusement, pour baisser les bras et ne plus se batte définitivement). A
vous de les trouver.
Tenir
jusqu’à ce que l’homme aille sur Mars (ou se repose sur la Lune).
Les américains ont annoncé qu’ils se
reposeraient sur la Lune dans 20 ans.
Et peut-être les hommes se poseront sur Mars
dans 30 à 40 ans.
C’est quand même une perspective passionnante,
quand on y réfléchit.
Sinon, les astronomes découvriront un jour
des exo-planètes, comportant, dans leurs raies spectrales, la présence d’ozone,
d’oxygène et de vapeur d’eau. Et en plus, elles seront d’une masse raisonnable
(1 à 4 fois la masse de la Terre) et situées dans la zone habitable d’un
système solaire (pas trop chaude, ni trop froide, ni trop éloignée, ni trop
proche). Or ces planètes, possédant toutes ces caractéristiques, sont
susceptibles d’abriter la vie.
Sinon, qui sait, un jour, il y aura la vraie
démocratie (pluraliste) en Chine, en Russie, en Iran, en Corée du Nord …
Donc, il faut essayer de tenir jusque là.
Sinon, l’écrivain de Science-fiction Isaac
Asimov écrivait « Si mon médecin me disait que je n'ai plus que six
minutes à vivre, je ne déprimerais pas. Je taperais un peu plus vite à la
machine » (point de vue que partage l’auteur).
La vie perçue comme une montagne à escalader
sans fin
A chaque fois, qu’il a pu, l’auteur a tenté
de réaliser un travail, une Oeuvre, une création utile pour les autres. C’était
à ses yeux, comme planter un piton, lors de l’ascension particulièrement dure
d’une montagne. Il préférait publier son travail en cours, même inachevé, que
de rechercher la perfection du travail bien achevé, car « un tien vaut
mieux que deux, tu l’auras ». Car aussi il profitait de chaque « fenêtre
de liberté » de diminution momentanée de ses maux de tête, pour pouvoir
avancer, de nouveau, dans ses travaux en cours. A chaque « fenêtre
d’ouverture », il en profitait, à chaque fois, pour planter son
« piton intellectuel » sur la montagne de la vie (certains
l’appelleront la montagne spirituelle). L’auteur a souvent travaillé par a coup,
durant une bonne partie de sa vie (durant les 27 ans qu’on duré ses céphalées
de tension régulièrement variables mais chroniques[167]),
selon que ses maux de tête lui laissaient du répit ou non (pour pouvoir
travailler et retravailler efficacement).
A chaque fois que l’auteur allait mal (que la
douleur était trop forte), alors l’auteur se lançait dans de nouveaux projets
ou défis (pour ne pas se laisser aller) _ cela a été aussi le cas avec ce
texte, tel un défi intellectuel.
L’auteur a souvent fonctionné, par
« à-coup », selon que les maux de tête le laissaient en répit ou non.
Les
sports extrêmes
Pendant la seconde guerre mondiale, alors que
pourtant la vie était dure et que l’on pouvait risquer sa vie tout les jours,
pourtant, durant cette période, le taux de suicide était bas, en France.
Les sports extrêmes et/ou à risques (sports
moteurs, aviations, parachutisme, saut de falaise…) vous font monter votre taux
d’adrénaline et donc éventuellement pourraient vous faire oublier momentanément
vos céphalées ( ?).
D’un autre côté, n’y a t-il pas un risque que
ce comportement « à risque » cache alors une attitude suicidaire ?
Fait-on preuve de courage ou a-t-on en fait une attitude plus ou moins
suicidaire (ou mégalo)[168] ?
Sinon, mieux vaut ne pas les pratiquer, si
l’on une famille à charge (l’auteur, lui, a pratiqué les sports aériens).
Se donner des échéances pour tenir
Se fixer des étapes à
atteindre dans le temps. Par exemple, se dire « je tiendrais au moins au-delà de mes prochaines vacances, qui auront
lieu en septembre 2009. Après on verra ». Et finalement ainsi, on repousse
sans cesse, sans fin, la date butoir, au-delà de laquelle on estime ne plus
pouvoir tenir, à cause des maux de tête.
7 Douleurs utilisées pour faire diversion à la douleur principale
Il arrive qu’on
utilise une douleur annexe pour tenter de faire diversion à la douleur
principale, même si cette solution paraît irrationnelle. Voici une solution de
ce type utilisée par le père Jean-Yves Thery :
« Prenons le cas d’un entretien pastoral : je
suis en présence d’une personne que je m’efforce d’écouter avec attention. La
douleur ne m’offre évidemment aucun répit providentiel et je suis contraint à
l’immobilité, ce qui arrive d’ailleurs forcément d’autres moments de
Un membre de
l’association, a relaté lors de l’AG de l’association qui s’est tenu à
Saint-Etienne, en mai 2008, qu’il s’était tapé littéralement la tête contre les
murs, pour faire cesser la céphalée (sans aucun résultat d’ailleurs)[169].
8 L’espoir d’une révolution médicale
Parfois, dans la
littérature, des déclarations intempestives comme celle que nous avons déjà
citées _ « Les psychotropes, les
psychothérapies et la psychanalyse ont
l'objectif commun de restituer ce
cerveau magicien, cette fonction hédonistique de la pensée. »[170] _,
peuvent faire douter des médecins de leur compréhension du mal.
Mais malgré tout, on peut attendre que la
science et le corps médical :
a)
Prendrait
enfin au sérieux notre mal.
b)
nous
guérirait … au moins avant l’échéance de notre vie (peut-être qui sait, dans
les 10 années à venir !).
Il est vrai que c’est un espoir très
hypothétique, pour l’instant, étant donné le peu de cas que les médecins font
de notre problème ( !). Légèreté des médecins qui conduit à l’énervement,
à l’agressivité « maladive » ou à la forte déprime (sinon graves
dépression), de la plupart d’entre nous.
Mais on peut toujours espérer qu’un
jour :
1)
ils
feront preuve de plus d’humanité à notre égard[171].
2)
qu’ils cesseront de
psychiatriser notre mal,
3)
qu’ils
accepteront de considérer notre mal comme une maladie grave, très pénalisante,
et nos céphalées comme sévères, ce qui permettra d’ouvrir la possibilité d’une
prise en charge COTOREP de notre mal.
4)
Que
d’autres traitements, d’ici là, seront découverts et mis en œuvre, comme
peut-être :
a)
Une
façon de « noyer » la zone douloureuse avec du Botox, tout en
trouvant un moyen de maintenir les muscles du cou (la solution serait que la
tête puisse être soutenue, même si la plupart des muscles péri-crânien seront
alors paralysés _ peut-être grâce au port d’une minerve)[172],
b)
Une
sorte de nouveau Triptan (une sorte
de Sumatriptan) qui prise au début de
la crise permettrait de les bloquer,
c)
des
séances d’oxygénothérapie ( ?) _ au cas où il aurait des mécanismes
communs entre les algies vasculaires de la face et les céphalées de tension.
d)
des
injections péri-crâniennes _ « mésothérapiques intramusculaires »
_ de certains produits (ions de calcium, de magnésium, de lithium ( ?) etc
…) ( ?) _ au cas où le mal serait en rapport avec une « susceptibilité »
aux crises de tétanies et de spasmophilie ou aux malaises vagaux.
e)
des
injections péri-crâniennes _ « mésothérapiques (idem) » _ de
produits anti-crampes, comme ceux à base quinine, tel la Quinidine _ si le mal
serait en rapport à une susceptibilité aux crampes etc.
f)
des
injections péri-crâniennes _ « mésothérapiques intramusculaires »
_ de produits myorelaxants et/ou décontractants musculaires, tels que
Myolastan, Décontractyl, Tetrazepam[173] …
g)
des injections péri-crâniennes _ « mésothérapiques
(idem) » _ de produits antidouleurs,
en cas de très fortes crises pas trop durables (comme la Xylocaïne, qui a un
effet sur plusieurs heures, mais dont l’effet d’accoutumance pourrait
malheureusement trop rapide).
h)
Des traitements (chirurgicaux…) à base de stimulation
médullaire ou stimulation électrique du cortex moteur (SCM) pour les cas graves
de douleurs constantes sur des dizaines d’années & sévères etc[174]
[175].
Etc.
On pourrait imaginer
le traitement antidouleur comme un coup
de pouce temporaire, provisoire, pour
pouvoir aider à redémarrer dans la vie dans
les meilleurs conditions possibles[176],
afin de pouvoir résoudre plus efficacement les problèmes psychologiques ou
autres, à l’origine de
Peut-être,
devrions-nous suivre aussi les pistes de possibles vulnérabilités ou susceptibilités
congénitales, comme pour les malaises vagaux et la spasmophilie, dans le cas ses
céphalées de tension chroniques (d’ailleurs, point de vue du docteur
Lantéri-Minet dans son livre et celui du livre « The headaches »
des médecins danois L. Bendtsen & Jes Olesen) ?
Que ce n’est parce
qu’on ne voit rien à l’IRM ou à la radio, qu’il n’y a pas maladie réelle (par
exemple, il pourrait exister a) un fonctionnement déréglé, de tout un système
complexe, d’un circuit complexe de la douleur, se déréglant comme dans le cas
de systèmes asservis déréglés, sans qu’on puisse déceler une lésion
physiologique quelconque, b) une microlésion cérébrale invisible à l’IRM,
certains structures cérébrales ne faisant que quelques m3 comme celles
impliquées dans la sexuation du cerveau[178] [179] [180] …
Ce qui est important
en émettant ces visions d’espoir pour les malades, c’est justement de faire en
sorte qu’ils puissent conserver l’espoir dans les progrès médicaux, envers et
contre tout, même si cela peut paraître irrationnel à certains.
Quand
on est croyant en Dieu ou la Science, on se dit qu’il n’est pas possible que
l’on puisse vivre ainsi toute une vie. Donc, la science va bien trouver une
solution ! Cela n’est pas possible qu’il en soit autrement !
9 Un espoir avec le cas de Christine
Le cas de Christine
est un cas exceptionnel, vraiment porteur d’espoir, car elle a réussi
« miraculeusement », volontairement ou involontairement, à se sortir
de ses céphalées de tension, au bout d’un an ou à peu près.
Voilà le dialogue que
l’auteur a eu avec elle pour tenter de comprendre comment elle s’en est sortie
(en annexe 10 « le cas de Christine » est exposé le dialogue, que l’auteur
et elle avons eu ensemble, pour comprendre les raison de sa guérison.
Peut-être, dans son cas, nous n’avons peut-être pas eu affaire à une céphalée
de tension chronique mais une céphalée épisodique mis en exergue par l’angoisse
de Christine (c’est tout le mystère de ce cas).
Pourtant, il semble
bien que la souffrance de Christine était très forte, donc il semble bien que
l’on n’avait pas affaire à une céphalée de tension épisodique.
En fait, il ne faut
pas minimiser la complexité des céphalées de tension. Car le schéma explicatif
pour les céphalées de tension de Christine peut ne pas être valable pour
certaines et autres céphalées de tension chroniques, celles, en tout cas, qu’on
n’arrive jamais à résoudre après des dizaines d’années.
Il faut donc rester
encore très prudent sur la question.
|
« Mes céphalées ont disparu après une année
environ de souffrance, avec vertiges, douleurs musculaires etc. ... il peut m'arriver d'en ressentir, ou
d'avoir une véritable migraine, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai
vécu. Je ne sais pas comment tout a disparu, il a fallu beaucoup de temps,
j'ai tout essayé et les premiers soulagements sont arrivés grâce à
l'acupuncture. Ce ne fut pas miraculeux, mais le médecin qui pratiquait
était très à l'écoute. […]. Je
n'aime plus penser à cette période si difficile, mais il faut laisser
l'espoir car ça peut disparaitre. Je
pense que l'on ne veut plus y penser du tout, moi même j'essaie de balayer
cette époque de ma vie, c'était une grande parenthèse pas bien agréable, mais
je garde une amertume envers les médecins, et la considération qu'ils ont
face à ce genre de problème, ils nous poussent à nous retrancher... ». « Progressivement
je dormais mieux [ …]. Je ne trouve
rien de précis qui ait pu causer l'arrêt [de mes céphalées], juste mes
angoisses envolées quand même, ce qui est peut être la raison. Pour moi la
situation stressante a été les vertiges, je me suis persuadée que
j'avais quelque chose de très grave. S'en sont suivis beaucoup d'autres
problèmes d'ordre neuro je pense… dont les céphalées mais aussi des sortes
de spasmes, des fourmillements etc. ... C'est un neurologue, qui
m'a vraiment convaincu que je n'avais rien de tout ce que j'imaginais, qui
m'a vraiment rassuré...Mais il m'a fallu le voir plusieurs fois pour que
je commence à le croire...et à penser autrement, il a aussi fallu
que les vertiges disparaissent... [… ]
au
moment des premiers vertiges, j'étais complètement épuisée, je
préparais les fêtes de Noël, et comme chaque année tout se passe chez moi,
le stress et les préparatifs sont pour moi également. Au niveau du travail c'était la
clôture annuelle avec des délais de paiements à respecter,
toutes les nouvelles formations à prévoir, les remplacements de
collègues aussi qui profitent des fêtes pour partir dans leur pays d'origine,
etc. .... Les "pots" de fin
d'année qui se multipliaient, et souvent le soir, au
Luxembourg, avec tous les collègues... Ma sœur qui avait
complètement coupé les ponts, situation que je vivais très mal...j'essayais
d'occulter le problème, mais j'en étais malade, et je ne pouvais pas en
parler, mon mari ne voulant plus entendre parler d'elle.....Ca me rendait
profondément malheureuse... Chaque année à ¨Noël, c'est plus
ou moins la même chose, je termine l'année épuisée... là il y avait le
problème avec ma sœur en plus.... La veille, j'étais encore au
restaurant avec l'équipe informatique, mais vraiment trop fatiguée.... A tel point que depuis je
refuse tous ces "pots" le soir en fin d'année avec mes collègues,
parce que j'ai toujours eu cette impression de lien entre la grosse
fatigue du soir et les vertiges du lendemain..... Donc c'est certain, il y avait un
tout ce que tu décris [état
d’épuisement, de fatigue dépassée] (mais ceci, dit j'ai eu des
moments plus difficiles je pense avant et
[mais ?] je n'en étais jamais arrivé à ce stade...). Le neurologue [vu] est docteur Scherrer de l'hôpital Bel Air à Thionville […] il m'a dit que cela ne partirait
pas comme cela, du jour au lendemain. Je suis retournée le voir beaucoup
plus tard en consultation externe, il m'a enlevé un gros doute, une grosse
peur que j'avais (je m'imaginais avoir une sclérose, à cause de drôles de
phénomènes musculaires...). Il m'a dit que chez moi, c'était
la façon d'évacuer un stress, comme certain ont des réactions cutanées (psoriasis, etc. ...). ce serait mon point fragile...J'ai beaucoup aimé son
écoute, (mais pas trop la première fois...), j'en avais assez de mon
généraliste qui me donnait l'impression de me prendre pour une malade
imaginaire.... Je ne sais pas si on peut le
conseiller à d'autres, moi il m'a apporté ce que j'attendais... Il m'avait prescrit du Myolastan
et du Di-Antalvic....mais surtout me demandait de faire mes exercices de
relaxation. ... Mais au départ je n'ai vu aucune amélioration. Puis Il y a un acupuncteur
formidable à Metz, qui s'appelle M. Giraudot (ou Giraudeau) qu'on m'avait
conseillé de voir. Je pense qu'il a été le premier à vraiment m'aider. […] il me rassurait avant tout. Souvent,
parce que les changements ont été longs, il me disait "rappelez-vous
dans quel état vous étiez la première fois que l'on s'est vus... " il
m'a donné le sentiment de prendre mon cas au sérieux, il m'aidait vraiment. Ensuite je suis retournée voir le
docteur Scherrer, en consultation externe, deux fois, et il m'a beaucoup
rassurée, il a réussi à faire sauter cette angoisse qui je pense
augmentait tous mes symptômes. Il n'avait pas de solutions miracles, mais
était si sûr de lui, il m'a même accueillie une fois avec une de mes filles,
et nous avons discuté tous les trois de ma façon "excessive" de
réagir au stress, et à l'angoisse. Et surtout il m'a dit que je n'avais rien
de grave, ce dont j'étais persuadée.... Voilà Benjamin, ce ne sont pas les
médicaments, mais ces personnes m'ont aidée à être moins angoissée,
j'entrais dans des états de panique et je n'en avais même plus
conscience, tout cela était comme un engrenage... il fallait aussi que je
l'admette. La discussion avec docteur
Scherrer et ma fille a été salvatrice. A partir de là tout a été mieux. Mais j'avais oublie de te parler
de docteur Giraudot, qui m'a aussi tellement aidée... ». |
10 Un changement d’attitude intérieure
10.1 Eviter d’être en colère
Eviter d’être en
colère contre Dieu, puis contre le corps médical, la société, ces deux derniers
refusant de comprendre et prendre en compte ce que vous vivez et vous vous
sentez piégés et impuissants[181].
Le père Jean-Yves
Théry dans son texte précédemment cité indique « Poursuivant son investigation méthodique sur la douleur chronique, l’auteur
[J.Y Théry] met en évidence que la
colère est une émotion qui aggrave le processus douloureux. Il s’agit
surtout de la colère qui n’est pas extériorisée, c’est-à-dire la colère dite «
rentrée », et qui le plus souvent se tourne contre soi-même. Cette colère
semble bien être la première étape d’un travail de deuil qui en comporte deux
autres : la tristesse-culpabilité et l’acceptation qui permet de se tourner
vers l’avenir. ».
Il est certains que
de s’en vouloir régulièrement a) de ne pas arriver à trouver l’issu à ses
céphalées chroniques, de ne pas comprendre d’où vient son manque d’intelligence
à ne pas trouver l’issue de sortie, b) de ne pas arriver à résister à la
douleur comme les héros antiques ou les saints qu’on citent en tant qu’exemples
édifiants, rend à la longue en colère contre soi-même (« je suis un âne
bâté ! » …), voire contre les autres, et rend dépressif.
Par ailleurs, la
société vous impose le plus souvent de faire preuve de pudeur et de discrétion,
de ne pas exposer votre souffrance, aux autres (cela pour éviter pour que l’on
vous prenne pour faible).
Et cette contrainte
peut engendrer à la longue colère et frustration. C’est pourquoi un temps de
parole avec une personne dont le métier c’est d’écouter _ psychologues[182],
prêtres _, peut être libératrice des tensions intérieures.
Que la colère ou la
rage accentue la douleur ? Peut-être. Mais la colère et la rage peuvent être
aussi une puissance motivation (ou un puissant moteur) pour agir et ne pas être
passif (ne pas être fataliste). Il faut qu’elle soit positivée (dans l’action,
l’aide, le soutien …).
Par contre, une
colère qui se maintient des dizaines d’années _ par exemple, contre le
corps médical _, ne peut faire du bien à la longue (vous ronge l’esprit). Dans
une sorte d’effet « retour », elle brouillera l’image que le corps
médical pourra avoir de vous (elle vous donnera par exemple l’image d’une
personne naturellement agressive).
Pour tenter de
diminuer cette colère rentrée contre le corps médical _ qui s’infecte, comme
une vieille blessure intérieure _, il peut être important de mieux comprendre
les blocages mentaux qui empêchent les médecins de vous soigner avec sérieux
(voir l’explication de ces blocages en annexe de ce document), voire d’avoir
une certaine distanciation avec eux, par exemple par l’humour, la dérision (si
vous le pouvez bien sûr), voire une certaine distanciation par rapport à votre
maladie (si vous le pouvez aussi bien sûr) (voir plus loin, pour l’arme de
l’humour et de la distanciation).
Il y a certainement
encore d’autres arguments pour tenir.
10.2 L’arme de l’humour et de la distanciation
Ou l’arme du recul par rapport à sa
souffrance.
10.2.1 L’arme de l’humour
Quand on est
suffisamment fort intérieurement (mais peut-on tous l’être ?), on peut se
moquer de soi-même, de sa douleur, de son côté douillet, devant une assemblée
d’amis, lors d’un moment joyeux, convivial. On se dira :
« Il est C.O.N. ce type, il embête tout le
monde, les médecins … Il ne fait que des bêtises au boulot. Il est bon à amuser
la galerie ! Tout cela c’est psychosomatique ! ».
10.2.2 L’arme de la distanciation et ne plus dramatiser
a)
Ci-avant,
nous avons exposé une arme de distanciation, celle de voir nos céphalées juste
comme un objet d’études scientifiques
intéressantes.
b)
Sinon,
il n’est pas facile de ne pas dramatiser quand votre situation financière est souvent
limite, que vous êtes sans cesse réellement sur le fil du rasoir, et que vous
êtes fait licencier à plusieurs reprises, du fait de vos céphalées chroniques.
L’auteur au début de
sa vie, avait des ambitions proprement démesurées. Il avait toujours tendance à
vouloir dépasser ses limites physiques, sportives, intellectuelles, en tout.
Par exemple, il a obtenu 4 diplômes ingénieur ou universitaire.
Or depuis ce jour
d’octobre 81, où il a ressenti une
douleur cérébrale fulgurante soudaine, il a du réduire toutes ses ambition
à la baisses.
Il lui arrive
maintenant de dire, tant pis :
a)
Si
son appartement est un véritable dépotoir,
b)
S’il
perd tout le temps ses emplois.
c)
Si
les gens ont une mauvaise image de lui.
d)
S’il
est vu comme mauvais ou constamment maladroit au boulot.
Rien n’est grave.
On peut arriver à
relativiser constamment tout ce qui auparavant avait de l’importance à vos yeux
(votre ambition, votre job, votre carrière) … Car avec les céphalées quand
elles sont régulièrement graves, pas de plan sur l’avenir possible, pas de plan
de carrière possible, pas de vie de famille possible, donc pas de famille à
fonder … « Take it easy ».
Peut-être que
finalement, l’auteur aussi prend prétexte des céphalées pour mettre
subrepticement certaines choses sur leur compte. Donc ne pas se donner le beau
rôle et/ou se donner des circonstances atténuantes « frère âne, botte-toi le train ! Un petit coup de banderille dans
les fesse et tu redémarreras toujours ! ».
Ce qui est important
finalement, aux yeux de l’auteur, c’est
la vie, l’amour et l’amitié. Donc ce qui restent importants sont a) de
se maintenir en vie et b) avoir des amis fidèles. C’est déjà très important.
Mais souvent pour
beaucoup, cela ne marche qu’un temps, et seulement si la douleur n’est pas trop
forte (qu’on n’est pas trop accablé par elle).
11 Autres techniques de survie
Voici une liste de solutions, d’idées, citées
en vrac, au petit bonheur la chance (voir ci-après) :
a) quand les maux de tête sont trop forts, rester
au lit strictement sans bouger, faire le vide intellectuel, attendre le
sommeil, vivre au jour le jour, ne s’inquiéter de rien (la vie sera faite de ce
qui arrivera), fatalisme …
b) envoyer des mails pense-bête du bureau au
domicile et réciproquement, pour éviter d’oublier, quand le mal de tête est
particulièrement handicapant,
c) quand on commence à bien connaître ses
collègues de bureau, à force de les côtoyer, leur expliquer progressivement et
avec prudence, son problème _ en tout cas expliquer son problème aux personnes
les plus compréhensive (tout en sachant que tous ne sont pas compréhensifs).
Puis, essayer de se faire aider par elles, quand vos maux de tête vous mettent
régulièrement en difficulté professionnelle[183].
d) simuler le fait qu’on travaille au bureau,
par exemple, en envoyant régulièrement des mails, en tapant des textes, en
consultant Internet … Mais ce genre de solution ne dure qu’un temps.
f) alterner travail et repos toutes les 30
mn, quand on vraiment mal,
g) quand la crise est moins forte, travailler
quand même, continuellement, pour tenter d’oublier les maux de tête et pour
éviter d’avoir le petit vélo dans la tête, consistant à y penser sans cesse
(1000 fois),
h) éviter de montrer qu’on déprime tout le
temps (pour éviter de faire marginaliser),
i) avoir de l’humour, faire semblant sans fin
…
j) Ne pas dramatiser, rester cool, prendre
son temps (en Malgache, prendre les choses « Mora mora », doucement,
doucement, prendre les choses doucement …).
k) Tenter de changer les relations patients
& médecins. Tenter de faire preuve d’amabilité avec les médecins même si ce
n’est pas facile.
l) Se dire que « la /ma fragilité est respectable, que le monde entier n’est pas composé
que de « winner » » (point de vue du psychologue Marcel Rufo). Du fait
de ne pas accepter leur fragilité, certaines personnes apparaissent, à autrui,
comme de « mauvais coucheurs ». Il faut peut-être accepter sa fragilité, voire même qu’elle est
peut-être congénitale ( ?) ou pour toute une vie ( ?). A voir.
m) éviter d’avoir de l’anxiété (résister au
désir de se presser), dès que l’on voit son train partir au loin.
12 Autres pistes de thérapies comportementales
a)
éviter
tous les comportements autistes, même si ce n’est pas si facile _ tel ne pas
être à 100 % avec les autres _ (comportement qui peut-être sinon vous
marginalisent). Eviter de se couper des autres (de rentrer chez soi, quand les
autres veulent vous inviter, même si au départ cela peut vous sembler une
torture).
b)
éviter
de vouloir aller trop vite en tout (d’être une musaraigne survoltée ou agitée).
c)
éviter les
comportements mesquins (ou qui manquent de courage).
d)
ne
pas prendre les céphalées comme prétexte à tous ses propres malheurs ou comme
la cause de tous ses échecs graves dans la vie.
e)
éviter
les personnes stressantes ou qui seraient causes déclenchantes de nos
céphalées. Question : mais comment alors les éviter ?
f)
En
cas de « pincement d’anxiété » au niveau du ventre, faire des
exercices de respiration.
g)
relativiser
les évènements stressants comme : 1) les dangers graves pour mon emploi,
2) les lettres recommandées annonçant de mauvaises nouvelles. « Take it easy ». Rester calme malgré
tout. Les aborder et les traiter avec calme, sans faire la politique de
l’autruche (sans les refuser mentalement). Les traiter méthodiquement,
rationnellement.
h)
Essayer
de maîtriser l’anxiété constante de tout ou oublier sans cesse, du fait de ses
céphalées (même si ce n’est pas facile).
i)
éviter
de déprimer face à l’accumulation de mauvaises nouvelles en même temps (y
compris quand des événements négatifs,
aux effets délétères se conjuguent avec les maux de tête).
j)
Faire
en sorte de pardonner plus souvent[184] (pas
facile toujours). Il est plus facile de pardonner, si l’on ne veut pas dans la
frustration de ne pas trouver d’issue, et qu’on contraire on a pu réussir, par
exemple pu obtenir une reconnaissance, telle une reconnaissance COTOREP.
Celle-ci peut changer une vie. On n’a plus à s’angoisser sur son avenir et on
peut alors plus pardonner.
k)
Accepter,
avec bonne volonté, les conseils des « bonnes âmes » bien
intentionnées (même s’ils sont souvent agaçants et le plus souvent inutiles,
car étant ignorant totalement de ce que le malade vit vraiment au jour le jour).
l)
Accepter,
avec bonne volonté, sans jamais s’énerver, que des personnes ne comprennent
pas, manquent particulièrement d’intelligence (ou soit butée,
« bornée »), aient peu de connaissances culturelles, s’attachent
obsessionnellement à certaines idées erronées (comme un enfant à son doudou),
ne puisse jamais changer durant toute une vie, tout en pourrissant l’existence
de ceux qui les entourent, sans jamais s’en rendre compte, tout en se
considérant toujours comme une victime, du fait de leur maladie mentale le plus
souvent inguérissable (narcissisme extrême, paranoïa).
Une thérapie
comportementale est un travail de fond sur son comportement et aussi sur sa
compréhension de la vie, souvent difficile et long ou/et très subtil. C’est
peut-être comprendre, par exemple :
a)
qu’on
fait preuve d’une certaines naïveté _ envoyant un certain signe (aux sectes et
escrocs) _ quand on dit autour de soi « je ne m’intéresse pas à l’argent ».
b)
qu’on
ne fait pas du travail personnel sur le lieu de travail (même si on a
l’impression de ne pas voler son employeur, relativement au temps qu’il est en
droit d’exiger de vous pour réaliser telle ou telle tâche).
c)
On
n’aura peut-être pas la même tenue, discours ou sujets d’intérêt, avec des
collègues anarchistes ou des collègues BCBG …
13 En conclusion provisoire
Dans ce texte, nous avions plusieurs messages
à transmettre :
- Aux médecins,
- A la société,
- Aux membres de
l’association.
- A ceux qui
souffrent de céphalées de tension chroniques invalidantes et qui n’ont pas
encore rejoint l’association.
13.1 Messages à destinations des médecins
Tout ce que les
malades vivent comme quelque chose de terribles n’est par reconnu comme un mal
sévère, par les médecins et surtout l’International Headache Society, l’IHS, en
2004. Ils pensent encore que les céphalées de tension chronique ne pouvent être
intenses, cela sur des longues périodes ou non. Ils pensent toujours qu’elles ne
peuvent qu’être légères à modérées sur de longue période.
1. De nombreux
médecins pensent que le ressenti des malades pour leur douleur _ surtout
quand ils affirment qu’elle est très intense _ n’est qu’imaginaire ou exagérée[185].
Cette minimisation du
mal et l’optimisme médical affiché _ affirmant que le mal est facile à soigner
et guérir _ est en contradiction avec le fait que les malades _ en tout cas
pour un certain nombre d’entre eux _ sont pourtant dans l’urgence, souffrant
réellement d’un handicap sérieux avec pertes de mémoire, difficultés de
concentration sans fin, impossibilité de conserver son emploi, d’en chercher
et/ou d’en retrouver un, certains étant au chômage depuis 4 à 6 ans. Quant
« à tenter de faire comme si »[186],
c’est souvent trop dur pour eux et ils n’y arrivent pas[187].
a) Or le fait que les tous les dérivés opiacés,
sans aucune exception, réduisent la
douleur de tous les malades, qui en ont pris et qui souffrent de céphalée
de tension d’une façon très importante,
jusqu’à la faire disparaître totalement, prouve
que la douleur existe bien[188].
b) L’affirmation
répandue que l’intensité (douloureuse) de la céphalée de tension est « légère
à modérée » (y compris pour la céphalée de tension chronique) provient de
la classification de l’IHS réalisée par Olesen J., en 1986. Or en 1986, on ne
connaissait rien aux céphalées de tension[189]. Or
cette classification, mise à jour en 2004, n’a pas évoluée pour les céphalées
de tension depuis 86. Et comme nous l’avons indiqué plus haut, jamais aucune
étude épidémiologique sérieuse, sur le long terme, n’a été effectuée sur les
populations souffrant de céphalées de tension régulière. En particulier, aucun
suivi médical sérieux des malades n’est effectué en France, excepté pour les
personnes acceptant de se soumettre aux prescriptions de psychotropes (et
encore). Donc ces affirmations ne sont que des présomptions et surtout pas des
affirmations scientifiques (dans le contexte actuel).
2. Ils pensent aussi qu’il
n’y a aucune preuve scientifique que la douleur (alléguée par le malade) peut
être intense ou sévère, puisque par exemple :
a) les
électromyogrammes seraient peu significatifs.
b) que le profil
psychologique des malades serait souvent anxieux et/ou dépressif.
Nous répondons à ces
affirmations par les arguments suivants :
a) Comme l’indique le
docteur Lantéri-Minet, dans son ouvrage, on
ne connaît toujours pas les mécanismes causaux de
b) Comme nous l’avons
déjà dit plus haut. Il y a effectivement une population significative de
personnes anxieuses chez les « céphaleux » de tension chronique. Mais
le profil psychologique anxieux visible du malade est peut-être l’arbre qui
cache
c) Il y a un préjugé
médical prégnant datant de l’antiquité entretenant l’idée inconsciente dans le
corps médical, qu’une douleur ne peut être sévère, sur le long terme[190],
conforté en cela que les douleurs estimées les plus fortes _ comme celles de
l’algie vasculaire de la face, de la drépanocytose … _ se manifestent toujours
forme de crises à durée limitée dans le temps[191]. Or il
n’y a aucune raison scientifique a priori allant à l’encontre de la possible
existence de douleurs de longue durée sévères.
Autre argument, face
à des douleurs de longue durée sévères,
le malade se suiciderait immanquablement. Or nous avons prouvé que a) la
présence d’un entourage aimant et/ou compréhensif envers le malade et b) le
recours à différentes « techniques de survie », présentées dans ce document,
peuvent aider le malade à tenir.
2. Que la douleur durable de la céphalée de
tension ne peut réduire l’intelligence, la capacité de concentration ou celle
de mémorisation (surtout celle à court terme) du malade. Et donc, il n’y a
pas de d’handicap avéré, ni impossibilité de trouver ou de garder son travail.
Dans son ouvrage, le
docteur Lantéri-Minet reconnaît l’importance du coût pour la société a) des
arrêts de travail et l’absentéisme, b) la multiplication des consultations et
des examens, dans le cas de céphalées de tension chroniques[192].
3. Nombreux sont les
médecins qui pensent que si la douleur est sévère _ considérée comme
insupportable par le malade[193] _,
c’est que alors se dissimule un abus
médicamenteux derrière la céphalée chronique du malade.
Or nous avons une
majorité de malades dans notre association, qui ne prend plus de médicaments
depuis de nombreuses années (lassés par les résultats très insuffisants obtenus
avec les médicaments), et qui souffrent toujours d’une façon intense.
4. Selon les
médecins, les céphalées de tension chroniques graves seraient soignables par
les traitements habituels de toutes les maladies psychosomatiques (par les
traitements à base de relaxation, psychothérapie analytique et comportementale
et médications « adaptées » _ tels qu’antidépresseurs,
anticonvulsivants, décontractants musculaires). Or dans la pratique, bien des
malades de notre association ont vraiment tout essayé sans aucun résultat (voir
l’annexe sur les traitements de Bernard).
Pour bien des médecins,
il suffirait que le malade, souffrant de céphalée de tension, résolve, par une
bonne thérapie, ses problèmes de confiance,
de peur, d’angoisse, de honte ou/et de culpabilité pour que sa céphalée
disparaisse. Cet optimisme médical n’est malheureusement vérifié pour la
majorité des malades de notre association. Le mal est souvent plus grave et
tenace que les médecins se veulent bien le représenter.
La dépression, si
elle existe, est plutôt liée à la durabilité (persistance) et à l’intensité de
la douleur, que le contraire. Et l’angoisse ; s’il y a lieu, est plutôt
lié au caractère spectaculaire et intense de la douleur, à sa ténacité
extraordinaire, quelque soient les thérapies entreprises, même les plus
sérieuses et rationnelles, et b) à la peur pour son avenir en particulier pour
son avenir financier, quand par exemple la douleur vous casse et vous oblige à
un chômage de très longue durée qui vous empêche de retravailler quelque soient
ses efforts.
Or seule une étude
scientifique sérieuse indépendante (par exemple menée par l’agence de santé)
pourrait valider ou invalider toutes ces affirmations (de quel bord que ce
soit)[194].
Le problème du scepticisme
médical systématique face au discours du patient souffrant de céphalées de
tension
Les malades sont très
souvent confrontés à un profond scepticisme de la part des médecins face à leur
discours[195][196] (ils
ont presque, sans cesse, l’impression de parler du « monstre du Loch
Ness » ou d’OVNI). En fait l’impression de jamais être entendus par les
médecins, surtout quand ils affirment à ces derniers les faits suivants :
a)
les
céphalées de tension chroniques peuvent être extrêmement douloureuses (quand par exemple, elles surviennent sous
forme de crises ou même quand elles sont totalement constantes et tout le temps
très intenses, sur plus de 10 ans, comme, par ex., dans le cas d’un membre de
l’association, C.)[197],
b)
quand
elles sont très douloureuses, elles peuvent faire perdre la mémoire et toute
capacité de concentration.
c)
A
cause de ces dernières, on ne peut réellement plus travailler, même en faisant
tous les efforts possibles. De ce fait, elles peuvent réellement nous faire
perdre fréquemment notre emploi tant que dure la céphalée.
Or le
corps médical, dans sa majorité, préfère penser que les malades _ souffrant, comme
moi, de céphalées e tension chroniques très invalidantes _, souffrent en fait d’une névrose
obsessionnelle gravissime, d’une hypocondrie, d’un état borderline ou d’une
dépression cachée ou encore « rationnalise » leur
« obsession »[198]
… plutôt que de reconnaître l’existence du mal en lui-même. Dès que le
mot magique de « céphalée de tension » est prononcé, le malade est
alors confronté, à un mur imperméable, impénétrable, pénible et pesant, sans
cesse opposé au malade, par le corps médical[199].
Quand l’auteur écrit ce long texte, les
médecins préféreront y voir l’effet d’une névrose
obsessionnelle gravissime (ou l’effet d’une focalisation non
« légitime » sur mes maux de tête), au lieu de voir a) qu’il y a
un réel problème, b) que le malade cherche à le positiver, c) qu’il ne délire
pas.
Nous espérons donc, qu’avec la lecture de ce
document, les médecins auront l’intelligence et la finesse de comprendre que
d’écrire un tel texte demande à l’auteur, constamment, des efforts énormes pour
lutter contre ses propres maux de tête (et ses pertes de mémoires) et beaucoup
de temps[200].
Que de rédiger un tel texte n’est pas la preuve « finale » que
l’auteur ne souffre finalement d’aucun handicap. Quel pour palier à ses
problèmes de mémoire à court terme liés à ses céphalées, pouvoir exposer toutes
les idées exposées dans ce document, il consigne systématiquement, sans cesse,
toute nouvelle idée dans des bloc-notes, pour pouvoir en oublier aucune.
Que s’il est rédige un tel travail (si
volumineux), ce n’est pas par « focalisation obsessionnelle » sur
« sa petite douleur » (ou sa « petite personne »), mais
parce qu’il y a un réel problème de céphalées pénalisantes[201].
Toutes les informations très intimes, confidentielles fournies par les malades, dans leur
témoignages et dont il accepte la publication dans ce livre, ne sont pas le
fruit d’une complaisance quelconque sur eux-mêmes ou une focalisation excessive
sur leur mal. Ils les fournissent, au contraire, aux médecins, pour essayer de leur faire comprendre autant que possible, le pourquoi du comment de
leurs céphalées.
Sinon, d’être psychiatrisé en permanence ou
d’être pris comme quelqu’un qu’il ne faut surtout pas écouter (car
hypocondriaque), ce n’est jamais agréable pour les patients[202].
Au lieu de traiter en priorité notre douleur,
qui est notre priorité et revendication principales, les médecins préfèrent
souvent chercher midi à quatorze heure et rendre les choses vraiment
« tordues ». Et surtout, ils n’écoutent pas alors que l’écoute est
essentielle quand on souffre (on supporte mieux la douleur quand le médecin s’y
intéresse).
Certains médecins semblent se renvoyer la
balle[203]
[204].
Certains parce qu’ils ne veulent pas prendre
de risque ou avoir de problèmes.
D’autres se raidissent orgueilleusement et
s’enferment dans une attitude de défense, croyant qu’on les attaque dans leur
pratique, au lieu de comprendre que le malade souhaite sincèrement et
positivement les aider à résoudre le mal[205].
13.1.1 Sur la sévérité de l’intensité douloureuse des céphalées de tension
De formation scientifique très poussées (BAC
+ 7, 2 diplôme d’ingénieur, des DEA en physique), l’auteur sait quand même reconnaître ce qui est très douloureux,
par exemple, a) quand une céphalée peut provoquer des nausées (hors de toute
prise de médicaments), b) quand elle vous fait perdre systématiquement la
mémoire, c) qu’elle vous empêche totalement de travailler. Et l’auteur ne pense
pas être totalement « dingo »[206] quand
il affirme tous ces faits précédents handicapants.
13.1.2 Sur les pertes de mémoires et difficultés de concentration graves liées à mes céphalées
L’auteur rencontre toujours beaucoup de
scepticisme quand il affirme, aux médecins, que mes céphalées me font
perdre régulièrement la mémoire ou m’empêchent de me concentrer, durant mes
crises de céphalées et alors que pourtant
l’auteur ne prend aucun médicament depuis presque 10 ans et qu’il n’est pas
dans un état de dépression grave (à ce qu’il sache, du moins).
Pourtant _ même si l’on en parle peu dans la
littérature médicale _, ce fait de perte de mémoire liée aux céphalées est
pourtant connu, mais ce cas est surtout pour les migraines (qui en général sont
plus douloureuses que les céphalées de tension, sauf exception).
Par exemple, dans le « Référentiel National CEPHALEE AIGUË ET
CHRONIQUE (188) »[207], il
est indiqué dans l'interrogatoire pour obtenir les signes d’accompagnement de
la céphalée _ un des éléments du diagnostic _ : « ralentissement psychique, troubles de la mémoire ou des autres
fonctions cognitive ».
Dans « The Neuropsychology of Recurrent Headache »[208], le
Docteur Dominique Cazin écrit « De
nombreux auteurs ont identifiés des déficits cognitifs mais un nombre presque
aussi important n’en rapporte pas. ».
13.1.3 Contribuer à une étude scientifique précise de la maladie
A part des études
indépendantes menées au Danish Headache Center au Danemark[209], la
plupart des études qu’on trouve dans le monde concernent l’utilisation de
psychotropes, en général optimistes, faites des médecins rarement indépendants
(consciemment ou non) par rapport aux grands groupes pharmaceutiques. Or nous
savons la puissance de lobbying de ces derniers.
Comme l’a dit le
Docteur Lantéri-Minet, dans son ouvrage (ibid), on ne sait pratiquement rien
sur les mécanismes causaux réels des céphalées de tension, en particulier dans
leur forme chronique. En particulier nous ne savons toujours rien sur (voir
ci-après) :
a)
La
prévalence de la maladie, en particulier dans sa forme grave, invalidante. Quel
est le rapport en pourcentage entre céphalée de tension épisodique et céphalée
de tension chronique _ pourtant cette étude serait nécessaire, ne serait pour
en estimer précisément son coût social et son coût pour la sécurité sociale[210]. Cette
étude très poussée sur la prévalence de maladie, en France, manque
« cruellement ».
b)
Tous
les médecins sont convaincus que la douleur, ressentis par le malade, provient
de la contracture douloureuse des muscles péri-crâniens. Or depuis plus de 40
ans, il n’existe aucune étude précise prouvait ce fait ? Or en 81, le
Professeur neurologue australien James W. Lance avançait que les céphalées de
tension seraient liées à une diminution du flux sanguin dans le cerveau. Et si,
en fait, la douleur était liée à un rétrécissement constant (et non pulsatile
comme dans les migraines) des vaisseaux sanguins péri-crâniens (provoquant une
diminution de l’oxygénation, cause de la douleur) ? En fait, personne ne
le sait (!)[211].
Même si le malade a
employé un nombre important de moyens pour aménager sa vie autour de sa douleur
_ puisqu’il n’arrive pas à la maîtriser et la réduire, par sa propre volonté _,
il reste souvent en lui, une certaine frustration et amertume envers le corps
médical, surtout si la douleur a duré très (trop) longtemps. Et le recours
ultime reste quand même, à ses yeux, la médecine et la science pour arriver un
jour à soulager durablement sa douleur.
13.1.4 Une prise vraiment sérieuse de la maladie
Ce que les malades souhaitent est que leur
maladie soit prise, avec beaucoup plus de considération et de sérieux, qu’elle
ne l’est actuellement et qu’ils ne soient plus psychiatrisés ou pris pour
malade mental, par le corps médical.
13.1.5 Le coût caché des céphalées de tension chroniques
L’auteur en est sûr, si les médecins
effectuaient enfin une étude épidémiologique poussée, ils constateraient, très
sûrement, que le coût des céphalées de
tension[212]
pour la société _ par l’absentéisme, les périodes de chômages à répétition,
les pertes constantes de performances professionnelles, les multiplications,
éventuellement étalées sur toute une vie, des examens médicaux _ sont, en fait, assez élevées en France.
Ne pas en tenir compte ou faire la politique de l’autruche coûte, à mon avis,
beaucoup plus cher qu’en tenir compte.
Et donc, si, par exemple si on pouvait
établir les causes déclenchantes des CTC et si on pouvait les prévenir en
détectant les conditions favorables à leur survenue _ en particulier, en les
prenant vraiment enfin au sérieux _, une
telle approche permettrait de faire gagner beaucoup d’argent à la Sécurité
sociale.
Anticiper la survenue des CTC (de la
maladie), afin de faire gagner de l’argent aux CPAM, serait par exemple :
1) de former tous les enseignants et acteurs
de l’éducation nationale à repérer les traumatismes ou/et les maltraitances
chez l’enfant (le signe le plus fort étant le fait que l’enfant s’isole, est marginalisé
ou est pris comme tête de turc par ses camarades), si, bien sûr, si l’origine
des CTC étaient liées à de tels épisodes[213],
2) peut-être prendre
la CT de vitesse (si possible très vite), par exemple a) en éloignant aussi
vite que possible le malade des conditions initiales ayant déclenché sa CT[214] et b) en
contribuant à ce que les corps médicaux et sociaux puissent fournir, au malade,
des conditions aménagées afin qu’il
puisse affronter sa maladie, dans les meilleures conditions.
C’est, selon
l’auteur, une approche (analytique) bien plus rationnelle[215] que
plutôt de se contenter de donner juste des psychotropes (qui masquent le
problème, mais ne le résolvent pas).
13.2 Messages à destinations des membres de l’association « Papillons en cage »
Certains malades
perdent espoir pensant quoiqu’ils fassent _ quelque soient leur combats _
« leur maladie sera toujours considérée comme psychosomatique[216],
donc elle ne sera pas vraiment à prendre
au sérieux, en tout cas « pas plus que cela ». Qu’elle sera toujours
considérée comme « légère » par les médecins ».
Par exemple, L.,
journaliste dans un journal de province, à la retraite, âgé de plus de 70 ans, qui
souffre depuis 50 ans de la maladie (depuis l’âge de 16 ans), écrivait
récemment à l’auteur « j’ai
tellement cru que je finirais par trouver une solution, que depuis quelques années je n’y crois plus ». Un membre
avait déclaré lors de l’AG de l’association Papillons en Cage de juin 2009
« Je ne crois plus à ma
guérison ». L’auteur lui-même l’a dit à cette même réunion.
L’auteur pense lui,
qu’il ne faut pas désespérer, qu’il n’y a pas de fatalité dans ce domaine, ou
comme dans tout domaine de
Tout dépend bien sûr du
nombre d’années nécessaires pour que cette solution arrive enfin[217].
Au sein de
l’association, nous pourrions jouer de « catalyseur » pour
l’accélération de la connaissance de la maladie, en apportant nos témoignages,
en apportant notre concours pour des études scientifiques (y compris pour la
réalisation d’investigation et de statistiques) et par la publication d’un
ouvrage que nous projetons de rédiger.
Par ailleurs, pendant
longtemps, la fibromyalgie, touchant majoritairement les femmes, suscitait
l’incrédulité de l’entourage et des médecins[218]. Idem
pour les douleurs causées par la drépanocytose, une maladie génétique[219].
De plus en plus des
médecins (donc le docteur Lantéri-Minet) pensent que dans le cas des céphalées
de tension chronique des disfonctionnements ou dérèglements du système nerveux
central peuvent intervenir et pas uniquement des causes psychosomatiques.
Les choses évoluent
donc, même si cette évolution ne va pas assez vite au goût des malades.
D’autre diront encore
que cette initiative de l’auteur n’est juste une initiative isolée, l’auteur étant
lui-même isolé, dans sa démarche qui se veut scientifique. Or comme, il n’existe toujours aucune étude
épidémiologique sur la prévalence et la gravité des céphalées de tension
chroniques, en France et dans le monde, il y aura toujours le risque
permanent, pour les malades les plus
graves, étant donné leur faible population dans le monde ( ?), que ces
derniers n’apparaissent juste, aux yeux des médecins, que comme des «ratés» des traitements actuellement utilisés, sans que pour autant, cela ne remette jamais
en cause les traitements et la prise en charge actuels.
En tout cas en
attendant que les choses évoluent, notre association a pour but que personne ne
soit laissée et abandonnée au bord du chemin. Toute personne a le droit à sa
chance dans
Nous sommes tous
motivés, au sein de l’association, a ce que cette situation intenable ne
perdure pas. Nous sommes tous solidaire et si l’un d’entre nous est validée,
indisponible du fait de sa malade, un autre alors reprendra le flambeau, pour
continuer son action[220].
Un membre lors de
l’AG a déclaré « Il ne faut pas pleurer sur son sort, pas de
sensiblerie ». L’auteur pense,
malgré tout, que, même s’il ne faut pas
trop s’attarder sur soi, on n’est pas fait, non plus, d’airain, nous
ne sommes pas surhumains. On a aussi nos limites. Donc, on peut se pleurer, un
bon coup. Ce qu’il faut surtout c’est éviter de couler. C’est juste le rôle de
l’existence de l’association et de la solidarité entre ses membres, pour éviter
de couler. Quand cela va mal, il faut pouvoir compter sur les autres.
Comme, il n’existe
pour l’instant pas de solution miracle, pour tous les malades souffrant de céphalées
de tension chroniques, pour leur faire mieux supporter la douleur, alors le
soutien des proches, l’amitié (sur laquelle on doit pouvoir compter), certains
dérivatifs pour nous permettre d’oublier la douleur, enfin l’existence de
l’association et la solidarité entre personnes souffrant comme vous … sont importants pour nous.
Au sein de l’association, nous tenterons de
trouver des solutions, que nous nous communiquerons entre nous, pour que chacun
d’entre nous puisse conserver son optimisme, sa Foi en l’avenir et accepter les
difficultés à venir. Et même si ces solutions ne sont pas totalement
satisfaisantes, elles existent malgré tout. A nous de les découvrir.
Bien sûr, tous les
malades espèrent que la science résoudra enfin leur problème[221]. Justement,
ce texte pourrait constituer, pour nous tous, comme une bouteille à la mer
lancée, dans ce sens, vers le corps médical.
Enfin, il est certain que si les médecins
étaient plus « attentionnés » à notre égard, cela nous aiderait déjà
aussi beaucoup.
Pour finir, la seule urgence et solution
reste, quand même, une vraie solution médicale à notre problème. Et dans ce
cadre, les médecins détiennent, encore et toujours, pour l’instant, la clé et
la solution à celui-ci.
Poste 01.42.62.49.65 / Tel : 06.16.55.09.84 / tél. n2 : 06.03.80.55.66
benjamin.lisan.prestataire@fr.sfr.com
14 Annexe : comprendre la démarche médicale envers les CTC
14.1 Introduction sur cette démarche et le problème qu’elle pose
Ce sujet est très
délicat et peut apparaître comme polémique envers le corps médical. Mais nous
devons pourtant l’aborder. En effet, les malades _ ceux qui ressentent une
douleur sévère, lancinante, incessante, sur des années, liée à leur CTC _, ne
comprennent pas pourquoi, durant toutes ces années, le ressenti de leur douleur
est systématiquement minimisée, pas pris au sérieux (systématique dévalués au
niveau de l’évaluation médicale de leur douleur) ? Pourquoi sont-ils aussi
sans cesse psychiatrisés, toujours considérés comme névrosés obsessionnels, borderline, bipolaires
etc. par les médecins ? Pourquoi leur cherche-t-on la petite bébête ou des
poux psychologiques dans la tête[222], au
lieu de mettre l’accent et la priorité, d’abord, sur le traitement de la
douleur du malade ?
Un malade affirmait
récemment à l’auteur « Dès que les
médecins ont obtenus leurs diplômes, ils se sentent au-dessus des autres. Tout
ce que dit le médecin doit être pris comme parole d’évangile. Ils ont le droit
d’être critique envers mon discours. Mais je n’ai pas le droit, à mon tour, d’être
critique envers leur pratique ou leur discours ».
Un autre affirmait,
encore récemment « il n’y a pas
plus impossible remise en question
de soi et de sa pratique, que celle d’un médecin ».
Cette approche,
contreproductive pour le malade[223],
est-elle liée juste à une incapacité pour le médecin de remettre en cause le
paradigme[224]
médical sur les CTC, auquel il adhère et à une impossibilité de remise en cause
sa pratique médicale pour les CTC, en relation avec ce paradigme ?
Qu’en est-il
réellement ?
Ce qui suit ci-après
permettra de mieux faire comprendre pourquoi
les médecins ne soignent pas les malades souffrant de céphalées de
tension comme les malades le souhaiteraient _ par exemple, a) soit par une
contribution permettant, au malade, de bénéficier d’une COTOREP, b) soit par la
recherche de nouvelles molécules ou par l’utilisation d’un traitement plus
efficace etc.
Il est important,
pour les malades, de comprendre quels sont les raisonnements médicaux (et leur
provenance) qui contribuent à ce qu’ils soient soignés d’une certaines manière
ainsi et pas d’une autre. L’auteur espère ainsi que cette explication
contribuera à ce que les malades soient mois en colère ou déprimé face aux
médecins et à leurs pratiques actuelles.
14.2 Origine philosophique de la minimisation des douleurs chroniques
De tout temps, les
douleurs chroniques ont toujours été minimisées et s’en plaindre est considéré
comme une faiblesse de caractère voire une lâcheté.
Et l’auteur ajoutera
ses propres commentaires, concernant certaines affirmations antiques et
actuelles.
Pour les stoïciens, la
primauté de la vertu sur la douleur permet donc d'effacer la douleur qui cède
le pas devant la vertu. ("cedet profecto virtuti dolor."), alors que
l'homme qui cède à la douleur (par des plaintes par exemple), sera jugé indigne du nom même d'homme par
autrui. ("te vero ita adfectum ne virum quidem quisquam
dixerit."). Il sera jugé lâche.
Selon Cicéron, il
faut maîtriser la douleur, puisqu'on ne peut pas l'éliminer. Une arme : le courage ; un moyen d'utiliser cette
arme : les exercices d'endurance
(l'entraînement) (exercitatio). On peut la maîtriser aussi par le recours à la raison, seule susceptible de lever les voiles
d'une fausse perception des choses (falsa
visione). L’entraînement physique, exercitatio, permet d’acquérir la
résistance, patientia, comparée au cal de la main, et de dominer le désordre causé par la douleur
pour parvenir à l’ordre intérieur.
Les doutes de
l’auteur concernent les douleurs de longue durée, quand celles-ci durent plus
de 20 ans, voire pratiquement toute une vie. Résister avec abnégation et
patience à la douleur (même si on la suppose modérée) toute une vie, peut rendre
fou, rend amer ou délirant.
Même Jésus, faisant
preuve d’humanité, subissant l’épreuve la plus extrême et violente, celle la
crucifixion, a crié « Eli !
Eli ! Lama sabachthani !
» (« Dieu, Dieu, pourquoi m’as tu abandonné »).
Le père Jean-Yves
Théry constate « C’est […] dur de
devoir constamment faire comme si l’on avait pas mal ».
La position antique de l'effort à
l'accoutumance (dolor et patientia, et consuetudo) :
L'accoutumance à la
douleur n'en nie pas l'existence, mais
permet de
Selon Aristippe,
disciple de Socrate (vers 435 vers 366), la douleur est le plus grand des maux
: "summum malum dolorem dicere".
Or le jugement de Cicéron, homme politique romain, est sans ambiguïté : « c'est une opinion lâche et digne d'une femme »
! ("enervatam muliebremque
sententiam"). Selon Cicéron, d'une part la douleur existe ; d'autre
part, elle n'est pas le plus grand mal.
Il suffit de ne pas
trop s’écouter quand on a mal. il ne convient de la considérer comme le plus
grand mal, mais bien au contraire, il faut s'efforcer de ne pas lui céder le pas
et de lutter contre ses effets.
Selon Epicure « toute souffrance physique est négligeable.
Car celle qui comporte une douleur intense occupe un temps bref ; et celle
qu'endure longuement la chair comporte une douleur faible ». Cicéron
dira la même chose : « si gravis
brevis, si longus levis ». Sénèque idem dans son Epitre 24 : « dolor levis est ; si ferre
possum ; brevis est, si ferre non possum »[225].
« A la limite la douleur insupportable fait
mourir. Les grandes souffrances te font périr en peu de temps » dira
encore Marc-Aurèle (121-180, empereur romain, ainsi qu'un philosophe stoïcien,
dans ses pensées.
Montaigne dans ses
Essais, copiant mot pour mot Sénèque, son maître à penser, confirmera :
« [1] Cela nous doit consoler que
naturellement, si la douleur est
violente, elle est courte; si elle est longue, elle est légère.
[2] Tu ne la sentiras guère longtemps, si tu la sens trop : elle mettra fin a soi
ou à toi; l'un et l'autre revient à un.
[3] Ce qui nous fait souffrir avec tant d'impatience la
douleur, c'est de n'être pas accoutumé de prendre contentement en l'âme, c'est
d'avoir eu trop de commerce avec le corps. ».
Corollaire à cette
philosophie, la croyance admise est que si
on survie à la douleur, c’est qu’elle n’est pas si forte que cela.
Or cette croyance
qu’une céphalée durant des dizaines d’années ne peut être sévère est encore
prégnante dans l’esprit de la majorité des médecins.
Si une personne tient plusieurs dizaines d’années, sans
se suicider, c’est que cela de doit pas être si terrible que cela, sans imager
un seul instant que le malade aura peut-être développé de multiples stratégies
pour tenir face à la douleur, au fin des années[226].
Pendant longtemps, la
douleur ou la souffrance était une fatalité, contre la quelle le simple mortel
était impuissant, à moins d’avoir reçu des extraits de fleurs de pavots
(médication déjà connue par la médecine romaine) ou de feuilles de coca
(médication connue, elle, des Incas et de certaines peuplades amérindiennes
précolombiennes).
Le moraliste La
Fontaine (1621, 1695) écrivait encore au XVII° siècle "Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne change le destin.
" (Fabl. VIII, 12.) et surtout « De
quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, La douleur est toujours moins forte
que la plainte / Toujours un peu de faste entre parmi les pleurs »
(La Matrone d’Ephèse). Pour Diderot "La
plainte surfait toujours un peu les afflictions" (Claude et Néron. I,
31).
Ces conceptions
moralistes continuent à guider la conception philosophique sur la douleur, de
beaucoup de médecins, surtout en France.
Les médecins actuels
continuent dans cette attitude d’indifférence du médecin envers les douleurs
durables des malades.
Par exemple, le
docteur Marc Schwob écrit dans son ouvrage: « le douloureux chronique se laisse glisser peu à peu vers un statut de
handicapé (qui sera souvent validé par la société) dont il adopte le
comportement passif, revendicatif avec repli sur soi, et enfin un
rétrécissement du champ global de la conscience du malade à son seul problème douloureux
auquel il ramène
toutes ses autres
occupations (et celles
de son entourage) ». Un
peu plus loin, cet auteur continue dans le même sens : « le douloureux chronique, malade
difficile au prime
abord, se présente
comme un patient
dépressif, obsessionnel,
acariâtre, revendicatif, fatigué,
surmédicamenté, intolérant pour
son entourage, se considérant et se comportant comme un invalide, créancier à juste titre de la société
»[227] [228].
Nous avons souligné
volontairement ces deux dernières phrases. Pour ce médecin, c’est comme si nous
simulions l’invalidité ( !).
Marc Schwob comme
bien d’autres[229],
font preuves de « dissonance cognitive » (voir
l’explication de ce terme plus loin). Ils n’écoutent qu’eux mêmes et n’écoutent
jamais les arguments des malades. On pourrait même dire qu’ils font preuve
d’une fatuité incroyable à l’égard du patient.
Ignorance ou
arrogance de la part de tels médecins ? En tout cas une énorme ignorance.
14.3 La théorie de l’investissement et engagement
Les médecins
psychiatres ou neurologues ont accompli plus de 10 ans d’études médicales après
le baccalauréat. Ils ont souvent travaillé durs pour obtenir leur diplôme. Plus
un apprentissage a été difficile, malaisé ou même humiliant, moins
le médecin est prêt à remettre en
cause la valeur de ce qui lui a été enseigné. Cela signifierait en effet
qu'il a investi pour rien. Là encore, les exemples sont légion, surtout en
médecine : attachement presque affectif à un système de soin ou à un certain
traitement médical, par exemple, en dépit de leurs défauts ou leur absence de
réussite manifestes.
Ils sont souvent
surchargés de travail et n’ont pas le temps de remettre en cause leur
connaissance, par exemple, en se rendant à de nouvelles formations.
14.4 L’absence de certitudes scientifiques sur le sujet
Ici nous ne cherchons
pas à entamer une vaine polémique avec les médecins tenant de la thèse purement
psychosomatique (c'est-à-dire celle rejetant tout possible dysfonctionnement ou
dérèglement du circuit de la douleur du système nerveux central). Nous voulons
juste, par l’analyse qui suit, signaler l’absence de certitudes scientifiques
sur le sujet et donc à quel point il serait prématuré d’avancer des certitudes
sur l’unique composante psychosomatique ou non des CTC des patients.
En effet, même s’il
existe effectivement (indéniablement) une part de composantes psychologiques
dans la genèse et l’entretient des CTC. Mais celle-ci explique-t-elle
tout ? Comment peut-on avancer des affirmations, sans la sanction de
vérification scientifique (ce qui n’est pas du tout le cas actuellement) ?
Comme nous l’avons
déjà dit et n’avons jamais cessé de le réaffirmer dans ce document, les
mécanismes de la maladie sont mal connus (cf. ce qu’il en est dit dans
l’ouvrage du Dr Lantéri-Minet) et donc les diagnostics médicaux peuvent être
sujets à évolution ou à caution, surtout
s’ils font intervenir des diagnostics
psychologiques. Car de plus, la « science
psychologique » (qu’elle soit analytique, behavioriste, comportementaliste,
psychanalytique etc. …) _ à laquelle ont toujours recourt les psychiatres et
les neurologues _ est aussi, malheureusement, loin
de satisfaire aux critères de validité et de réfutabilité scientifique,
recherchés par les scientifiques[230] [231].
Voyons par exemple, un
certain nombre d’affirmations et de diagnostics souvent avancés sur les CTC
(voir ci-après) :
1) « La dépression (cachée ou non) est cause la
souffrance (morale, puis physique) du malade (par le mécanisme de somatisation) »[232]
[233],
2) « L’hyperactivité
du patient cause sa céphalée »[234],
3) « Le
caractère agressif du patient, envers le médecin, du, par exemple, à sa
« névrose » ou sa « psychose » »[235].
4) « L’apparente
pharmaco-résistance aux psychotropes de la douleur du patient est du au
caractère psychosomatique de la pathologie du patient »[236].
5) « L’image
dévalorisée du patient _ du fait d’avoir fait des études très brillantes puis
d’accomplir maintenant des tâches non à la hauteur de ses diplômes _ seraient
la cause de ces céphalées actuelles »[237].
6)
7) « Le patient refuse de travailler, depuis des
semaines, des mois, voire des années, en raison d’une dépression grave, d’une
peur phobique quelconque, d’une phobie sociale ou professionnelle, d’une
conversion hystérique, d’un syndrome de Münchhausen etc. »[238].
8) « Les CTC sont milles fois moins douloureuses que
les algies vasculaires de la face »[239].
9) « Si le patient investit autant de temps et d’argent
dans le traitement de ses céphalées, c’est qu’il y trouve un intérêt quelconque »[240]
[241].
10) « Le patient « rationnalise d’une façon
incessante » »[242]
[243].
On voit que la
validité scientifique de toutes ces affirmations reste, somme toute, discutable
_ que ces affirmations sont toutes réfutables par d’autres argument, si on
pousse tous ces raisonnements jusqu’au bout _, du fait, justement, du manque d’investigations scientifiques sur
l’origine et l’entretien des CTC et sur leurs mécanismes.
Les médecins affermeront, par exemple, que s’ils avancent
tout ces argument, c’est parce qu’ils ont une longue expérience médicale. Mais
une longue expérience empirique ne remplace pas les certitudes scientifiques[244].
Or devant le faible
nombre de cas graves _ et du fait d’un manque de prise au sérieux de ces cas (manque
renforcé par une absence d’investigation scientifique poussée sur le sujet) _, on peut alors passer à côté d’un phénomène
pourtant intéressant[245].
De plus, le paradigme actuel de beaucoup de médecins
s’auto-entretient du fait que ces derniers n’écoutent, le plus souvent, pas les
patients[246].
De plus les diagnostics
émis sur la céphalée d’un patient, souffrant de CTC, peuvent varier d’un
praticien à un autre[247] (en
fin de ce document et en annexe, sont d’ailleurs présentés « la listes des causes des céphalées de tension avancées aux
patients, par les médecins », montrant que cette liste des causes
explicatives avancées par les médecins est loin d’être arrêtée).
Cette possibilité de variation dans le diagnostic fait
alors apparenter la pratique des médecins plutôt à un art qu’à une pratique
scientifique rigoureuse.
Les médecins
rencontrés par les malades sont, avant tout, des prescripteurs (ayant peu de
degré de liberté dans leur pratique) _ ils ne font que restituer une
connaissance acquise durant leurs études _ et non des chercheurs scientifiques
(qu’ils le soient à part entière ou non).
La plupart du temps,
ils sont surchargés et n’ont pas le temps de suivre des formations et donc de
faire évoluer leurs connaissances.
Enfin, durant les
longues études médicales des médecins _ ces cours étant déjà très denses et
chargés _, il y a peu de place à la formation à l’esprit critique _ c’est à
dire à la critique de ce que l’on leur apprend. L’apprentissage par le médecin,
des connaissances médicales qu’il doit acquérir, se fait le plus souvent par la
méthode de l’apprentissage par le « par cœur ».
La démarche scientifique
poussée n’est dispensée qu’à partir du 3ème cycle et seulement aux
étudiants chercheurs à l’Université.
Or face à tout domaine
mal connu, un être humain a besoin de certitude (le médecin n’échappant
sûrement pas à cette règle, lui aussi). Certains médecins se diront alors peut-être :
« De quoi aurais-je l’air, si
j’avoue mon ignorance au patient, sur un sujet, que je suis censé soigner. De
plus, avouer son ignorance peut ne pas être rassurant pour le patient ».
14.5 La théorie de la dissonance cognitive
La dissonance
cognitive est un concept de psychologie élaboré par Léon Festinger en 1957.
Selon cette théorie, l'individu en présence de cognitions (« connaissances, opinions ou croyances sur l’environnement, sur soi
ou sur son propre comportement »
[1])
incompatibles entre elles, éprouve un état de tension désagréable: c'est l'état
de « dissonance cognitive ». Dès lors, cet individu mettra en œuvre
des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif. Ces
stratégies sont appelées « modes de réduction de la dissonance
cognitive ». Une de ces stratégies pour réduire la dissonance cognitive
consiste à oublier ce qui ne cadre pas avec ses références antérieures, il est
appelé « processus de rationalisation ».
C’est justement ce
« processus de rationalisation », dont les psychiatres accusent, à
leur tour, les malades.
Tous les
raisonnements ci-avant, en particulier ceux inversant la cause et l’effet,
permettent aux médecins de renforcer (solidifier) leur conviction dans le bien
fondé de leur pratique médicale.
Le refus des médecins
d’écouter les patients souffrant de céphalées de tension chroniques, au prétexte
qu’ils sont dépressifs et hypocondriaques, et qu’il ne faut pas rentrer dans
leur jeu, leur permet d’éviter d’écouter les critiques des patients envers leur
pratique médicale actuelle (a) refus d’écoute, même quand le patient a mal, b)
prescription systématiques de psychotropes).
14.6 Rien de scientifique dans l’évaluation de la douleur
C’est un fait bien connu (on pourrait même
affirmer que c’est un « lieu commun »).
Le médecin (en
général le psychiatre ou le neurologue) du centre antidouleur vous demande
d’évaluer votre douleur sur une échelle de 0 à 10.
Lui-même applique une
sorte de « coefficient de pondération » sur votre affirmation, laissé
entièrement à sa discrétion. Même si vous mettez 10, dans le cas des céphalées
de tension, systématiquement, il ramènera ce chiffre à un chiffre beaucoup plus
faible (pour indiquer une céphalée modérée).
Ce coefficient
tiendra compte si vous êtes sympathique, agressif _ si vous êtes agressif alors
vous serez considéré comme hypocondriaque et donc votre mal ne sera pas pris au
sérieux (et surtout à ne pas prendre au sérieux)[248].
Qu’est ce qui fera
affirmer que quelqu’un de sympathique ou quelqu’un d’agressif souffrira plus
l’un que l’autre ? Rien. En fait toute cette évaluation est totalement
arbitraire et strictement non scientifique dans l’évaluation de la douleur dans
les centres antidouleur.
C’est aussi
arbitraire que d’affirmer que l’homosexualité ou la transsexualité sont des
affections psychiatriques.
Dans l’ouvrage « Céphalées
de tension, rumeurs et réalité », du Docteur Michel Lantéri-Minet, il est indiqué, page
59 : « Peu de place pour appréhender les
mécanismes à l’origine de la céphalée de tension.
Cette
troisième étape[249]
d’identification des mécanismes est également essentiellement clinique et,
hormis dans une perspective de recherche, les examens complémentaires sont que
de peu d’utilité. C’est notamment le cas de l’électromyogramme (qui est un examen permettant d’étudier le
fonctionnement musculaire) qui, malheureusement,
ne permet pas d’authentifier la contracture musculaire qui fait partie des
éléments de la cause multifactorielle des céphalées de tension ».
Là, nous avons mis en évidence et en gras, ce qui nous paraît être
manifestement comme le fruit d’un vrai
défaut d’investigation scientifique, voire l’exemple d’une affirmation
scientifique erronée, car une contracture musculaire peut pourtant toujours
se mesurer par plusieurs biais, par exemple, par la mesure des tensions et
courants électriques, avec des appareils mesurant les faibles intensités ou les
faibles voltages (milli Volt ou milli Ampère) _ avec de électrodes aussi fines
que les aiguilles d’acupuncture _, ou par la différence d’allongement entre un
muscle au repos et le même contracté. Or ces mesures sont importantes pour
pouvoir établir un jour une échelle objective de la douleur liée aux
contractures musculaires, elles-mêmes liées aux céphalées de tension[250].
14.7 Annexe : la vision couramment répandue chez les médecins
Comment
les médecins voient les malades souffrant de céphalées de tension (CTC) :
a)
« les
malades psychologiques ne se pensent pas malades » (or dans le paradigme
médical actuel (majoritaire), les malades souffrant de CTC sont vus « comme malades psychologiques »
et leur maladie comme maladie psychosomatiques _ tout ce qui est
psychosomatique est peu pris au sérieux en France).
b)
Les
maladies invisibles (sans cause apparente) ne sont pas prises en sérieux ou
« juste » vues comme maladies psychosomatiques (principe du rasoir
d’Occam).
c)
les
médecins considèrent la sensation douloureuse ressentie par le malade souffrant
de CTC et l’anomalie comme réelles, mais « psychogène » _ c’est à
dire générée par l’esprit du malade (du fait, par exemple, que le malade ne
cesse de se focaliser « obsessionnellement » dessus). Certains
médecins considèrent même la maladie comme un imaginaire (il suffit de ne pas
s’écouter et de ne pas se focaliser dessus).
14.8 Annexe : Pourquoi l’utilisation des psychotropes
Voici les raisons et
arguments conduisant les médecins à utiliser (voire à abuser[251] des)
psychotropes, à maximiser leurs « avantages » prétendus tout en
minimisant leurs effets secondaires :
- Ils
permettent de calmer les gens agités, et de mieux les gérer.
- Si
l’on évalue les avantages et leurs inconvénients, dans le traitement de
certains troubles psychiatriques graves et dans les épilepsies graves, la
balance alors penche nettement en leur faveur.
- On
obtient des résultats réels dans le traitement des dépressions graves par
les antidépresseurs[252].
Certaines dépressions particulièrement graves sont difficiles à traiter
(par les psychothérapies) et seul souvent le recours aux psychotropes peut
permettre de les contenir.
- On met souvent
les céphalées de tension sur le compte d’un fond dépressif (par exemple,
une dépression cachée) et un fond anxieux. Et les
psychotropes sont « justement censés » soigner ces deux
pathologies[253].
- Les
psychotropes étant tellement peu coûteux, il est infiniment moins coûteux
de « soigner » (calmer) les malades avec les psychotropes que
par des psychothérapies (ces dernières sont beaucoup plus coûteuses, pour
la Sécurité sociale, si elles sont prises en charge par elle).
- Quant
au Botox, il est très cher (plus de 100 euros, en moyenne, pour une séance
d’injection)[254].
- Les
médecins sont surchargés de travail et n’ont pas du temps à consacrer au
malade (alors que les psychothérapies prennent beaucoup de temps).
- Les
médecins sont mal formés à l’utilisation de ces produits, d’autant qu’il y
a 25000 visiteurs médicaux, représentant les laboratoires privés, auprès
des médecins, et seulement 2500 médecins conseils de la Sécurité sociale.
D’autant que les laboratoires offrent aux médecins prescripteurs, des
formations et invitations gratuites à certains salons.
- Mal
rémunérés, les médecins sont « forcés » de « faire du chiffre »
donc de multiplier les actes. Or la meilleure façon de mettre fin à une
consultation, c’est de rédiger une ordonnance. « En particulier, il est plus rapide de prescrire un tranquillisant
que de prendre le temps d’écouter son patient » selon le Dr. Edouard
Zarifian.
- Enfin,
il y a une mode, en France, c’est la « médicalisation
systématique du moindre vague à l’âme ».
- Il
y a un effet de fascination et de subjugation liés à l’utilisation de
phrases savantes qu’on ne comprend pas trop (ici intervient l’effet Barnum
ou l’effet « hypnotique » procuré par les phrases creuses). Par
exemple avec des phrases telles que «inhibiteurs
sélectifs de la recapture de la sérotonine »[255],
« inhibiteurs de la recapture
de la sérotonine-noradrénaline »[256].
Avec de telles phrases magiques, on a l’impression que des psychotropes ne
peuvent être qu’efficaces et ne sont prescrits que d’une « façon
scientifique ». Il y a un aspect illusoire de certains discours[257].
- Que
les tests cliniques des médicaments, effectués avant leur mise sur le
marché, sont souvent conduits par les laboratoires pharmaceutiques
eux-mêmes (ce que dénonce le Professeur Philippe Even)[258].
Sinon, avec les
neuroleptiques, on a nettement moins besoin de personnels hospitaliers dans les
hôpitaux psychiatriques (ce qui permet d’importantes économies). Donc leur
prescription est nettement une solution de facilité, même si le psychotrope ne
fait que masquer le problème _ rendant le patient moins agressif, moins
revendicatif, plus calme, moins angoissé … _, sans résoudre son problème. Il y
a donc une logique économique.
Selon Edouard
Zarifian, ibid, « les patients auxquels
ces produits sont destinés, et qui ont vraiment un bénéfice à en attendre, sont
toujours les plus réticents. Ils ne les demandent pas, et ne se laissent
généralement prescrire qu’avec une
certaine méfiance ».
On peut se poser la
question de savoir pourquoi ces médecins minimisent et ne disent pas la vérité
sur les effets secondaires des psychotropes. Il est vrai que les prescripteurs
ne sont pas ceux qui reçoivent les médicaments.
14.9 Annexe : Éléments de doutes sur l’intensité des céphalées de tension
Voici les faits qui conduisent bon nombre de
médecins à douter de la plainte du malade (ce que nous appellerons les
arguments ou éléments de doutes), concernant l’intensité de ses céphalées de
tension _ et à considérer l’intensité de la douleur décrite par le malade comme
imaginaire :
- Le caractère
anxieux ou angoissé d’une partie de la population de ceux qui souffrent de
« céphalées de tension » chroniques. Ce trait de caractère
fréquent, auxquels s’arrêtent, en premier, souvent les médecins, a
tendance à souvent occulter _ aux yeux du médecin, du moins _ le fait que
le malade peut finalement décrire honnêtement et avec rigueur ses
céphalées quand ces derniers affirment qu’elles sont intenses. Notons que
l’idée « Un train peut en
cacher un autre » est souvent vérifiée dans le domaine de l’étude
des céphalées de tension. « L’anxiété cache, souvent, la
forêt ».
- Les de céphalées
de tension chroniques sévères sont rares. Leur population semble très
faible (car depuis début novembre 2006, seulement trente et une personnes
ont contacté l’association « Papillons en cage » pour des
céphalées de tension sévères invalidantes, malgré le référencement de
l’association et de son site, sur Internet et Wikipedia (en nov. 2006). Ce
qui, en trois ans, ne représente pas beaucoup de cas),
- A cause de la
réprobation (médicale ou sociale) pour toute plainte concernant des
céphalées de tension, le malade a du mal à en parler. La rencontre
thérapeutique est difficile, voire impossible.
- Les examens par
électromyogrammes (EMG) ne permettraient pas de mettre en évidence les
céphalées de tension[259]
[260]. C’est une donnée
qui pourrait être opposée à la crédibilité du discours du malade. Rien ne
semble visible.
- Sinon, la
plupart des examens cliniques (IRM, Scanner etc. ..) ne révèlent rien[261].
- Les paralysants
comme le Botox ne réduiraient pas autant que cela la douleur des céphalées
de tension (alors qu’ils devraient y parvenir efficacement, puisqu’ils
devraient paralyser la contracture musculaire). Et donc le médecin peut, à
juste titre, se demander sur la douleur du malade ne serait pas
imaginaire.
- Certaines
pharmaco-résistances semblent incroyables. Peut-être le malade fait-il
preuve de mauvaise volonté face au traitement ?
- D’autant qu’il
peut y avoir un effet momentané de diminution des céphalées lors de la
visite d’un docteur, dont le malade attend trop[262].
Le médecin pensera alors que le mal est « imaginaire » et qu’il
peut être soigné par effet placebo (par exemple, par la pose d’aimants
permanents, des ondes radios ou micro-ondes, par la pose de cataplasme, de
boue, de bandeaux très froids ou très chauds etc.).
- Peut-être aussi,
le type de la plainte du malade peut être rébarbatif pour le médecin (?)[263].
- Leur grande diversité,
accompagnée parfois de phénomènes secondaires étonnants _ vertiges … _
peut faire douter de leur réalité[264].
Mais justement peut-être, cette diversité peut être le signe qu’il n’y a
pas un seul type de céphalée de tension primaire, mais plusieurs types aux
causes différentes.
Par contre, il y existe bien une sensibilité
péri-crânienne à la palpation manuelle, de la céphalée de tension.
Qu’elle soit constaté par le médecin aussi
bien que par le patient.
15 Annexe : possibles pistes sur les causes des céphalées de tension chroniques
Ici nous ne prétendons pas nous substituer
aux médecins, mais nous essayons de faire évoluer la connaissance et la
réflexion sur le sujet. Ici, pas de rhétorique, nous recherchons surtout des
faits précis, circonstanciés.
Nous essayerons d’être extrêmement honnête,
de ne pas faire la politique de l’autruche et d’accepter les vérités qui ne
seraient pas à notre avantage.
Car trouver les
causes réelles des céphalées de tension chroniques
est extrêmement difficile, d’autant qu’on dispose que de peu d’études
scientifiques (voir ci-dessous).
D’autant aussi, qu’il
est difficile de suivre les patients souffrant de céphalées de tension _ a)
qu’ils soient échaudés par des pratiques médicales désastreuses, b) qu’ils soient
en crise ou dans un état de souffrance constant depuis des années, ils n’auront
alors pas, le plus souvent, envie de sortir de leur lire et venir au
laboratoire qui pourraient les étudier[265]. Et de
plus les crises, à l’image des éruptions volcaniques, peuvent être le plus
souvent imprévisibles.
De toute façon la
rencontre avec le patient échaudé étant tellement difficile (par de souvent
mauvaises pratiques médicales passées à son encontre), il ne sera donc pas
facile d’investiguer sur cette piste (sur la piste psychologique ou celle du
traumatisme psychologique qui serait à l’origine de la CTC) ou sur la piste
(levée par Mme Lagrange ci-dessous), pistes qui sont peut-être d’ailleurs des
impasses.
Voici ce qu’écrit à ce sujet le docteur
Lantéri-Minet, pages 14 et 15 de son ouvrage déjà cité :
|
En dépit de sa
grande fréquence, la céphalée de tension n’a pour l’instant bénéficié que peu
d’attention du corps médical. Cela explique en partie le faible nombre
d’étude qui lui ont été consacrée et ce faisant les mécanismes exacts de la céphalée de tension restent à ce jour
méconnus. On s’oriente vers une origine multifactorielle […]. Comme pour d’autres
céphalées primaires, différents facteurs peuvent moduler l’expressivité
clinique de la céphalée de tension. Ils sont : . soit propres à la
personne (état de stress, période particulière du cycle hormonal …). . soit
environnementaux (rythme de vie, facteurs climatiques …). |
Pages 16 et 17, il écrit :
|
Le stress et la
« tension nerveuse » sont des facteurs déclenchant les épisodes de
céphalées de tension mais ils ne sont pas spécifiques de la céphalée de
tension [puisqu’ils le sont aussi pour la migraine]. [ …] la
réactivité des sujets souffrant de céphalées de tension, est identique
à celles de sujets non céphalalgiques. [ … ] les sujets
souffrant de céphalées de tension chroniques sont fréquemment anxieux et
dépressifs. Néanmoins, cette anxiété et cette dépression apparaissent plus
comme une conséquence de la céphalée
de tension chronique que comme une cause. L’assimilation de
la céphalée de tension à une céphalée psychogène doit être écartée. Il existe des
déterminants psychologiques qui sont à prendre en considération dans les
mécanismes de la céphalée de tension mais ils ne résument pas la céphalée de
tension. |
Page 19, ibid :
|
[Une] possible
susceptibilité génétique[266] a
été évoquée essentiellement pour la céphalée de tension dans sa forme
chronique. Cette susceptibilité génétique, si elle se confirme, ne résumera
pas les mécanismes de la céphalée de tension qui sont probablement
multifactoriels. |
Allant, dans le sens
de l’hypothèse de cette susceptibilité (congénitale ?), le docteur
Scherrer de l'hôpital Bel Air à Thionville, penserait que la CT serait une façon d'évacuer un stress, comme dans
d’autres cas, d’autres malades stressés (anxieux, angoissés) auraient, eux, des
réactions cutanées (psoriasis, etc. ...) ou d’autres réactions ou expressions
psychosomatiques (tels que tachycardie, mal de ventre …). L’expression d’un
problème particulier, par le biais (ou au travers) des céphalées de tension
serait le point fragile de certains malades (et pas d’autres).
Page 32, ibid :
|
La céphalée de
tension chronique impliquerait davantage un dysfonctionnement du système
nerveux central (SNC). Chez certaine personnes, la céphalée de tension est
chronique, probablement du fait d’une moindre efficacité de leur système
nerveux à « filtrer » la douleur par l’intermédiaire des systèmes
physiologiques que l’on appelle « système de contrôle de la
douleur » [facteurs centraux]. Une influence délétère d’éléments psychologiques comme
le stress, l’anxiété ou la dépression s’exerce sur ces facteurs. |
Donc, en restant dans les critères du rasoir
d’Occam, nous admettrons, dans nos hypothèses, que la cause est située « à
mi chemin » entre les facteurs centraux (au niveau du SNC) et les facteurs
psychologiques ( ?).
Sinon, dans une présentation sur les céphalées
de tension, le docteur neurologue Hélène Massiou (de l’hôpital Lariboisière à
Paris)[267]
écrit :
|
Origine centrale: mécanismes centraux du
contrôle de la douleur – Rôle prépondérant dans les CTC (céphalées
de tension) • Activité musculaire et métabolisme [...] - Médiateurs de l’inflammation aux points
sensibles du trapèze • Absence d’augmentation d’activité EMG
(électromyogramme), pas de désordre métabolique, ni d’inflammation des
muscles péri-crâniens dans les CTC • Neurotransmetteurs – Hypersensibilité au NO dans les CTC – Augmentation de metenképhaline dans le
LCR dans CTC Sensibilité péricranienne à la
palpation manuelle: – Anomalies qualitatives dans les CTC • Seuils douloureux à la pression /
algomètre[268] – Diminués dans les CTC • Anomalies des réflexes nociceptifs dans
les CTC • En
faveur d’une sensibilisation centrale des neurones de 2ème ordre des voies
trigéminales |
|
|
Modèle physiopathologique
de la céphalée de tension, cf. Jes Olesen et Jean Schoenen, 1999 [269] [270] [271] [272]
Sinon, le schéma causal prometteur ci-avant
en fait ne apprend que très peu sur les mécanismes centraux causaux. Tout au
plus ces deux médecins danois privilégient une origine dans le système nerveux
central (SNC).
Si l’on se base sur les observations de
certains neurologues, comme Alain Berthoz[273], on
peut supposer que les mécanismes cérébraux en jeux sont certainement plus
complexes, ceux de la douleur l’étant déjà (que ci-avant).
Ce que nous voulons aussi résoudre, dans
cette étude, sont une série de mystères (voir ci-après) :
- Pourquoi
peuvent-elles êtes si douloureuses ?
- Pourquoi, quand
elles sont très douloureuses, réduisent-elles nos capacités
mentales ?
- Pourquoi
peuvent-elles créer des vertiges chez quelques rares personnes souffrant
de CTC ?
- Pourquoi
éventuellement un effet placebo quand on espère beaucoup dans un
traitement ou médecin alors que pourtant lorsqu’on tente toutes sortes de
thérapies semblant pertinentes elles n’évoluent pas ?
Enfin, voici des hypothèses et points de vue
passés de l’auteur _ situées entre les hypothèses psychologiques et l’origine
SNC _ qui seront susceptibles d’évoluer en fonction de son étude et nous
verrons si nous pouvons réutiliser on non :
|
1. L’auteur pense
que, pour la plupart d’entre les malades, qui souffre ou a souffert de
céphalées de tension chroniques très
anciennes, que la cause
déclenchante originelle de la céphalée de tension chronique serait
peut-être, à moment donné clé et précis, la surcharge _ tout en même temps (combinée) _ de stress, d’une très
forte fatigue (voire une fatigue dépassée), d’une déprime (qui elle même
fatigue), voire d’une surcharge émotionnelle. 2. Ou bien, certaines
céphalées seraient issues et maintenues par des hypersensibilisations
« traumatiques » suite à répétitions de traumatismes passés (qui
seraient, en général, graves) (voir hypothèse de Marie-Paule Lagrange
ci-après). Sinon, dans le cas
de cette dernière hypothèse, quel contextes, événements, environnements,
déclencheraient les céphalées de tension et comment surtout maîtriser leur
forme chronique ? 3. Ou bien, le
seuil du système d’alerte et de contrôle des douleurs (lié au SNC) serait
déréglé. |
L’auteur essayera, éventuellement pour ce
faire, un important matériau de témoignages récoltés par l’association (que
nous publierons peut-être dans un livre à venir sur les céphalées de tension
chroniques).
Si l’on croit le docteur Lantéri-minet la
piste des traumas graves (de l’enfance, de maltraitances etc.) ne serait pas la
bonne piste.
Autre hypothèse du Dr Lantéri-Minet, page 33,
ibid :
|
[…] ce
dysfonctionnement pourrait aussi apparaître du fait de la persistance de la
tension musculaire : la céphalée de tension chronique serait alors une
forme compliquée d’une céphalée de tension épisodique mal maîtrisée
initialement. |
Il suffirait alors d’exercices de relaxation et
de psychothérapie pour rependre le contrôle du déclenchement à tout bout de
champ (sous l’effet du stress et de l’anxiété) de la céphalée de tension.
Mais, dans les faits, cela ne fonctionne pas
toujours, malgré tout ce qu’à tenté le malade _ efforts, thérapies en tout
genre, depuis des dizaines d’années (et ce fait, en lui-même, est vraiment
mystérieux !).
Point de vue de certains psychologues
psychosomaticiens (CIPS - Centre international de psychosomatique)[274]
|
Le déclenchement
des CTC serait lié à un conditionnement (souvent éducationnel) profond, à une
culpabilisation cachée _ le patient serait programmé sur ce mode _, dont il
n’aurait même pas ou plus conscience. |
Piste du système nerveux central
On ne voit pas à quoi peuvent servir _ par
exemple, dans le cadre de la « théorie de l’évolution » _, les
migraines ou les algies vasculaires de la face (sont-ce réellement des signaux
d’alarmes cérébraux utiles _ mais quelle utilité alors _ ou bien sont-ce le
résultat de dysfonctionnement cérébraux chez certains individus affectés de
certaines « susceptibilités » (congénitales)[275] _ des
sortes d’erreurs de la nature[276], en
quelque sorte.
Par contre certaines
céphalées de types céphalées de tension sont réellement des signaux d’alarme,
face à une situation de danger cérébral pouvant éventuellement conduire à la
mort cérébral, donc utiles pour la survie de la personne touchée (et
s’inscrivant bien alors dans la théorie de l’évolution). Elles sont toutes
résistantes aux médications (ibuprofène, aspirine etc. …). La douleur
céphalalgique intense qu’elles provoquent ne peut être diminuée que par les
dérivés morphiniques.
Voyons les facteurs déclenchant des céphalées
proches dans leurs manifestations aux céphalées de tension :
|
causes |
M ? |
Soins
/ actions curatives |
Commentaires éventuels / Dangers |
|
Intoxication au monoxyde de carbone |
M ou S |
Oxygène (donner de l’) |
Mortel ou séquelles
neurologiques, sauf si l’intoxication est prise à temps |
|
Tumeur |
M ou S |
Ablation de la tumeur |
Peut-être dans
certains cas non mortel, mais la tumeur, même « bénigne », peut
causer des dysfonctionnements de fonctions cérébrales (voire des aphasies,
des paralysies etc.)[277]. |
|
Malformation d’Arnold-Chiari |
S |
Chirurgie osseuse |
La syringomyélie[278],
une malformation associée à 90% à celle d’Arnold-Chiari, aboutit souvent à
des dégâts irréversibles à la moelle épinière. La malformation d’Arnold-Chiari
est rarement mortelle. |
|
Hydrocéphalie |
S |
Drain pour diminuer la pression du liquide
céphalo-rachidien |
Elle cause
augmentation de la pression du liquide céphalo-rachidien et peut
provoquer une atrophie du cerveau (en général non mortel). |
|
Mal aiguë des montagnes (M.A.M.) |
M |
Oxygène (donner de l’). Redescendre en altitude d’au moins de 500m |
Cause d’embolies
cérébrales mortelles. Le MAM est prévenu par la prise de Diamox, un puissant
diurétique. Ce médicament retarde l'apparition du MAM. Son action diurétique diminue la pression du liquide céphalo-rachidien. |
|
Encéphalite ou méningite |
M ou S |
Antibiotiques, hospitalisation d’urgence[279]. |
Inflammation de l'encéphale, ayant une cause infectieuse,
virale, bactérienne ou parasitaire. Souvent mortelle ou laissant des
séquelles cérébrales graves. |
|
Traumatisme crânien |
S ou M |
On ne peut rien faire, hormis prescrire des
antalgiques. |
On a pu observer des
CT persistant 8 semaines après le traumatisme crânien[280], voire
plus de 4 ans[281]. |
|
Accident vasculaire cérébral (AVC) |
S ou M |
Opération
chirurgicale. |
Le défaut
d’irrigation (et donc d’oxygénation) d’une partie du cerveau provoque une
douleur intense. |
|
Hypertension |
idem |
Traitements
médicamenteux ou / et Opération. |
Idem. Les
traitements médicamenteux sont destinés à réduire les caillots sanguins. Dans
des cas rare, l’hypertension provoque des CT. |
|
Drépanocytose |
M |
antalgiques (pouvant aller jusqu'aux opiacés), mise
sous oxygène, transfusion sanguine en cas d'anémie profonde ou d'infection
grave, hydroxyurée (Hydrea) favorisant la production d'hémoglobine (voire la
greffe de moelle osseuse dans les cas très graves). |
Des caillots bouchent une artère, ce qui entraîne des
douleurs intenses et brutales dans une partie du corps. Dans des cas rares, de violents maux de tête se
manifestent, comme dans certains AVC et certaines hypertensions. |
Dans la colonne
« M ? », M : signifie que ces cas peuvent être mortels,
S : qu’il peut déboucher sur des séquelles neurologiques irréversibles.
Dans tous ces cas, les risques sont importants.
Donc, il y aurait des mécanismes du SNC, qui en
cas de risques cérébraux (détresse cérébrales) mettent en œuvre certains
muscles péri-crâniens pour lancer un signal d’alarme au malade ( ?).
On pourrait émettre
l’hypothèse (entrant dans le cadre de la théorie de l’évolution) que ce
mécanisme met en œuvre des muscles péri-crâniens « gâchettes » bien
précis _ peut-être les 6 muscles péri-crâniens principaux _, censés causer des
douleurs intenses. L’observation citée par H. Massiou, ci-avant, « Anomalies des réflexes nociceptifs dans les
CTC » irait alors dans ce sens ( ?).
Note : le fait que
ce genre de douleur résiste à la plupart des médications antidouleurs
traditionnelles (sorte de pharmaco-résistance) s’expliquerait que l’on ne peut
la faire disparaître comme cela, alors qu’elle alerte justement de quelque
chose de potentiellement grave (et cette dernière hypothèse entrerait bien
justement dans un cadre explicatif évolutif _ i.e. c’est à dire entrant dans le
cadre de la « théorie de l’évolution »).
Autre hypothèse à
vérifier, serait que dans certains cas, quand on pousse la mécanique cérébrale
trop à fond (qu’on « dépasse toutes les limites », comme dans le cas
d’un surmenage grave) _ cas de l’auteur, cas de J.Y.T _, se déclenchent de
puissantes céphalées de tension (signal d’alarme d’un risque pour le cerveau),
liées peut-être à cette « susceptibilité » décrite par le docteur
Lantéri-Minet.
Alors pourquoi, si la
situation dangereuse est terminée, pour certains individus le signal d’alerte
ne revient jamais à zéro. Dans des cas très rares, serait lié à un dérèglement
/ dysfonctionnement de ce système d’alerte / alarme ?
(Si cette hypothèse
était vérifiée alors la CTC serait alors causée par dysfonctionnement purement
physiologique et non par une cause psychologique)[282].
Alors autre
hypothèse, il y aurait eu des traumatismes psychologiques graves dans l’enfance
(à l’époque où le cerveau de l’enfant était encore en développement et était
encore fragile) _ cas de L. (abusé), de B., de C..
(C. a de terribles
céphalées chaque fois qu’elle se sent trahie. B. a de terribles céphalées, à
chaque fois, qu’une personne « perverse » (ou
« difficile ») lui créé une situation menaçante et la culpabilise
(semble-il) ou quand il doit faire ses preuves (qu’il est sur la sellette
professionnelle) ou qu’il risque le licenciement _ et cela malgré tout exercice
de relaxation et de gestion du stress _ depuis plus de 27 ans sans résultat.
Dans le cas de L., ses CT sont constantes et éternelles depuis 50 ans, depuis
un épisode très traumatisant à l’âge de 16 ans. Dans son cas, la relaxation,
une psychanalyse de 6 ans n’a rien fait. Ce qui le soulage, une heure à
quelques heures, se sont l’acupuncture et des mécanismes de chiropractie).
La répétition du schéma
traumatique délétère à l’âge adulte déclencherait alors les CT. Il suffirait de
trouver la cause déclenchante contemporaine pour que les céphalées de tension
chronique de l’adulte cessent.
Note : en fait, dans
la réalité, pour certains d’entre nous, cela ne marche pas aussi bien (aucune
thérapie même celle qui semble la plus pertinente et rationnelle ne semble
soigner notre CTC. Par exemple, les exercices d’étirement du cou (qu’on apprend
lors des séances de relaxation) n’ont aucun effet sur nos CTC.).
Certains malades ont
l’impression de vivre dans un mythe de Sisyphe permanent concernant leur CTC
(le bout du tunnel semblant à chaque fois à porté et pourtant semblant reculer
sans cesse).
Le problème est
pourquoi les CT peuvent être si douloureuses, pourquoi ce signal d’alarme de
déclenche alors que notre cerveau ne semble pourtant pas en danger (on ne meurt
pas d’une CT) ?
Autres pistes :
1) L’équipe de
Francesca d’AMATO[283] a démontré
dans
La question serait de
savoir si, a contrario, si un vécu subjectif de séparation ou
d'exclusion (comme une carence affective grave) pourrait activer ou agir
aussi sur le réseau cérébral de la douleur, au point de déclencher des
douleurs se manifestant sous la forme de céphalées de tension _ comme dans le
cas de Christine que nous avons présenté dans ce document (les céphalées serait
alors une façon, parmi d’autres, d’extérioriser une douleur morale profonde
sous la forme d’une manifestation somatique douloureuse).
La question de
savoir, si c’est une somatisation, pourquoi cette somatisation se manifeste
sous la forme de céphalées de tension et non de douleurs de dos, de problèmes
digestifs, de migraines … Pourquoi cette « préférence » ?
Voici une observation
récente qui irait dans le sens de cette idée, celle d'une céphalée de tension déclenchée par un la perte d’un frère,
chez une patiente ayant une insensibilité congénitale à la douleur
(voir ci-après) :
2) « L’insensibilité congénitale à la douleur
(ICD ou CIP en anglais) est un rare syndrome clinique caractérisé par
dramatique dégradation de la perception de la douleur à la naissance et est
généralement héréditaire, causée par une neuropathie sensitive et autonomique
(Hsan) avec la perte de fibres nerveuses nociceptives. Il a été rapporté le cas
d'une personne de 32 ans souffrant de CIP et le diagnostic présomptif de Hsan
type V, qui a connu la douleur physique
pour la première et unique fois de sa vie peu de temps après la perte soudaine
de son frère. Ce patient a subi d'innombrables blessures pendant l'enfance,
y compris les fractures et des brûlures graves, sans jamais ressentir de
douleur. Il n’a ressenti la douleur qu’une seule fois, celle-ci ayant consisté
en un intense mal de tête, qui a eu lieu dans un contexte de forte surcharge émotionnelle et d'anxiété, 3 semaines après
que son jeune frère est mort subitement dans un accident de voiture. La
description de ce premier épisode de maux de tête rempli les critères
diagnostic de céphalée de tension
épisodique. Cette affaire laisse fortement entendre que la transcription de la douleur du deuil dans
la douleur physique survient parfois indépendamment des mécanismes
périphériques de la nociception et malgré
le manque d'expérience de la douleur. À la lumière des récentes données
expérimentales montrent que les mêmes mécanismes neuronaux qui régissent la
douleur physique peuvent aussi de contrôler l'expression de la séparation de
détresse et le sentiment d'exclusion sociale. Ce cas unique, permet de mieux
comprendre pourquoi certains patients peuvent se sentir mal physiquement, après
la perte de une personne qu'il aime »[284].
Donc, on voit qu’il
pourrait peut-être y avoir un pont entre douleur morale et extériorisation sous
la forme d’une physique, au travers des circuits de la douleur activant les
céphalées de tension.
Pourtant, à cause la
perte des fibres nerveuses nociceptives
devrait faire en sorte que cette femme anglaise ne peut ressentir une sensation
douloureuse, même si ses muscles
péri-crâniens étaient tétanisés ou contractés sous l’effet d’une émotion, d’une
angoisse etc. Nous pourrions avancer plusieurs hypothèses pour expliquer
cela :
1)
Bien
que les fibres nerveuses nociceptives
soient atrophiées, la douleur serait tellement forte qu’elle serait malgré tout
ressentie au niveau de ces fibres ( ?).
2)
Dans
l’insensibilité congénitale, ce ne seraient pas les fibres nerveuses nociceptives qui seraient en cause, mais un
dysfonctionnement des centres de la douleur, qui ne traitent plus les influx
nerveux provenant des nocicepteurs (peut-être aussi ces centres et circuits
défectueux classiques de la douleur seraient court-circuités dans le cas des
CT).
3)
Dans
le cas des CT, il y aurait un circuit de la douleur qui serait différents des
circuits de la douleur classique (dans ce dernier cas le circuit impliqué
serait peut-être plus court le que circuit classique).
4)
La douleur ne serait pas localisée au niveau
du pourtour du crâne, mais l’impression de douleur en étau sur le pourtour du
crâne serait, en fait, peut-être, générée par le cerveau (en relation avec les
centres de la douleur)[285] [286].
Le problème est que
certains d’entre nous au moment de leurs crises ne ressentent pas
nécessairement une douleur morale. Si c’est une façon d’évacuer une anxiété
(comme dans une soupape de sécurité), pourquoi est-elle si intense pour
certains malades _ qui ont une vie normale, avec une famille, une femme et des
enfants et un métier qu’ils aiment ?
Cette piste et ce
lien sont très intéressants mais il faudrait beaucoup de travail pour
l’explorer plus à fond.
Voici des pistes de
possibles causes, essentiellement des chocs ou des traumatismes douloureux et
anxieux qui pourraient provoquer une somatisation se manifestant par des
céphalées de tension (CT) :
|
Pistes |
Cas |
|
Douleur morale
intense associée à de l’anxiété |
1) C. (Est), 1)
anglaise souffrante d’insensibilité congénitale à la douleur (UK). |
|
Dépassement de ses
capacités cérébrales lors d’un surmenage associé à de l’anxiété (ou/et
travail intellectuel + fatigue
intenses) |
1) B. (Paris), 2)
J.Y. (Lyon). |
|
Epreuves et
traumatismes intenses (+ harcèlement moral) |
1) L. (Nantes) |
|
Choc moral
douloureux et dépression préalable |
1) C. (Toulouse /
sentiment d’être trahie par 1 proche) |
|
Mauvaise image de
soi et anxiété |
1) J.P.
(St-Etienne)[287],
2) J.C. (Nîmes) |
|
Crise de paranoïa
ou de schizophrénie (ou délirante). |
1) J.C., 2) C., 3)
P. (Nantes) |
|
Coupure et rejet
familiaux brutaux + dépression |
H (Juras) |
|
Culpabilisation
(dévalorisation) |
P. |
Dans le profil de
malade ont rencontre souvent une conjonction d’anxiété, voire d’angoisse, une
forte douleur morale ou/et encore un état dépressif, ce dernier lui-même préexistant
avant la survenue de la CTC.
Sinon, dans au moins
dans deux cas, les crises de céphalées de tension ont été précédées par des
maux qui semblent bien d’origine psychosomatiques : 1) de forts maux de
dos, durant 13 mois, ont précédé l’apparition des CT de J.Y., 2) durant 2 ans,
des problèmes d’éruptions cutanés _ une sorte de psoriasis _ ont précédé
l’apparition des CT de H.
Si certaines
personnes ont eu des carences affectives voire des maltraitances (H.), d’autres
ont aussi connu des familles aimantes (J.M.).
Peut-être la
conjonction de la douleur moral, du choc moral et l’anxiété contribuerait à ce
que le « cerveau dépasse ses limites » et donc pour le signaler, le
cerveau déclencherait des céphalées de tension, comme signal d’alerte.
Essayons maintenant de résoudre la série des
autres mystères suivants ci-après concernant les CTC :
- Pourquoi peuvent-elles êtes si douloureuses
?
-
Pourquoi le mal ne diminue pas au cours du temps ?
-
Lorsqu’on tente toutes sortes de thérapies semblant pertinentes pourquoi les CT
n’évoluent-elles pas ?
- Pourquoi, quand elles sont très
douloureuses, réduisent-elles nos capacités mentales ?
- Pourquoi peuvent-elles créer des vertiges
chez quelques rares personnes souffrant de CTC ?
- Pourquoi éventuellement un effet placebo
quand on espère beaucoup dans un traitement ou médecin ?
- Pourquoi des pharmaco-résistances sont
observés ?
- Pourquoi, dans certains cas, le Botox, ne
semble pas marcher ?
15.1 Pourquoi peuvent-elles êtes si douloureuses ?
Les crampes
musculaires (une tétanisation musculaire pouvant être maximum) peuvent être
très douloureuses, liées aux nocicepteurs _ récepteurs de la douleur
(heureusement, celles-ci ne durent pas contrairement aux CTC)[288].
Peut-être les contractures musculaires permanentes, tout comme dans les crampes,
produisent, elles aussi, des substances « noci-actives », qui
excitent les nocicepteurs de la douleur ( ?).
Note : Le fait
qu’elles soient non visibles à l’IRM (et avec toute imagerie médicale) ne sont
pas la preuve qu’elles n’ont aucune cause physiologique ou SNC même partielle
(comme le contraire d’ailleurs) _ par exemple, la pression du liquide
céphalo-rachidien d’une hydrocéphalie n’est pas visible à l’IRM, mais elle peut
causer pourtant des CTC.
Ce que confirmeraient, peut-être, les
constatations suivantes du Dr. H. Massiou (si l’auteur les a bien comprises,
et, si oui, il faudrait en savoir plus sur ces anomalies qui pourraient être
des pistes très intéressantes) :
• Anomalies des réflexes nociceptifs dans les
CTC
• En
faveur d’une sensibilisation centrale des neurones de 2ème ordre des voies
trigéminales.
15.2 Pourquoi le mal ne diminue pas au cours du temps ?
Pourquoi le problème ne se résout pas au
cours du temps (par exemple, des techniques de gestion de stress, des thérapies
comportementales ou analytiques ? …), surtout quand le mal traîne depuis
des dizaines d’années et qu’il n’arrive jamais à être résolu quelque soient les
thérapies entreprises _ comportementales, de gestion du stress etc.
Pourquoi il n’y a à chaque fois, il n’y a ou
n’y aurait que pseudo ou fausses améliorations, comme dans un mythe de Sisyphe
sans fin ?
Sinon, ajoutons qu’il
a été observé une évolution avec l’âge, dans le sens d’une relative diminution
de l’intensité de la céphalée, comme l’affirme le Dr Lantéri-minet (mais nous
avons déjà abordé cette question de sa diminution avec l’âge, plus haut, et
comment éventuellement, on peut expliquer cette évolution dans le bon sens _
meilleure gestion de la douleur, voire meilleure compréhension de ses causes
déclenchantes, au fin du temps etc. De plus la diminution observée est quand
même somme toute très relative et le plus souvent très limitée (i.e.
insuffisante)).
Pour expliquer ce
maintien d’une céphalée de tension d’une intensité moyenne relativement
constante sur le long terme (sur une moyenne pondérée), en l’absence de toute
certitude claire sur toutes les possibles causes, nous pourrions émettre sous
toute réserve et avec beaucoup de prudence, plusieurs hypothèses
provisoires ( ?) :
1)
le
malade n’aurait aucune conscience que dans son comportement, il y aurait un
problème particulier, cause de problèmes de relationnels avec son entourage,
qui eux même seraient les évènements déclencheurs de
2)
Ou
bien la céphalée qui provoque des problèmes relationnels, qui eux-mêmes sont
causes de céphalées, dans une sorte de cercles vicieux sans fin (cela sur des
dizaines d’années ( !))[289]. Par
exemple, les pertes de mémoires et de concentration à répétition font que le
malade, a sans le vouloir, une « réputation » auprès de ses chefs et
de ses collègues, i.e. une image dévalorisée par rapport à ses vraies
potentialités, image dévalorisée cause de sa céphalée constante ( ?).
3)
(Ou
bien la perpétuation dans le temps de la céphalée serait liée à un
dysfonctionnement ou à une microlésion invisibles, durables du SNC ( ?)).
Mais sans vraies investigations
scientifiques, il est impossible d’émettre des explications sûres, pour
l’instant.
Bien sûr, sans preuves scientifiques tout
cela reste au stade d’une « masturbation » intellectuelle.
15.3 Lorsqu’on tente toutes sortes de thérapies semblant pertinentes pourquoi les CT n’évoluent-elles pas ?
C’est
le plus gros problème auquel sont confrontés les malades de notre association.
Peut-être parce que certaines CT n’auraient
rien à voir avec les émotions anxieuses (anxiété, dépression, coupure affective
brutale forte), ou la thérapie serait inadaptée ou mal conduite (ou la
participation du malade à la thérapie ne serait pas assez forte) dans leur cas.
Voire certaines seraient peut-être liées à des dérèglements du SNC ou/et
purement physiologiques[290] _ cela
même si aucun examen médical (imagerie etc.) ne révèle rien _ ( ?). Pistes
à étudier. En fait, pas vraiment d’explication pour l’instant. Et en même
temps, il faudrait éviter la multiplicité des hypothèses.
15.4 Pourquoi, quand elles sont très douloureuses, réduisent-elles nos capacités mentales ?
Pas d’explication.
Mais sûrement, elles perturbent la concentration … car souvent, le malade ne
cesse de se focaliser involontairement sur sa douleur … Quoique cette dernière explication n’explique
pas qu’on est incapable de se souvenir d’un mot de passe (qu’on n’a pas noté),
tant que dure la crise, et qu’on s’en souvienne après, la crise étant alors
passée.
Le sujet important _
qui est au cœur du handicap et qui peut être plus gênant même que la douleur
pour certains _ est de savoir pourquoi malgré tous ses efforts intellectuels
(sur le moment), tant que dure sa crise, le malade est incapable de se souvenir,
par exemple :
a) des étapes d’une
procédure plus ou moins complexe _ par exemple, une procédure informatique _,
qu’il connaît pourtant par cœur, s’il n’a pas sous la main une check-list
détaillée de la procédure ou de toutes sortes de pense-bêtes,
b) du visage ou du
nom de son interlocuteur (avec lequel il peut éventuellement discuter, à
l’instant),
c) des raisons pour
lesquelles il se trouve momentanément à tel endroit, dans une grande ville.
Comme s’il était
atteint d’une sorte « d’Alzheimer » temporaire (durant lequel la
céphalée lui fait oublier systématiquement tout).
Ce problème important
est vraiment à étudier donc (voire à résoudre) car il est au cœur du handicap
intellectuel causé par les CT.
L’auteur rencontre toujours beaucoup de
scepticisme quand il affirme, aux médecins, que mes céphalées lui font
perdre régulièrement la mémoire ou l’empêchent de se concentrer, durant ses
crises de céphalées et que pourtant, il
ne prend aucun médicament depuis presque 10 ans et qu’il n’est pas dans un état
de dépression grave (à ce qu’il sache).
Pourtant, même si l’on en parle peu dans la
littérature médicale, le fait est pourtant connu, mais surtout pour les
migraines (qui en général sont plus douloureuses que les céphalées de tension).
Dans le « Référentiel National CEPHALEE AIGUË ET CHRONIQUE (188) »[291], il
est indiqué dans l'interrogatoire pour obtenir les signes d’accompagnement de
la céphalée _ un des éléments du diagnostic _ : « ralentissement psychique, troubles de la mémoire ou des autres
fonctions cognitive ».
Dans « The Neuropsychology of Recurrent Headache »[292], le
Docteur Dominique Cazin écrit « De
nombreux auteurs ont identifiés des déficits cognitifs, mais un nombre presque
aussi important n’en rapporte pas. ».
Voici différents
témoignages attestant que des céphalées peuvent faire perdre la mémoire :
« Mon médecin dit que la perte de mémoire
n'est pas dûe à la fibromyalgie mais à la dépression.... perso j'ai été
dépressive pendant des années sans n'avoir aucun trouble invalidant de la
mémoire, ce qui n'est plus le cas ... la dépression a disparu mais les
problèmes de mémoires et de concentration sont présents ».
http://www.lafibromyalgie.canalblog.com/archives/2009/04/15/13392157.html
« Douleur et névralgie pudendale :
--Perte de mémoire, trouble de la concentration,
épuisement mental évoluant en parallèle à la douleur. ».
http://www.pudendalsite.com/les-symptomes-suite.php
« je dépose un objet quelque part et deux secondes
après je cherche après... Il m'est déjà arrivé de ne plus me souvenir de nom ou
de prénom de personnes que j'apprécie beaucoup... Parfois je ne sais plus si j'ai pris mes
médicaments ou pas... Je me rends compte
que les migraines provoquent de drôles de symptômes. As-tu des troubles du langage ou de l'écriture
également ? Je veux dire quelque chose
mais je n'arrive pas a prononcer et là c'est très pénible car on vous prend
pour une folle ».
« Souvent quand je ne trouve pas mes mots, je finis
par m'énerver. je m'arrête alors quelques secondes et réfléchi à ma phrase
avant de
N'hésite pas à te reposer régulièrement et à dormir dès
que tu en sens le besoin (si tu sais évidemment).
Pour les troubles du langage et de mémoire, moi aussi
j'ai l'impression que ce n'est pas depuis que j'ai des migraines mais que ça s'empire
depuis quelques mois. Mais je suis en crise plus fortes depuis 4 mois.
As-tu des migraines plus fréquemment ces derniers temps?
Te sens-tu plus fatiguée pour l'instant?
Nerveuse ou te sens tu parfois comme "ailleurs"? ».
« Je perd la notion d'orientation quand j'ai mal,
j'ai des trous de mémoires quand je parle je me met souvent a bégayer car je ne
trouve plus mes mots.je n'ai plus aucun reflexe je suis en état végétatif. Je
ne fais que subir les événements sans réaction. C'est totalement frustrant de
passer pour une folle et débile. Et parfois mes mains se mettent a trembler. Je
pense qu'on perd la mémoire quand on a
une migraine car on est obnubilée par la
douleur, on essaie de faire le vide dans notre esprit pour pouvoir dormir quand
on peut.
J'espère qu'un jour qu'on oubliera ces douleurs et qu'on
gardera les idées claires ».
http://forum.doctissimo.fr/sante/migraine/migraine-perte-memoire-sujet_147428_1.htm
« Une personne avait eu une commotion
cérébrale, avec perte de mémoire, de concentration et fortes céphalées de tension,
suite à une chute dans un escalier. ... »[293].
15.5 Pourquoi peuvent-elles créer des vertiges chez quelques rares personnes souffrant de CTC ?
Soit ces vertiges
sont liés à un dysfonctionnement du CNC (ou de l’oreille interne), soit les
muscles péri-crâniens pourrait faire pression sur le vestibule interne
( ?). (Un peu comme dans les CT oculaires, les muscles oculaires faisant
pression sur les globes oculaires). (Ou bien cela proviendrait d’un problème du
SNC ( ?) (Mais le quel ?)).
15.6 Pourquoi éventuellement un effet placebo quand on espère beaucoup dans un traitement ou médecin ?
Effet placebo peut être normal (à tout un
chacun). Puissance de l’esprit qui peut faire croire par moment qu’on est guéri
d’un cancer grave (ce qui en fait n’est pas le cas).
15.7 Pourquoi des pharmaco-résistances sont observés ?
Peut-être lié à un « mécanisme
évolutif », pour empêcher justement qu’un problème grave (mettant en
danger le cerveau) puisse être masqué (par des médications simples _ avec
plantes médicinales etc.).
15.8 Pourquoi, dans certains cas, le Botox, ne semble pas marcher ?
Cette question est
importante car ce traitement coûte cher.
La raison de ces
certains échecs, avec le Botox, provient peut-être :
1°) du lieu
d’injection (tout dépendrait de ce lieu) ( ?).
Comme nous l’avons
vu, les contractures musculaires peuvent être très intenses et généralisées à
toute la calotte crânienne. Donc il faudrait « noyer » tout cette
calotte, avec au moins des centaines d’injections profondes _ intramusculaires
et non uniquement intradermiques, comme c’est souvent le cas actuellement _,
pour arriver à desserrer (au moins partiellement) l’étau puissant des CT[294].
2°) l’influence
éventuelle aussi, non prévue à l’origine (par les médecins), des possibles
nocicepteurs (et de la rétention possible, dans le temps, durant un certain
temps, de substances noci-actives, après que la douleur a
commencé ?) ?
3°) Ou encore, la
douleur en relation avec les CT, seraient aussi lié à certains mécanismes de
dérèglement des centres de la douleur du SNC ( ?).
A étudier aussi.
15.9 En « conclusion partielle »
L’auteur a aussi
éventuellement émis qu’il n’y aurait pas qu’un seul type de CT, mais, en fait,
plusieurs (aux causes déclenchantes diverses, allant des plus causes
psychologiques aux causes plus physiologiques). Cette hypothèse serait à
confirmer ou à infirmer par des données précises (qui devraient être récoltées
lors d’enquêtes épidémiologiques, d’examens cliniques poussés … Mais ces
récoltes d’informations exactes n’ont pas encore malheureusement réalisées,
pour l’instant, comme semble le déplorer le Dr. Lantéri-Minet dans son ouvrage).
Il serait donc
important que beaucoup plus de recherches fondamentales soient entreprises, sur
le sujet, afin d’éviter la multiplication des hypothèses[295] sur le
sujet et les discours rhétoriques, liés
à l’intime conviction de ceux qui les tiennent.
Partie à compléter.
16 Annexe :
la piste entrevue par la psychologue Marie-Paule Lagrange
Selon
|
Dans les cas de
céphalées de tension, le patient date avec précision le début de ses
douleurs, ou cite une période importante de sa vie qui a précédé le début des
douleurs ou coïncidé avec leur apparition. La plupart du temps, il s'agit d'une situation ou d'un événement
suffisamment importants pour que l'on s'en souvienne et si le patient
l'apporte au psychologue en premier matériau, c'est qu'il existe une relation
entre cet événement et le déclenchement de la céphalée permanente. Cet
événement n'est généralement pas la cause directe de la céphalée mais il est
là comme un écriteau sur une route pour nous montrer dans quelle direction
emmener le patient à la recherche de faits plus fondamentaux qui ont marqué
le déroulement de sa vie. Pourquoi ces faits ont-ils abouti à cette douleur
physique ? À quelle situation ou à quel événement majeur ces faits
renvoient-ils le patient ? Nous allons
rencontrer dans cette quête de la vérité des
situations familiales insupportables ou insupportées par l'individu :
l'abandon par l'un des parents, l'adoption qui signifie abandon par les
parents biologiques, la mort prématurée d'un parent ou d'un grand parent que
l'enfant avait choisi comme son bien aimé, celui qui ne le quitterait jamais,
un mystère familial jamais élucidé, une histoire généalogique cachée, dont on
ne parle jamais en famille. Des histoires dont
le patient n'a jamais pu faire son deuil, qu'il garde là dans un coin de sa
mémoire consciente ou de son inconscient. Ceux qui souffrent
de céphalées de tension font partie de ceux qui n'ont pas digéré ce qu'on
leur a fait. Elle n'a pas digéré
que sa mère l'ait abandonnée et lui ait préféré sa sœur. Elle n'a pas digéré
que sa sœur plus âgée ne l'ait pas envoyée à l'école et lui ait volé sa
jeunesse. Il n'a pas digéré
la mort de son grand-père qui le portait haut dans son cœur tandis que son
propre père l'a toujours considéré comme un incapable. Elle n'a pas digéré
que les religieuses de l'établissement scolaire où elle poursuivait ses
études ne l'aient pas poussé jusqu'au bac au prétexte qu'elle était fille
d'agriculteur, tandis que les mêmes religieuses faisaient tout pour les
filles d'avocat ou de médecin. IV - LES MÉCANISMES
DE L'INSTALLATION D'UNE CÉPHALÉE DE TENSION Ayant vécu de
telles histoires dans son enfance, l'adulte est dominé par son histoire, emprisonné dans un tissu de relations
complexes dont il n'arrive pas à se défaire. Avant d'avoir été
amené à en parler au psychologue, il ne sait pas que c'est cette histoire-là,
cette douleur profonde qui encombre sa
vie au point de lui donner un mal de tête continu. La douleur morale est là, ancrée, figée
dans son histoire et, brutalement, instantanément, à l'occasion d'un
événement qui va le renvoyer à cette situation, un mal de tête va s'installer
et ne plus le quitter. On peut dire que le
début d'une céphalée de tension est presque toujours déclenché par un incident significatif d'une situation
qui s'est peu à peu organisée dans un sens défavorable à l'individu et qui
lui fait revivre à l'âge adulte une situation du même ordre qu'il avait mal
vécue dans son enfance. |
Pourtant des doutes
sont à émettre sur les affirmations et sur le contenu du livre de cette dame, car
son livre n’apporte aucune preuve probante que son auteur aurait réellement
guérie une céphalée de tension très ancienne et très forte (le seul cas qu’elle
présente, est le cas d’une femme coiffeur et il semble que la céphalée de
tension, de cette dernière, soit épisodique).
Son discourt reste
lié à son intime conviction et non étayé par des arguments scientifiques
précis, circonstanciés.
Dans son optique, par
exemple, elle ne cesse de rechercher et de « voir » des évènements que
le malade aurait mal « digéré », pour expliquer ses céphalées et sa
contracture, point de vue qui est loin d’être établi, avec certitude au niveau
scientifique.
17 Annexe : un témoignage sur de possibles causes originelles
1) Le témoignage de B., ancien chercheur,
actuellement informaticien :
|
Je
pense que, pour la plupart d’entre nous, qui souffre ou a souffert pendant
très longtemps, que la cause déclenchante originelle de la céphalée de
tension chronique est peut-être, à moment donné clé et précis, la surcharge
tout en même temps (combinée) de stress, d’une très forte fatigue (voire une
fatigue dépassée), d’une déprime (qui elle même fatigue), voire d’une
surcharge émotionnelle. En
tout cas, cela a été mon cas en octobre 81 avec ce moment là une panique de
perdre mon travail associé à un terrible surmenage. Je
vais même t’avouer que dans mon cas, il y a eu des raisons irrationnelles qui
ont pu être à l’origine du dépassement radical de mes capacités cérébrales en
octobre 81, cause lui-même ensuite de mes céphalées de tension actuellement
semble-t-il éternelles. Car
dans mon cas, je n’ai pas bénéficié d’une famille aimante (je n’étais pas
vraiment attendu non plus, lors de ma naissance … « ceci pouvant
contribuer à cela »). Et j’ai eu surtout un environnement familial
extrêmement hostile à mon égard, d’une façon totalement irrationnelle (sans
aucune raison normale et censée). Une
personne vivait dans une sorte de folie intérieure cachée (quelqu’un qui est
capable de prôner un raisonnement extrême, avec la plus grande conviction
persuasive et force, avec une profonde sincérité apparente troublante. Puis
capable de tenir des discours opposés, avec la même conviction inébranlable.
Avec des idées des convictions parfois délirantes, mais donnant toutes les
apparences de la rationalité. Tout
ce environnement me créait des angoisses terribles (de type paranoïdes). Et
pendant mon enfance, je suis passé par différents états intérieurs étranges,
aussi bien des impressions d’enfermements mentaux qu’au contraire aussi des
impressions « d’élévation mystique » (d’amours mystiques, de
béatitudes, avec disparition du moi ou de l’ego). Et j’étais persuadé que ces
états « mystiques » agréables étaient faciles à obtenir ( !).
En 77, après la rencontre avec frère Roger de Taizé, je m’étais converti au
Christianisme. En
80, j’ai réussi enfin à me sortir de mes angoisses terribles, celles qui
m’avait envahies sans cesse durant toute mon enfance. Mais quel n’a pas été
ma surprise, quand je m’en suis sorti de mon état d’angoisse perpétuel, de me
retrouver ensuite dans un état de faiblesse intérieure, qui était totalement
à l’opposé d’un état de grande élévation intérieure spirituelle !
J’étais très frustré, déçu. J’étais naïvement persuadé qu’avec tout ce
que j’avais subi dans mon enfance, je serais rapidement devenu un
« saint » ( !) (rien que cela). Je n’avais pas compris qu’être
un saint, ce n’est pas un état intérieur de béatitude (ou de félicité)
éternelle, mais aussi le fait d’avoir une expérience de la vie et des hommes.
J’étais « bloqué » intérieurement, en fait dans un état, que je
définissais comme un état de narcissisme
et je me sentais comme terriblement piégé dans/ par cet état intérieur
non désiré. Et
c’était pour moi l’horreur, car je ne voulais pas à un seul moment ressembler
à une personne de ma famille souffrant de narcissisme extrême (que je
considère comme une vraie maladie). Et
comme j’étais informaticien _ que j’avais, dans la tête, un modèle
informatique du cerveau, à l’époque _ et comme je lisais à ce moment là des
écrits de Sainte Thérèse d’Avila, j’ai pensé qu’il suffirait de faire un
surmenage cérébral dans le bon sens _ dans le sens de se mettre dans un état
de « sainteté » intérieure, grâce à une déprogrammation de mon
cerveau, dans le bon sens, c’est à dire dans le sens de la « sainteté
intérieure » ! (je pensais, à l’époque, qu’un surmenage cérébral
serait un peu comme quand on passe une surtension dans une flash EPROM pour
la reprogrammer définitivement). Et
à l’époque, je me prenais pour un prophète _ c’est une forme délire,
permettant d’échapper à l’impasse que le renvoi du CNRS n’avait conduit, mais
me conduisant à une autre impasse _ et je croyais donc, qu’en disant aux gens
« faites du bien », je leur faisais réellement du bien, alors que
je ne me rendais pas du tout compte que je les agaçais en fait (d’autant que
je ne paraissais pas fort intérieurement à leur yeux). Et durant cette
période, à cause de mon attitude « moralisatrice » avec mes
collègues, cela commençait à aller mal professionnellement. Je
m’écroulais intérieurement, je me sentais de plus en plus faible
intérieurement. Et alors j’ai commencé à paniquer, pensant revivre à
nouveau le terrible renvoi professionnel du CNRS que j’avais subi en 81, dans
des conditions terribles (un renvoi qui avait été une sorte de fin du monde
pour moi ou une sorte condamnation à mort pour moi), alors que j’étais
étudiant chercheur 3ème cycle en physique des plasmas. Et
alors je me suis donc accroché a) pour réussir dans mon nouveau travail
d’informaticien que je connaissais à peine et b) pour ne pas finir clochard (peur
qui a été mon épée de Damoclès éternel). Car manquant de force et de volonté
intérieure (mon enfance n’ayant sans cesse contribué qu’à casser ma volonté),
j’avais beaucoup de mal à réussir en tout et je devais sans cesse me dépasser
intérieurement pour ce faire. Tout
cela réussi, combiné à contribué à un terrible surmenage intérieur. Et
soudainement, un APM d’octobre 81, j’ai eu une terrible douleur fulgurante
soudaine, qui a duré ensuite plus de 4 ans, pour diminuer un peu après. Je
reste persuadé que si je n’avais pas vécu l’épisode aussi traumatisant du
renvoi par mon patron au CNRS en 80 _ renforcé par le caractère fragilisant
de mon éducation, qui a contribué à mon surmenage de 81 _, mes céphalées ne
se seraient jamais produites.
Pour moi, mon surmenage d’octobre 81 (renforcé par une panique extrême
au moment du surmenage) a peut-être déréglé ou endommagé de façon durable un
système d’alarme cérébral, existant dans mon cerveau. Cette idée expliquerait
alors le comportement parfois erratique, rarement prévisible, de mes maux de
tête, à l’heure actuelle. Et surtout le fait qu’ils n’ont jamais été vaincus,
en 27 ans, par aucunes thérapies comportementales, exercices de relaxations
en tout genre … |
B. Le témoignage de Bernard :
Bonjour,
Je témoigne ici de ce problème, du fait de
mon expérience personnelle de 25 ans de céphalées[296],
durant lesquelles aucun acteur médical et social[297] ne
s’est vraiment intéressé à mes soucis professionnels graves causés par mes
céphalées[298]
[299], dont beaucoup d’échecs professionnels, beaucoup de
changements d’emploi, tous ces problèmes étant essentiellement dus à mes
céphalées[300].
Et donc, je fais encore appel à votre
intelligent pour appréhender, dans toute sa globalité et sa réalité, ce
problème extrêmement complexe, qui ne se
réduit pas à un simple problème psychosomatique, juste traitable par des
psychotropes, de la relaxation ou encore par une psychothérapie comportementale.
Pour cela, je veux vous décrire mon problème
pour décrire celui dont souffrent tous ceux qui sont dans le même cas que le
mien et qui souffrent aussi de céphalées de tension chroniques[301].
J’espère pouvoir le décrire avec d’une façon suffisamment détaillée, mais sans
vous noyer sous trop de détail, au point de vous décourager, pour vous
convaincre enfin de la réalité du problème. Je vais donc déjà vous décrire le
contexte dans lequel je travaille.
Le
contexte professionnel et humain
Actuellement, je travaille chez SFR
(Nanterre), pour le compte de
Si un incident est grave, toute ma hiérarchie
me met « la pression ». Or il m’arrive régulièrement d’avoir
deux incidents graves à traiter en même temps.
Je dois continuellement prouver ma
fiabilité professionnelle, auprès de mes responsables et de mes collègues, cela malgré mes absences
intellectuelles et mes oublis, à
répétition, dus à 99% à mes céphalées chroniques.
Et du fait de mes « absences »
intellectuelles, je fais face régulièrement aux « remarques », pas
toujours amènes, de mes collègues[302].
Dans le contrat entre SFR & STERIA que
STERIA a remporté, le jeudi 16 juillet, il est prévu la réduction des incidents
d'exploitation par 2 (actuellement 700 par an). Et donc dans notre service
(Bureau Tech. Système), les effectifs devraient se réduire, en fonction de la
réduction du nombre d'incidents (or je suis aux incidents …).
Conséquences de cet état de fait, durant deux
ans, mon responsable actuel a plusieurs fois hésité à me garder dans
l’équipe.
|
Particularité de mon environnement actuel
et clé de ma survie professionnelle
actuelle, depuis 2 ans, chaque fois que j’ai une crise de céphalée, un
collègue ami, Hakim, reprend
discrètement mon travail (sans
que mes chefs et collègues le voient). Cette aide est très importante pour moi, d’autant que dans le
passé, je n’avais jamais réussi à trouver un tel collègue qui, comme lui, « me
sauvent régulièrement la mise » professionnellement. |
Chaque fois que j’ai une crise, je suis
obligé de faire appel à son aide[303] ou à
celle d’un autre. Donc ma situation professionnelle
actuelle reste fragile (mais je ne peux refuser cette aide, sinon je risque
de perdre mon emploi).
Par contre, travailler sous la pression n’est
pas un problème (je m’y suis habitué depuis longtemps), le problème reste donc
ma fragilité psychologique (en rapport avec mes céphalées) et professionnelle
(c’est à dire le fait de vivre depuis 25 ans dans un cercle vicieux, celui de
la difficulté à garder un emploi du fait de mes maux de tête).
Le
problème au jour le jour
Mes maux de tête sont, sans cesse,
extrêmement variables, cela sans fin, depuis octobre 1981, depuis 25 ans,
alternant des micro-crises journalières _ pouvant durer moins d’une heure à
quelques heures _ et de grandes crises pouvant durer d’une semaine à quelques
mois[304].
Il y a la survenue de crises plus ou moins
prévisibles _ liées au contexte professionnel _ mais aussi des crises imprévisibles (elles, que je ne peux pas anticiper).
Tous les mois ou 2 mois, j’ai régulièrement des crises, durant en moyenne
durant 1 à 2 semaines. Enfin, il y a des variations[305] dans
l’intensité de mes céphalées quotidiennes, pouvant être aussi très variables
dans une même journée[306]. Mes
dernières crises, elles, ont eu lieu à ces dates[307] :
|
Date
en 2009 |
durée |
Probables causes
déclenchantes ( ?) |
Intensité
et conséquences |
|
18
au 25 avril |
7
j |
N’arrive pas à
avancer sur un problème technique complexe durant 2 jours. Ce qui augmente
alors mes CT par le fait d’être de nouveau sur la sellette |
Impossibilité
totale de travailler. Hakim était
indisponible durant ces 2 jours. |
|
30
avril au 3 mai |
4
j |
Pas de causes
précises : la céphalée s’est produite en Corse, alors que j’y étais
invité pour assister à des conférences
littéraires. Elle était imprévisible. |
J’avais
une grande difficulté à comprendre mes hôtes et à suivre les conférences. |
|
15
et 23 juin |
6 j |
Reproches, un
samedi, par ma voisine du dessous qui me « hurlait dessus », devant
tous mes voisins, d’être volontairement à l’origine d’une fuite d’eau (provenant
de mes WC et très difficile à déceler) |
Vomissement
tellement la douleur était intense. Impossibilité
totale de travailler. Hakim était
heureusement disponible. |
|
22
et le 28 juin |
6 j |
Période d’attente
de la signature du contrat de renouvellement de prestation entre STERIA &
SFR, ayant été sans cesse repoussée (je crois du moins) |
Intensité
moyenne mais malgré tout difficulté à travailler. |
Les
causes déclenchantes actuelle de mes céphalées
J’ai, sans fin, une énorme fragilité ou
hypersensibilité à toutes sortes de
conditions, d’évènements et de causes déclenchantes extrêmement variées, même
pour des causes qui peuvent apparaître extrêmement très minimes[308]. Par exemple, il y a entre autre (voir
ci-après) :
A)
Dans le cadre du contexte professionnel :
1) les pressions (sur les délais, les
résultats),
2) la mise en concurrence avec un collègue,
3) les périodes d’essai ou mises sur la
sellette au niveau professionnel ou quand je dois faire mes preuves,
4) les moqueries ou doutes de collègues (sur
mes compétences, ma personnalité, mon apparence. …),
5) quand on me « casse du sucre sur le
dos » (sur mes compétences, ma personnalité, mes déclarations. …),
6) échecs dans la réalisation d’un objectif
(ce qui me remet sur la sellette),
7) donner l’impression à mes collègues que je me culpabilise (ou montrer une attitude
qui s’en rapproche),
8) montrer, à mes collègues, que je suis
stressé,
9) émettre une phrase ou parole malheureuse,
à laquelle je n’ai pas suffisamment réfléchie avant de l’émettre.
10) Faire preuve d’une attitude qui fera
jaser, se moquer mes collègues ou qui me ferait me faire remarquer d’eux.
A) Contextes
professionnels et hors professionnels :
9) reproches,
en tout genre à mon égard, d’où qu’ils viennent[309] [310],
10) contacts, au travail ou non, avec des
personnes déséquilibrées ou psychologiquement malades, sources potentiels
d’ennuis,
11) relation avec des personnes narcissiques,
très orgueilleuses ou imbues d’elles-mêmes (ou/et commettre l’erreur de
s’adresser à elles pour obtenir d’elle leur avis, leurs conseils ou leur aide),
A) Contextes
hors professionnels :
10) toute réception d’une lettre en
recommandée (en particulier d’une administration),
12) toute
relation quelconque avec X[311]
(cette relation ayant été la cause de graves céphalées).
13) Faire preuve de naïveté ou manquer de
prudence (dans mes actes ou paroles), en société.
[14)
L’association de plusieurs causes potentielles, au même moment, peuvent
renforcer la céphalée].
[15)
Plusieurs échecs en cascades renforcent de manière durable
Le(s) mécanisme(s) déclencheur(s) est/sont
souvent extrêmement / extraordinairement complexe(s) et subtil(s) (le plus
souvent invisible(s) et non perceptible(s)). Tout peut être potentiellement cause de mes céphalées.
Les
effets collatéraux du problème
Mes céphalées, en
particulier les crises, me causent toujours des pertes de mémoire et de
concentration, à répétition, depuis 25 ans. Et je n’arrive pas à
les contrôler[313]. Et de ce fait, elles me font régulièrement
perdre mon emploi[314]
(voir mon CV ci-joint). Voici quelques exemples (multipliables à l’envie,
si vous le désirez) :
|
date |
Le fait |
Type difficulté /
Pb |
Conséquences /
remarques |
|
L
20/7 |
Oubli
procédure pour augmenter une swap |
Oubli,
concentration |
Demande
aide à 2 collègues |
|
? |
Perte
livre into the wild que je viens
d’acheter |
oubli |
Jamais
retrouvé |
|
? |
Perte
livre annoté Faut-il croire à
tout ? |
oubli |
Retrouvé,
mais perte de temps |
|
? |
Perte
bon de retrait d’un graveur en réparation |
oubli |
Jamais
retrouvé. ? |
|
? |
Perte
bon de retrait d’une montre |
oubli |
Retrouvé,
mais perte de temps |
|
? |
Oublie
procédure utilisation sysload |
Oubli,
concentration |
Demande
aide à un collègue |
|
Fin
04 |
Un
problème d’encapsulation complexe de disque ( ?) (je ne sais plus la
cause du pb ( ?)). |
concentration |
Demande
aide à un collègue |
|
? |
Oublie
du ticket de caisse dans le sac de transport d’un cadeau |
Oubli,
concentration |
Le
collègue destinataire du cadeau sait le prix du cadeau que je lui ai offert. |
|
? |
De
nombreuse fois, j’ai pris le RER A de Cergy au lieu de celui de Nanterre
université. |
concentration |
Uniquement
quand la céphalée est forte |
|
? |
Me
trompe souvent de quai de métro, lors d’un changement à une correspondance
dans le métro, étant, à chaque fois, persuadé d’aller dans la bonne
direction. |
concentration |
Surpris
du nombre de fois que je commets cette erreur et du fait d’être persuadé de
partir dans la bonne direc. |
(°)
Ces pertes et oublis à répétitions ne sont pas lié à des erreurs de rangements
ou dues au désordre chez moi.
Voici
5 épisodes de ma vie où ce sont bien mes céphalées de tension m’ont fait
réellement et objectivement perdre mon emploi (comme en 08/85, 91, 09/01,
09/02, 02/06)[315]
(voir ci-après) :
|
Dates / durée |
Employeurs |
Contextes
(conduisant à une impossibilité de travailler) |
|
juillet-août
85 / 3 mois |
F.
(La défense) & SSCI I. (Viroflay) |
Violents
maux de tête durant 1 mois (en août 85) => renvoi de F. et d’I. (durant la
période d’essai). |
|
Entre 88 et 91 / 2,5 ans |
COMMUNAUTE
. (Bruxelles) & SSCI A. (Brétigny-sur-Orge). |
Pression
professionnelle énorme, violents maux de tête durant 2,5 ans => glissement
des délais de réalisation du projet de 6 mois à 2,5 ans => pertes
financières considérables, car j’étais travailleur indépendant. |
|
Entre
2000 et 2001 / 1 ans |
I.S.O. (Saint-Cloud) |
Pression
professionnelle énorme, violent maux de tête => Licenciement. |
|
Entre
2001 et 2002 / 1 an 3 mois |
Société
T. (Tigery) et SSCI M. (Neuilly-s-Seine). |
Pression
professionnelle énorme, violent maux de tête => Licenciement (raison
avancée : non tenue des délais). |
|
Nov.
2004 & fév. 2005 / 2 mois |
SSCI
P.-S. (Paris) |
Pression
professionnelle, violent maux de tête => Licenciement (durant la période
d’essai). Du fait de céphalées soudaines, j’ai échoué à un examen java JEE. |
Se me
battre sans cesse, sans fin, contre mes céphalées est toujours très épuisant. Et donc je suis souvent fatigué[316].
Du fait que je suis souvent fatigué depuis
des années et du fait que mes céphalées
se renforcent chaque WE, dès j’ai l’intention de ranger mon appartement
_ qui est un véritable dépotoir[317]_,
finalement, je suis obligé d’y renoncer, cela chaque WE (à chaque fois). C’est
un cercle vicieux sans fin.
Quand j’ai trop de maux de tête et que je
suis trop fatigué, j’envoie souvent hors délais les documents administratifs
aux administrations les réclamant _ tels que a) déclaration de revenus à
envoyer, dans les temps, l’Administration des impôts, b) idem formulaire de
déclaration de congé maladie à envoyer à la Sécurité sociale.
Ce que j’ai tenté pour résoudre le problème
Mon parcours médical est un vrai parcours du
combattant. En 25 ans, j’ai pratiquement tout tenté, entre autre :
|
Type
thérapie |
Date |
Type
pratic. |
Nom
pratic. |
Lieu |
Type
travail => Résultat(s) / apport(s) |
|
Psychothérapie |
83-85 |
Docteur psychiatre |
Kerzan Henri V |
Clinique du Chesnay (78) |
> Meilleure gestion du stress & de
mon relationnel => aucune diminution des CTC. |
|
Psychothérapie |
92 |
Docteur psychiatre |
Moll J. |
Hôpital St-Jean Bruxelles (Belgique) |
Analyse peu approfondie => aucun
résultat. |
|
Psychothérapie |
96 |
Docteur psychiatre |
Dintrans Jean-Roger |
Hôpital Tenon (75019) |
Analyse peu approfondie => aucun
résultat. |
|
Psychothérapie |
2005 |
Docteur |
Marquez Catherine |
Hôpital Ternier / Cochin (75006) |
Hypno-thérapie => aucun résultat. (J’ai fait 2 hypno-thérapies, une en 88). |
|
Psychothérapie |
2005 |
Psychologue |
Lagrange Marie-Paule |
« clinique » des maux de tête
(75) |
Analyse peu approfondie + technique de
gestion du stress => aucun résultat. |
|
Psychothérapie |
2009 |
Psychologue |
Cady Sylvie |
CIPS, 75016 |
Travail sur les « causes
culpabilisantes » |
|
Travail
psychothérapique sur moi-même |
/ |
/ |
/ |
Sur le
lieu du travail professionnel et ailleurs |
Travail
constant sur moi pour : a)
améliorer mon relationnel et mon réseau d’amitiés. b) ne
pas culpabiliser ou stresser, =>
résultat : petite amélioration sur le nombre & intensité des crises,
en 2009. |
|
Technique(s)
de diversion sur moi-même |
/ |
/ |
/ |
Sur le
lieu du travail professionnel et ailleurs |
Le
fait de travailler beaucoup et sans
cesse, me permet d’oublier, sur le moment, ma douleur. |
|
divers |
/ |
/ |
/ |
/ |
Coupure
définitive avec X à 53 ans, en janvier 2009[318]. |
|
divers |
/ |
/ |
/ |
/ |
Être
rangé, avoir des régularités. |
Cette liste n’est pas exhaustive. Et j’oublie encore l’utilisation constante de
bloc-notes & PDA, pour tenter de ne rien oublier. Actuellement, pour
résoudre le problème, j’ai aussi créé avec d’autres personnes souffrant de CTC[319] :
1) en 2007, l’association loi 1901 « Papillons en cage » soutenant les
personnes souffrant de céphalées de tension chroniques (CTC) très longues (en
général des céphalées se maintenant pendant plus de 10 ans),
2) j’écris actuellement un livre sur le
sujet, s’intitulant « céphalées de
tension chroniques, légendes et réalités ».
Les
causes originelles du problème (pistes) [320]
Malgré certaines absences de certitudes
scientifiques, je souhaite vous exposer des pistes sur de possibles causes
originelles, pour mieux vous faire comprendre pourquoi des céphalées peuvent
être si tenaces sur autant d’années
(ici 25 ans), en espérant que vous supposerez vrais les faits que j’expose sur
mon passé ou enfance[321]. Et de
les exposer reste extrêmement délicat :
|
Types causes |
Description +
exemple(s) |
|
Maltraitances &
brutalités durant
l’enfance |
.
coups, y compris sur la tête, assénés répétitivement, à chaque fois que je
m’opposais à X ou bien quand j’étais supposé avoir commis une bêtise. .
opposition constante de X envers tout ce que je pouvais entreprendre[322], .
préférences nettes et marquées pour mon frère[323]. .
reproches de X, sur mon attitude
& mes actions, même quand j’avais plus de 50 ans. .
Sans cesse isolé durant l’enfance, impossible d’apprendre à me battre et à me
débrouiller dans le monde_ on ne me met jamais au courant d’aucune démarche
administrative (tels que notaire, impôt …) => Débouchant dans le monde
adulte, j’ai la naïveté d’un enfant de 10 ans, ce qui me causera beaucoup de
problèmes ultérieurs d’adaptation au monde. |
|
Traumatisme
professionnel
en oct. 80, dans mon 1er emploi. |
>
Début une thèse de 3ème cycle au Laboratoire de physiques de
décharge à Gif-sur-Yvette. >
Mon directeur de recherche au CNRS ne met en binôme avec une technicienne de
laboratoire qui terrorise mon patron et qui ne travaille jamais. >
Je constate qu’elle sabote mes expériences[324]. >
Je m’en plains à mon patron, mais mon patron prend partie pour elle. >
Mon patron ne demande de travailler pour lui, désormais sans être payé, car
soi-disant il n’a plus d’argent sur le
contrat pour lequel il m’a embauché (pour cette thèse de 3ème
cycle). >
Durant 3 mois après, je travaille dur, sans être payé, pour conserver mon
emploi. >
Puis je suis renvoyé brutalement, du jour au lendemain, en septembre 81, sans
être à aucun moment préparé à ce renvoi, que cela soit par ce patron ou par
mes collègues. =>
Ayant misé toutes mes études pour devenir chercheur au CNRS, impression de fin du monde[325] |
|
Surmenage en octobre 81. (point
de départ de mes céphalées durables). |
.
Après un an de chômage, causé par mon patron du CNRS qui a préféré croire la
technicienne à mon sujet & qui ne cesse ensuite de me « démolir »
auprès de mes nouveaux employeurs qui le contactent régulièrement
téléphoniquement, pour savoir s’ils doivent m’embaucher, je décroche
péniblement un modeste emploi de programmeurs COBOL dans une petite SSCI. .
En période d’essai, en oct. 81, confronté à de soudaines difficultés
professionnelles imprévues et craignant
soudainement de revivre de nouveau le renvoi très traumatique de sept 80, je
fais un surmenage intense[326].
Une douleur cérébrale fulgurante survient au cours d’un APM d’octobre 81, au
cours d’une période de très grande fatigue intense. La céphalée constamment
intense et des insomnies totales, qui l’accompagneront, dureront environ 3
ans ( ?)[327]. |
|
Traumatismes
professionnels répétitifs[328] |
Pertes
de mémoire, de concentration du fait de mes céphalées durables => causes
de pertes fréquentes des mes emplois. D’où de mon image de manque de
fiabilité professionnelle auprès de mes employeurs (ou le fait que je ne sois
pas bon professionnellement). |
18 Annexe : le cas de Christine (un échange de mails)
Voici le détail du
dialogue que Christine et l’auteur ont eu ensemble pour tenter de percer le
mystère de sa guérison :
|
De : Christine Bonjour
Benjamin, Je
voudrais donner ce message d'espoir, car mes céphalées ont disparu après une
année environ de souffrance, avec vertiges, douleurs musculaires etc.
... il peut m'arriver d'en ressentir,
ou d'avoir une véritable migraine, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que
j'ai vécu. Je ne sais pas comment tout a disparu, il a fallu beaucoup de
temps, j'ai tout essayé et les premiers soulagements sont arrivés grâce
à l'acupuncture. Ce ne fut pas miraculeux, mais le médecin qui pratiquait
était très à l'écoute. C'est
vrai aussi que je n'aime plus penser à cette période si difficile, mais il
faut laisser l'espoir car ça peut disparaitre ! Je vous souhaite bonne
chance, et c'est possible d’aller mieux ... Christine _____________________________________________________________________________________________ De : Christine […]
lorsqu'on est mal on cherche ce genre de témoignages, je le faisais et j'en
avais trouvé un seul, sur un forum...Je pense que l'on ne veut plus y penser
du tout, moi même j'essaie de balayer cette époque de ma vie, c'était une
grande parenthèse pas bien agréable, mais je garde une amertume envers
les médecins, et la considération qu'ils ont face à ce genre de problème, ils
nous poussent à nous retrancher... Bien
à toi, Christine _____________________________________________________________________________________________ From: benjamin.lisan ALICE [mailto: Chère
Christine, Pour
pouvoir redonner de l’espoir à ceux qui souffre, sais-tu si la fin ta longue
période de maux de tête coïncidait avec la résolution d’un problème auquel tu
étais confronté (ou bien à un changement d’environnement _ familial,
professionnel etc. …). Et
si l’entrée dans cette période de maux de tête coïncidait avec la survenue de
problèmes (importants ? familiaux ? professionnels ?) à
résoudre ou bien lié à un changement d’environnement ou de contexte ? Merci
pour cette information (qui pourrait être importante). Amicalement, Benjamin _____________________________________________________________________________________________ De : Christine Malheureusement non Benjamin, tout
a commencé par de violents vertiges
juste avant Noël, période stressante et fatigante, mais c'est comme cela
pratiquement tous les ans... Je n'avais pas de problèmes, enfin pas plus que
d'habitude, si ce n'est un conflit avec ma sœur qui m'affectait peut être
plus, mais qui n'était pas récent... Et puis je ne vois pas de
raisons particulières à l'arrêt. Ceci dit, ça ne s'est pas fait en un
jour, mais l'amélioration a été progressive, et plutôt lente...j'ai encore
parfois mal à la tête, mais un ou 2 antalgiques me suffisent.... Ce qui
est certain c'est que moins j'avais
mal, moins j'y pensais et mieux j'allais... y penser tout le temps renforçait
ma douleur (mais c'est difficile de faire autrement quand on a mal.... c'est
un cercle vicieux, ...) Je ne pense pas que tout cela sera
d'une grande aide, car il n'y a pas vraiment d'explications...Enfin je n'en
ai pas trouvé. Mais cet enfer s'est arrêté...
j'essayais de faire ce qui m'apaisait le plus souvent possible; j'avais remarqué par exemple que nager me
soulageait, ainsi que les massages....et l'acupuncture aussi.... Comment et pourquoi, je ne sais
pas trop, mais ça peut s'arrêter... Christine _____________________________________________________________________________________________ From: benjamin.lisan ALICE [mailto: Chère
Christine, Je
te remercie de ta réponse, qui est malgré tout importante pour moi. Je
me permets d’émettre une autre hypothèse, encore : Peut-être,
durant la période où cela s’est arrêté, tu as avoir un repos ou un sommeil
réparateur _ une période de long repos et de calme ? Merci
pour cette confirmation ou non de cette seconde hypothèse. Amitiés, Benjamin _____________________________________________________________________________________________ De : Christine Non Benjamin pas spécialement,
mais progressivement je dormais mieux
effectivement, mais pas tout à coup. Pour moi, je ne trouve rien de
précis qui ait pu causer l'arrêt, (juste
mes angoisses envolées quand même, ce qui est peut être la raison ....) Bon courage, Et encore merci pour tout ce
travail qui m'avait tant aidé ! Christine _____________________________________________________________________________________________ From: benjamin.lisan ALICE [mailto: Bonjour, Encore
une question : Qu’est
ce qui a fait s’envoler votre angoisse ? Merci
pour l’info. Cordialement, Benjamin PS.
Un ami m’a parlé que les céphalées seraient une sorte de réaction de défense,
face à une situation trop stressante. Qu’en pensez-vous ? _____________________________________________________________________________________________ De : Christine Bonjour Benjamin, Je pense que oui, pour moi la situation stressante a été les
vertiges, je me suis persuadée que j'avais quelque chose de très grave. S'en
sont suivis beaucoup d'autres problèmes d'ordre neuro je pense… dont les
céphalées mais aussi des sortes de spasmes, des fourmillements etc. ... C'est un neurologue, qui m'a vraiment
convaincu que je n'avais rien de tout ce que j'imaginais, qui m'a vraiment
rassuré...Mais il m'a fallu le voir plusieurs fois pour que je commence à le
croire...et à penser autrement, il a aussi fallu que les vertiges
disparaissent... Bonne journée Benjamin et encore
bravo pour ce travail ! Christine _____________________________________________________________________________________________ From: benjamin.lisan ALICE [mailto: Chère
Christine, Tu
vas me croire ennuyeux mais je souhaite pousser l’investigation jusqu’au
bout. Cette
veille de Noël où tu as commencé à avoir des vertiges, est-ce que tu n’avais
pas eu une surcharge de stress combinés, tout en même temps, voire en tous
genres, comme par exemple, une surcharge stressante, combinée composée : a)
D’une surcharge de travail stressant ou de pression professionnelle _ par ex.
un grand nombre de formations à préparer pour le Parlement européen ( ?)
_, b)
D’une surcharge ou stress liée à la préparation de Noël ou liée à la
rencontre prochaine avec certains membres de ta famille (dont ta sœur), avec
lesquels la relation est angoissante ou créatrice d’anxiété ? Alors
que peut-être, normalement, en temps ordinaire, ton travail au Parlement
européen est calme et sans stress ? Juste
la veille de tes vertiges, n’as-tu pas été subitement fatiguée ? (Ou
bien as-tu un souci relationnel identifié, à un moment précis, qui te
préoccupait). Pour
moi, il y a certainement, il y a certainement un cause déclenchante
(certainement psychologique), plus ou moins précise, à l’origine de
l’apparition de tes vertiges (quelque chose de peut-être désagréable que tu
ne voulais pas voir, voire de le cacher _ peut-être ce problème relationnel
avec quelqu’un ( ?)). Sinon,
une de mes autres piste, serait une surcharge momentanée de toutes tes
capacités cérébrales _ une sorte de surcharge de stress qui devient trop
excessif, qui dépasse un seuil _, due à l’arrivée, tout en même temps,
d’angoisses, de stress (de causes angoissantes et stressantes), de fatigues
etc. … En
tout cas ton neurologue a été efficace. Que t’a t’il dit pour penser autrement ?
Quels ont été ses arguments ? Je suppose que c’était quelqu’un de très
censé et rassurant voire compréhensif ( ?). Peut-on
le recommander à d’autres personnes de l’association ? Si oui, quel est
son nom et son adresse ? Merci
pour toute info complémentaire qui te viendraient à l’esprit et qui
pourraient vraiment nous aider. Amitiés, Benjamin _____________________________________________________________________________________________ De : Christine Bonjour Benjamin, Tu ne m'ennuies jamais, je trouve
ce que tu fais incroyable et je pense que c'est admirable, sachant les
efforts que tu dois fournir pour cela, ceux qui n'ont jamais eu ces fameuses
céphalées de tension ne peuvent même pas s'imaginer ce que c'est.... Bien sûr qu'au moment des
premiers vertiges, j'étais complètement épuisée, je préparais les fêtes de
Noël, et comme chaque année tout se passe chez moi, le stress et les
préparatifs sont pour moi également. Au niveau du travail c'était la
clôture annuelle avec des délais de paiements à respecter, toutes les
nouvelles formations à prévoir, les remplacements de collègues aussi
qui profitent des fêtes pour partir dans leur pays d'origine, etc.... Les "pots" de fin
d'année qui se multipliaient, et souvent le soir, au Luxembourg, avec
tous les collègues... Ma soeur qui avait complètement
coupé les ponts, situation que je vivais très mal...j'essayais d'occulter le
problème, mais j'en étais malade, et je ne pouvais pas en parler, mon mari ne
voulant plus entendre parler d'elle.....Ca me rendait profondément
malheureuse... Chaque année à ¨Noël, c'est plus
ou moins la même chose, je termine l'année épuisée... là il y avait le
problème avec ma soeur en plus.... La veille, j'étais encore au
restaurant avec l'équipe informatique, mais vraiment trop fatiguée.... A tel point que depuis je
refuse tous ces "pots" le soir en fin d'année avec mes collègues,
parce que j'ai toujours eu cette impression de lien entre la grosse fatigue
du soir et les vertiges du lendemain..... Donc c'est certain, il y avait un
tout ce que tu décris (mais ceci, dit j'ai eu des moments plus difficiles je
pense avant et je n'en étais jamais arrivé à ce stade...) Le neurologue est docteur Scherrer
de l'hôpital Bel Air à Thionville, j'ai d’abord été hospitalisée dans son
service et c'est lui qui m'a dit qu'il s'agissait de céphalées de tension,
que je devais faire des exercices de relaxation, il m'en a montré un ou
deux...il m'a dit que cela ne partirait pas comme cela, du jour au
lendemain... c'était en février ou mars 2007....je n'ai pas vraiment cru ce
qu'il me disait, mais je savais qu'il était excellent neurologue, par
l'intermédiaire d'amis travaillant dans le même hôpital.... Je suis retournée le voir beaucoup
plus tard en consultation externe, il m'a enlevé un gros doute, une grosse
peur que j'avais (je m'imaginais avoir une sclérose, à cause de drôles de
phénomènes musculaires...). Il m'a dit que chez moi,
c'était la façon d'évacuer un stress, comme certain ont des réactions
cutanées (psoriasis, etc. ...) ce serait mon point fragile...J'ai beaucoup
aimé son écoute, (mais pas trop la première fois...), j'en avais assez de mon
généraliste qui me donnait l'impression de me prendre pour une malade
imaginaire.... Je ne sais pas si on peut le
conseiller à d'autres, moi il m'a apporté ce que j'attendais... Voilà Benjamin, si cela peut
t'aider... Bien à toi, Christine _____________________________________________________________________________________________ Chère
Christine, C’est
super ta contribution, avec ton propre travail, car celui-ci me fait pas mal
avancer dans la compréhension du mal et
concernant ses possibles causes déclenchantes. Petit
à petit, je pense que ce travail pourra aider à résoudre un jour, le mal (la
douleur) dont souffre les membres de l’associations (certains depuis très
longtemps). Tu
es un cas exceptionnel. Il est vraiment porteur d’espoir (car tu as réussi à
t’en sortir au bout d’un an ou à peu près). J’en
viens de plus en plus à penser que pour la plupart d’entre nous, qui souffre
ou a souffert pendant très longtemps, que la cause déclenchante de la
céphalée de tension chronique est la surcharge tout en même temps (combinée)
de stress, d’une très forte fatigue (voire une fatigue dépassée), d’une
déprime (qui elle même fatigue), voire d’une surcharge émotionnelle. Et
ce qu’il s’est passé dans ton cas, semble confirmer cela. Pour
moi, la douleur causée par la céphalée
de tension (créée par une contracture musculaire extrêmement
« tétanique » des muscles crâniens) est un signal envoyé par le
Système nerveux central, pour indiquer que les capacités cérébrales sont
dépassées (comme un stress dépassé) ou/et qu’ensuite la cause déclenchante
est toujours présente ( ?). Loïc
B lui parle que le cerveau par cette douleur manifeste une réaction de
défense (qui t’invalide et t’empêche ensuite de pouvoir surcharger ton
cerveau, surtout au niveau fatigue extrême ( ?)). Je
pense qu’avec des médecins classiques (dont ton médecin généraliste)
probablement tu ne t’en serait sorti que beaucoup plus tard (voire jamais). Pendant,
longtemps, j’ai pensé que si la céphalée de tension n’était pas prise à temps, juste à ses débuts, alors
ensuite elle risquait très probablement de s’installer durablement voire
définitivement (je pensais même, en m’inspirant d’une image
« militaire » en armurerie, à un mécanisme de gâchette cérébrale
qui s’arme puis se verrouille définitivement … et qu’on ne peut plus désarmer
ensuite. L’idée d’un mécanisme assez diabolique. J’ai eu cette idée du fait
que je ne sais combien d’essais, de recherches, j’ai fait durant 27 ans, pour
me débarrasser sans fin de mes céphalées (°). Et c’est vraiment terrible !).
Mais
ton cas semble contredire ce schéma et cette hypothèse, puisque tu as quand
même souffert pendant plus d’un an, ce
qui est quand même beaucoup et que finalement, rien ne semble définitif
(°°). Je
pense que ton neurologue, le docteur Scherrer de l'hôpital Bel Air à
Thionville, a certainement joué un énorme rôle dans la guérison de tes
céphalées de tension. C’est
rare qu’un médecin soit compatissant et passe du temps avec toi et joue un
rôle vraiment positif avec toi quand tu as des céphalées de tension. J’essaye
de deviner son rôle auprès de toi : a)
Peut-être a-t-il deviné que tu étais sans cesse dans
une spirale de fatigue, de stress, de
facteur entretenant continuellement le dépassement de tes capacités
cérébrales, et il t’a fait casser ce cercle vicieux _ par exemple, en te
faisant changer de comportement, en faisant en sorte que tu stresses moins,
que tu prennes moins les choses à cœur, que tu sois plus décontractée, cool
(« take it easy »), que tu ne sois plus surchargé de trucs parasites,
de soucis, de choses stressants, en faisant que tu puisses mieux aménager ton
temps et tes activités (avec un meilleurs planning, plus étalé, en sachant
mieux résister à la pression … Je ne sais pas, je tente de deviner
seulement). Je pense qu’il a du te donner de bon conseils pour gérer mieux ta
vie (pour être moins surcharger d’émotion et moins surcharger ton cerveau et
de ton ce qui peut réactiver la douleur). b)
Ou bien t’a-t-il fait changer de médicaments (lesquels
avant et après l’avoir rencontré ?), ou te les a fait diminuer
progressivement, jusqu’à leur disparition définitive, jusqu’à ce que tu n’en
ais plus besoin (t’a-t-il dit par hasard que tu aurais pris certains
médicaments à l’excès ( ?) _ il y aurait-il eu aussi, dans ton cas, abus
médicamenteux, par exemple avec des antidouleurs (comme du Diantalvic, de
l’Ixprim, des dérivés morphiniques ou à base de codéine ? …) ? …
bien que dans ton cas, je ne pense pas (°°°)). Si
tu arrivais à encore répondre surtout à ces deux dernières questions, cela
serait super important. Merci
encore de ton aide. Amitiés, Benjamin PS.
Il est vrai que cette douleur est terrible et les médecins souvent ne s’en
rendent même pas compte. (°)
Cela doit être une chose des plus pénible qu’il doit existe au monde (une
douleur qu’on n’arrive jamais à résoudre, malgré tous les efforts louables
qu’on fait pour s’en débarrasser). Cela
paraît tellement injuste. (°°)
Note : Déjà un an, c’est déjà vraiment trop, en tout cas
pour ce que j’en pense. De telles types de souffrance ne devraient jamais
exister !!!! Quelle horreur, quand on y pense. (°°°)
Pour moi, il est certain que la douleur liée aux céphalées de tension peut
être terrible et en même temps totalement autonome (sans jamais être causée
par aucun médicament). _____________________________________________________________________________________________ De : Christine Bonjour Benjamin, Il m'avait prescrit du Myolastan
et du Di-Antalvic....mais surtout me demandait de faire mes exercices de
relaxation. ... Mais au départ je n'ai vu aucune amélioration. Puis Il y a un acupuncteur
formidable à Metz, qui s'appelle M. Giraudot (ou Giraudeau) qu'on m'avait conseillé
de voir. Je pense qu'il a été le premier à vraiment m'aider. C'est un vieux
monsieur, qui devrait être à la retraite, mais qui travaille très tôt le
matin, jusqu'à très tard la nuit... Je lui disais souvent qu'il
m'avait sauvé la vie, il me rassurait avant tout. Souvent, parce que les
changements ont été longs, il me disait "rappelez-vous dans quel état
vous étiez la première fois que l'on s'est vus... " il m'a donné le
sentiment de prendre mon cas au sérieux, il m'aidait vraiment. Ensuite je suis retournée voir le
docteur Scherrer, en consultation externe, deux fois, et il m'a beaucoup
rassurée, il a réussi à faire sauter cette angoisse qui je pense
augmentait tous mes symptômes. Il n'avait pas de solutions miracles, mais
était si sûr de lui, il m'a même accueillie une fois avec une de mes filles,
et nous avons discuté tous les trois de ma façon "excessive" de
réagir au stress, et à l'angoisse. Et surtout il m'a dit que je n'avais rien
de grave, ce dont j'étais persuadée.... Voilà Benjamin, ce ne sont pas les
médicaments, mais ces personnes m'ont aidée à être moins angoissée, j'entrais
dans des états de panique et je n'en avais même plus conscience, tout
cela était comme un engrenage... il fallait aussi que je l'admette. La discussion avec docteur
Scherrer et ma fille a été salvatrice. A partir de là tout a été mieux. Mais j'avais oublie de te parler
de docteur Giraudot, qui m'a aussi tellement aidée... Je ne sais pas si j'ai répondu à
tes demandes, mais j'espère que cela t'aidera un peu. Je te souhaite une bonne journée ... Christine _____________________________________________________________________________________________ From: benjamin.lisan ALICE [mailto: Chère
Christine, Désolé
de t’embêter encore une fois. Très
rapidement, je t’expose encore une piste ou deux : 1)
Celle de la souffrance de la séparation d’avec ta sœur (que tu
dois aimer), 2)
Une possible mésentente ou incompréhension momentanée avec ta fille,
qui ont été résolu par le fait que vous avez pu enfin vous parler
franchement. Tous
les 2 étant cause de souffrances morales réelles pour toi. Qu’en
penses-tu ? Amitiés, Benjamin PS.
Cette idée m’est venue suite à une discussion par mails sur les causes de la
souffrances (voir le contenu du mail ci-joint au sujet de cette piste). Ce
ne sont que des idées que j’ai exposées, en couleur bleu dans le texte, dans la dernière version
de celui-ci ci-joint. Ce
texte faisant 70 pages, je ne sais si tu arriveras à trouver une imprimante
laser pour imprimer ces 70 pages (le mieux serait de le faire en
recto-verso). _____________________________________________________________________________________________ De : DEBLONDE Christine
[mailto:christine.deblonde@europarl.europa.eu] Bonjour Benjamin, Excuse-moi pour ce retard, mais je suis un peu débordée en ce
moment. Je pars en congé tout à l'heure et ici il faut tout terminer
et remplacer ceux qui sont déjà partis, donc ça n'arrête pas ! Mais oui, je suis certaine que la séparation, avec ma sœur
était bien un des éléments déclenchant... Mon mari me l'a souvent dit....,
avec ma fille je ne pense pas... c'est fréquent avec les enfants ce genre de
situations, mais je suis proche d'elle, même si nous ne sommes pas toujours
d'accord... Avec ma sœur, les choses resteront toujours différentes, même si
nous avons pu parler, rien n'est plus comme avant.... Désolée de ne pouvoir plus m'attarder, J'espère que tu vas bien et bravo encore pour tout ce que tu
fais ! Christine _____________________________________________________________________________________________ De : benjamin.lisan ALICE [mailto: Chère Christine, Merci pour tout ce que tu as fait pour m’aider. En tout cas je
retiens comme possible cause déclenchante, la douleur morale de la
séparation avec ta sœur ( ?). (C’est vrai qu’une séparation qu’on t’impose avec une personne
que tu aimes peut être très dur … Cette épreuve peut être cause de la perte
de toutes certitudes ou de repères ( ?). Cela chamboulerait tout. Je sais
par expérience qu’une douleur morale peut être très forte, même si l’on
continue à vaquer à ses occupations en tentant de ne pas y penser). En tout cas, j’ai tenté de faire le rapprochement entre cette
séparation et celle de la personne anglaise, citée dans un article médical
(qui a une insensibilité congénitale à la douleur) qui a eu sa seule douleur
et céphalée de tension de sa vie suite à la perte de son frère (la douleur
morale « s’évacuant » _ pour reprendre le terme du Docteur Scherrer
de Thionville _ sous la forme d’une douleur physique ( ?)). Et il semble que la parole ait été importante (dont le fait de
se parler), pour la résolution de la céphalée. Je t’envoie aussi le CR de l’AG de l’association qui s’est
tenue fin mai à Toulouse. Les membres de l’association n’ont pas fini encore
de le corriger, mais je te l’envoie quand même. Bonne vacances et « keep cool » (« COOOL !!! »
comme on dit, en allongeant le son du « O »). Amitiés, Benjamin PS. J’ai fait parfois les questions et réponse, et j’en suis
désolé, mais c’est surtout pour que tu valides ou non mes hypothèses. |
19 Listes des causes explicatives avancées aux patients par les médecins
Voici d’ailleurs, dans le tableau ci-après,
la liste des explications avancées _ plus ou moins clairement _ aux malades,
pour expliquer des céphalées de tension (CTC) durables, quand leurs CTC apparaissent
sans causes cérébrales apparentes ou
sans abus médicamenteux.
Note :
dans ce tableau sont présentés (voir ci-après) :
a) en marron, les
causes plutôt biologiques ou
physiologiques,
b) en bleu, les
causes plutôt psychologiques.
|
Causes possibles |
Solution |
Commentaires /
Discussions |
type |
|
1) bruxisme et problèmes maxillaires (problèmes
d’articulations maxillaires) |
a. contrôler le serrement et le frottement de vos dents. b. Traitements pharmacologiques (benzodiazépines,
myo-résolutifs ou antidépresseurs, contre le stress…). Approches dentaires : c. Porter une gouttière dentaire faite sur mesure,
pendant le sommeil voire la journée. d. Le système NTI-tss. e. La chirurgie maxillo-faciale. |
Souvent une manifestation
d’anxiété (comme le sont les TIC et les TOC). Selon certaines hypothèses,
le mouvement permanent des muscles maxillo-faciaux, leur tension permanente
engendrait une contracture douloureuse qui se propagerait aux muscles
péri-crâniens. Note : le système
NTI-tss agit comme une butée antérieure et parvient à réduire voire supprimer
l’intensité de la contraction musculaire. - Une patiente avait un problème à l’articulation de la
mâchoire inférieure. Elle a consulté un ostéopathe, ses céphalées ont disparu[329]. |
physio |
|
2) sinusites |
1) antibiotiques adaptés aux germes en cause, comme
l'amoxicilline-acide clavulanique, les céphalosporines de 2° et 3°
générations, les quinolones et éventuellement la pristinamycine, 10 à 15j
environ. 2) Corticothérapie utilisée en cas d'œdème important des
orifices sinusiens (préconisée à forte dose, en cure courte de 4 à 10 jours,
et en respectant les contre-indications). 3) Les lavages de nez 4) La corticothérapie locale 5) Les antihistaminiques locaux 6) Les aérosols (soniques) associant un antibiotique, un
corticoïde 7) Les cures thermales Ne pas aller à |
En général les sinusites
forment une barre frontale. Or les céphalées, pour certains, sont toujours
positionnées dans le cou et les tempes |
physio |
|
3) arthrose ou mauvaise position des vertèbres du cou |
a. Manipulation des vertèbres, par un kiné (voire un
ostéopathe). b. changer de postures. |
Une mauvaise posture pourrait
créer de contractures musculaires responsables de céphalées de tension. |
physio |
|
4) mauvaise oxygénation (y compris en raison d’une apnée du
sommeil). |
a. Apprendre à avoir une bonne respiration (par des exercices
de yogas, de relaxation). b. Cas du traitement de l’apnée du sommeil : 1) traitement médicamenteux : 2) traitement chirurgicaux : Par implants palatins _ des fils de polyester fins et tressés
_ que l'on place dans le palais mou (à l'arrière de la voûte du palais) dans
le but de renforcer et de raffermir les tissus qui bougent et obstruent les
voies respiratoires supérieures |
Cas des personnes qui
auraient une mauvaise capacité respiratoire, aurait une mauvaise respiration,
fumeraient. Comme dans le cas du mal
aigüe des montagnes ou les intoxications au monoxyde de carbone. En général ce type de
céphalées apparaît sous la forme d’une barre frontale. Or les céphalées, pour
certains, sont toujours positionnées dans le cou et les tempes |
physio |
|
5) manque de confiance en soi |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques …). |
Voir névrose et hypocondrie. Souvent liée à une fragilité
psychologique. |
psy |
|
6) contraction involontaire des muscles du cou, par peur du
monde |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques …). |
Tendance à se replier sur
soi, face aux épreuves, au stress, au monde (voir complexe d’Atlas). |
psy |
|
7) syndrome ou complexe d’Atlas |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques …). |
L’impression de porter sur
ses épaules des choses lourdes, plus lourdes qu’on peut supporter. |
psy |
|
8) névrose |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques …). |
Le malade aurait besoin de
plaindre. Il amplifie son « bobo ». Il invente ses maux de tête ou
en rajoute (même non consciemment). |
Psy |
|
9) trouble de l’anxiété |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques …). |
Voir névrose et hypocondrie. Le malade a une fragilité
psychologique. |
psy |
|
10) conflit intérieur, culpabilisation. |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,
neuroleptiques …). |
maux de tête liés à un
conflit entre ses ressentiments (le fait qu’on aurait mal digéré quelque
chose) et un fort surmoi (on ne voudrait pas accepter consciemment qu’on
aurait de mauvaises pensées, par exemple à cause de son éducation
religieuse). |
Psy |
|
11) dépression d’épuisement ou dépression cachée |
a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,
neuroleptiques …). c. Travailler moins. Prendre moins à cœur les choses. |
en France, on préfère souvent
avancer l’hypothèse qu’une dépression cachée créant le sentiment douloureux
et donc la sensation douloureuse, au lieu d’admettre que de vivre avec une
douleur permanente non traitée peut créer à la longue un état dépressif chez
le malade |
Psy |
|
11) Un cerveau qui cogite trop vite |
a. Travailler moins. Moins s’agiter. a. Psychothérapie analytique et comportementale (+ relaxation
/ traitement du stress). b. Psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques…). |
Le malade aurait tendance à
trop écrire, à faire trop de travail intellectuel jusqu’à atteindre l’épuisement
cérébral et donc son cerveau voudrait l’alerter de cet excès d’activité
intellectuelle en le « déconnectant », en l’invalidant etc. |
psy |
|
12) trouble bipolaire puis psychose maniaco-dépressive. |
a. Psychotropes (antidépresseurs, (anxiolytiques), neuroleptiques
…). b. Travailler moins. Il faut un travail aménagé. Une prise en
charge COTOREP souvent s’impose. |
psychose
maniaco-dépressive : forme la plus grave avec manie. La manie : état de
surexcitation des fonctions psychiques caractérisé par l'exaltation de
l'humeur avec déchaînement des pulsions instinctivo-affective. Après un
l’épisode maniaque, risque ou état d’épuisement psychique. Gravité des troubles
bipolaires : risque suicidaire, conduites à risque, addictions,
désinsertion professionnelle et familiale, actes de violences, délits … |
Bio & psy |
|
13) syndrome de la « couronne d’épine » |
a. Psychothérapie analytique. b. Psychotropes (antidépresseurs, neuroleptiques …). |
syndrome masochiste : le
malade aimerait son mal ou qui utiliserait son mal pour se faire plaindre |
Psy |
|
14) Décompensation (du WE …). |
a. Se reposer. b. Avoir une vie moins stressante (surtout dans le milieu
professionnel). |
En général, concerne les cas
des décompensations migraineuses. (en général peu graves, en
cas de céphalées de tension, à de rares exceptions près). |
Psy |
|
15) poussée "hypertensive" liée l’hypertension
artérielle |
a. Traitement contre l’hypertension artérielle. |
l’hypertension artérielle en
tant que telle ne provoque pas de céphalées, mais peut décompenser (libérer)
des céphalées [primaires] ; une poussée hypertensive avec une pression diastolique de plus de 120
mmHg ou une variation brutale de tension (plus de 25% de la pression
diastolique) peut provoquer des céphalées intenses. |
Physio |
|
16) Difficultés d’adaptation et fatigue oculaires / céphalées
d’attention |
a. Changer de lunette (de correction de sa vue). b. suivre des séances de rééducation de la vue chez un
ortho-opticien. c. se détresser face à un / tout sujet/domaine qui stresse
(comme un sujet d’examen). |
Par exemple, avec une
mauvaise correction, des mouvements des yeux anormaux, trop rapides … - Une personne souffrait de cataracte. Elle a été redirigée
vers un ophtalmologue, puis opérée par la suite et ses céphalées de tension
ont disparu[330]. |
Physio ou / et Psy |
|
17) niveau du seuil de la douleur très bas, chez certains
patients. Disfonctionnement
du système nerveux central, en particulier du système de gestion de la
douleur[331] |
a. Botox, b. antalgiques psychotropes … |
Hypothèse répandue dans les
pays anglo-saxon (mal ou peu prouvée). Avancée pour expliquer qu’on
ne trouve rien de physiologique et alors que le malade ne semble pas être un
malade mental. Elle a « l’avantage » de ne pas tout « mettre
sur le dos du malade ». |
Physio |
|
18) Traumatisme crânien |
a. antalgiques psychotropes … b. rééducation, c. parole lors de groupes de parole, (dédramatisation …), d. relaxation, hypnose, e. sophrologie, f. réentraînement à l’effort, g. hydrothérapie (lors de cure thermales par ex.). |
- Une personne avait eu une commotion cérébrale, avec perte de
mémoire, de concentration et fortes céphalées de tension, suite à une chute
dans un escalier. 10 séances de kinésithérapie, en relation avec à un
problème initial lié aux vertèbres dorsales, a fortement réduit les céphalées
de tension. Puis le patient a été redirigé vers un orthopédiste[332]. |
Physio |
Les
points 5) à 9), en italiques et en bleu, concernent des troubles anxieux
proches (ou approchants).
Sommaire
1 Différentes
formes de douleurs
2 Réactions
et humeurs des malades face à la douleur
3 Difficile
gestion de la douleur causée par les céphalées de tension
3.1 L’inexistence
de traitement efficace pour les céphalées de tension chroniques
3.2 Inefficacité des psychothérapies et
des méthodes de relaxation
3.3 Inefficacité
des psychotropes & problèmes posés par leur usage
3.4 Optimisme
excessifs concernant la possibilité de soigner les céphalées de tension
chroniques
3.5 Les
raisons de cet optimisme excessif : le schéma explicatif classique
3.6 L’idée
qu’une douleur chronique ne peut être très douloureuse
3.7 Les
conséquences thérapeutiques de ce schéma explicatif
3.8 Confrontation
de ce schéma explicatif avec les faits.
3.9 Différentes
formes d’handicaps causés par les céphalées de tension chroniques
3.10 La
difficulté d’en parler
3.11 Les
conséquences de l’échec du corps médical
3.12 Peut-on
aider ceux qui vivent l’échec du corps médical dans leur chair ?
3.13.1 Le
texte de Job dans la Bible
3.13.2 L’exemple
de certains saints ou saintes
3.13.3 Justifications
métaphysiques
3.15 Attitude
d’acception ou de résignation ?
3.18 Autres
approches philosophiques
4 Les
exercices mentaux pour tenir
4.1.1 L’entraînement
à la douleur
4.1.2 Profiter
de l’instant présent
4.1.3 Relativiser
son mal car il y a toujours pire à côté de nous
5 Des
armes de lutte par des moyens essentiellement pratiques
5.1 Le
combat mental et physique
5.2 Le
travail ou l’activisme sans fin
5.4 Œuvrer
dans des actions humanitaires
5.5 Rechercher
les causes de ses céphalées
5.6 La
piste des « causes culpabilisantes originelles »
5.7 La
pratique sportive intensive
5.8 Compenser
la réduction de nos facultés intellectuelles
5.9 Arguments,
un peu trop hyper-narcissiques, pour tenir
7 Douleurs
utilisées pour faire diversion à la douleur principale
8 L’espoir
d’une révolution médicale
9 Un
espoir avec le cas de Christine
10 Un
changement d’attitude intérieure
10.2 L’arme
de l’humour et de la distanciation
10.2.2 L’arme
de la distanciation et ne plus dramatiser
11 Autres
techniques de survie
12 Autres
pistes de thérapies comportementales
13.1 Messages
à destinations des médecins
13.1.1 Sur
la sévérité de l’intensité douloureuse des céphalées de tension
13.1.2 Sur
les pertes de mémoires et difficultés de concentration graves liées à mes
céphalées
13.1.3 Contribuer
à une étude scientifique précise de la maladie
13.1.4 Une
prise vraiment sérieuse de la maladie.
13.1.5 Le
coût caché des céphalées de tension chroniques
13.2 Messages
à destinations des membres de l’association « Papillons en cage »
14 Annexe :
comprendre la démarche médicale envers les CTC
14.1 Introduction
sur cette démarche et le problème qu’elle pose
14.2 Origine
philosophique de la minimisation des douleurs chroniques
14.3 La
théorie de l’investissement et engagement
14.4 L’absence
de certitudes scientifiques sur le sujet
14.5 La
théorie de la dissonance cognitive
14.6 Rien
de scientifique dans l’évaluation de la douleur
14.7 Annexe :
la vision couramment répandue chez les médecins
14.8 Annexe :
Pourquoi l’utilisation des psychotropes
14.9 Annexe :
Éléments de doutes sur l’intensité des céphalées de tension
15 Annexe :
possibles pistes sur les causes des céphalées de tension chroniques
15.1 Pourquoi
peuvent-elles êtes si douloureuses ?
15.2 Pourquoi
le mal ne diminue pas au cours du temps ?
15.4 Pourquoi,
quand elles sont très douloureuses, réduisent-elles nos capacités
mentales ?
15.5 Pourquoi
peuvent-elles créer des vertiges chez quelques rares personnes souffrant de
CTC ?
15.7 Pourquoi
des pharmaco-résistances sont observés ?
15.8 Pourquoi,
dans certains cas, le Botox, ne semble pas marcher ?
15.9 En
« conclusion partielle »
16 Annexe :
la piste entrevue par la psychologue Marie-Paule Lagrange
17 Annexe :
un témoignage sur de possibles causes originelles
18 Annexe :
le cas de Christine (un échange de mails)
19 Listes
des causes explicatives avancées aux patients par les médecins